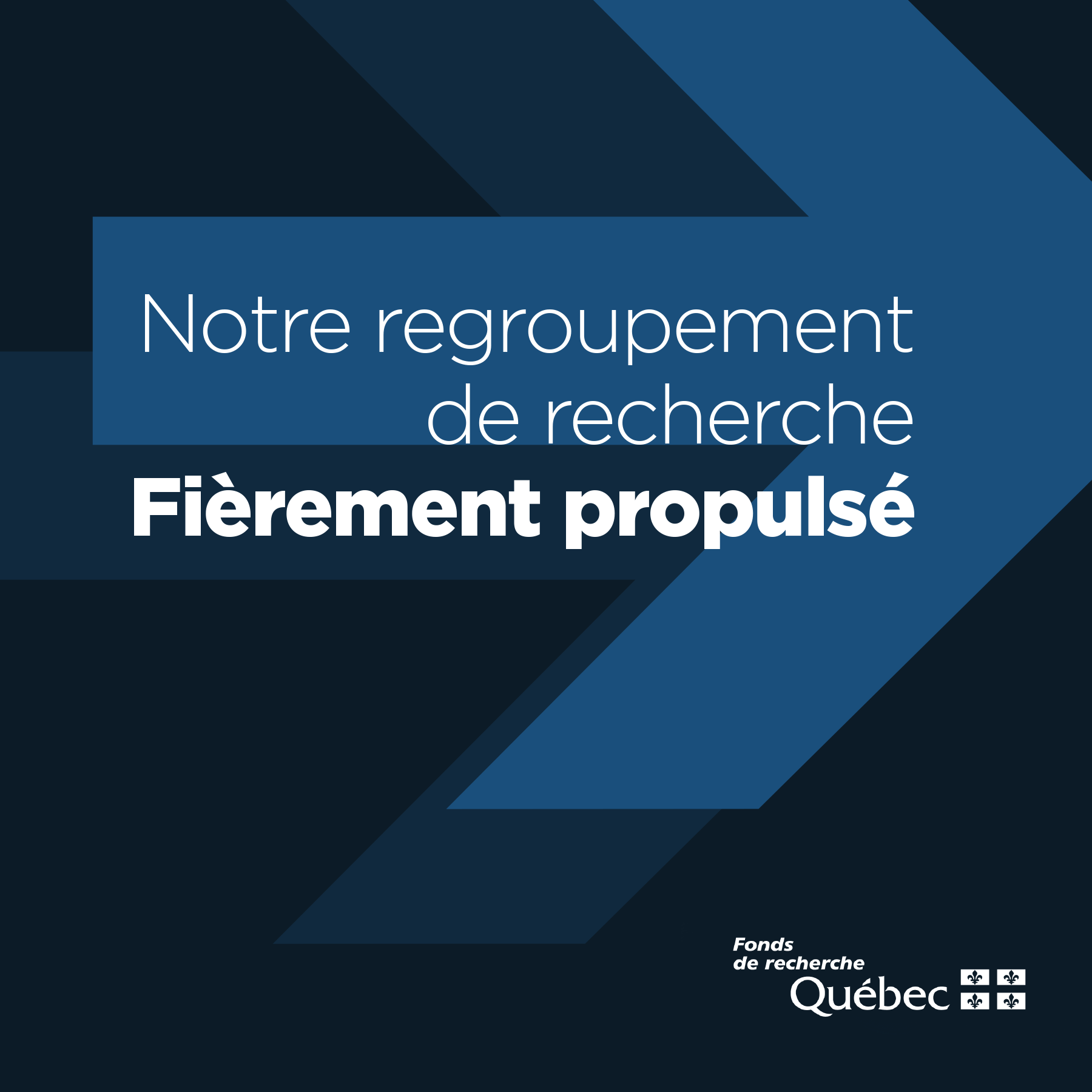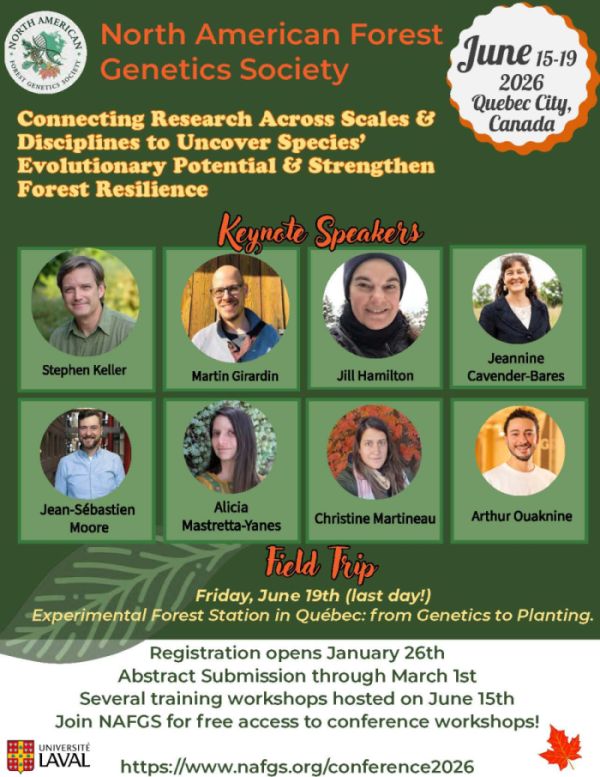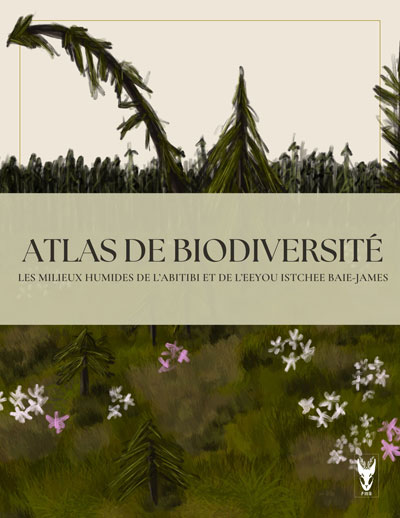Résumés des présentations et horaire (par ordre chronologique)
Sauter à la section affiches | Retour à la page du Colloque
1 - Future Arctic and Boreal Fire Regimes
Jessica McCarty
Chercheur(e) non-membre du CEF (Department of Geography, Miami University in Ohio)
Salle plénière - 08h45
Wildland fires in the boreal and Arctic are increasing in frequency and severity, with extreme fire seasons documented across the Pan-Arctic in 2019, 2020, and 2021. Globally, human-caused and wildland fires above 60°N were larger sources of black carbon and methane than current modeled estimates of anthropogenic sectors. This talk will summarize recent and ongoing results from a recent Arctic Council expert group report as well as a current EU-funded project to understand the impact of fires in the High Northern Latitudes on air quality, black carbon emissions, and potentially emission inventories. It will highlight ongoing and needed collaboration of European scientists with U.S. and Canadian fire researchers. Several NASA programs, including NASA Wildland Fire Management and NASA FireSense, are seeking to understand and enhance collaboration between North American ecology and fire researchers and scientists, including geospatial data users. Issues of inclusion, diversity, and equity are inherent to understanding fire ecology and fire management in the High Northern Latitudes, including centering and deferring to Indigenous and local communities.
2 - Converser en bouleau: des expressions phénologiques
Gisèle Trudel
Chercheur(e) associé(e) (CEF, UQAM, MÉDIANE - Chaire de recherche du Canada en arts, écotechnologies de pratique et changements climatiques)
Autres auteurs
- Susan Turcot (École des arts visuels et médiatiques, UQAM)
- Marie-Eve Morissette (NAD - École des arts numériques, de l'animation et du design)
- Daniel Kneeshaw (CEF, UQAM)
Salle plénière - 10h00
Comment activer un dialogue entre cultures scientifiques et artistiques, entre humain•e•s et arbres ? Deux projets reposant sur des expérimentations ouvertes entre arts et sciences seront discutés - Orée des bois (2022) et Pheno-card Visioning with Birch (2022) - pour tenter d’éclairer un échange entre pratiques, en prenant appui sur l’étude de la phénologie du bouleau. En cette période de bouleversements écologiques, les deux projets proposent un agir partagé avec l’arbre, un allié millénaire.
Orée des bois est une installation médiatique dans l’espace public, une collaboration entre la Chaire MÉDIANE et le groupe SmartForests Canada. Les données métriques captées du bouleau jaune (flux de la sève, dendromètre et température) sont une incursion dans son fonctionnement et les chronophotographies de ce même arbre prises sur le terrain dans Lanaudière présentent son milieu de vie. Leur combinaison dans l'œuvre stimule une expression spatio-temporelle insoupçonnée de sa vitalité. De plus, une analyse préliminaire des entretiens semi-dirigés menés auprès des publics à propos de leur expérience de l'œuvre pointe vers de nouveaux modes d’être-ensemble.
Pheno-Card Visioning with Birch est un jeu de cartes avec de délicats dessins sur écorce de bouleau qui emprunte un autre mode de discussion, en duo ou en trio. Librement inspiré de lectures d’articles scientifiques, le projet porte sur les variations et caractéristiques saisonnières de bouleau blanc et la façon dont l’arbre est affecté par les changements climatiques.
La présentation se tiendra sous forme de conversation entre les personnes porteuses des projets. La conversation pourra se poursuivre de façon informelle dans un nouvel agencement du projet Pheno-Card Visioning with Birch avec celles et ceux qui souhaitent y participer.
Mots-clés: foresterie sociale, écologie forestière, bouleau, phénologie, changements climatiques, activisme, arts et sciences, arboréalités
3 - Sortir des sentiers battus
Patricia Raymond
Chercheur(e) associé(e) (Direction de la recherche forestière, MFFP)
Salle plénière - 10h15
Dans la plupart des domaines, sortir des sentiers battus est essentiel pour innover et se tailler une place en recherche. Cela est d’autant plus vrai, au sens propre et au sens figuré, pour une discipline aussi traditionnelle que la sylviculture appliquée. Lors de cette conférence, je vous parlerai des principaux jalons de mon parcours, avec une attention particulière sur mes projets de recherche qui s’articulent autour de trois grandes thématiques : la sylviculture écologique, la réhabilitation des peuplements dégradés et la sylviculture d’adaptation aux changements climatiques.
Mots-clés: aménagement écosystémique, résilience, coupe progressive irrégulière
4 - Les chemins que nous traçons
Osvaldo Valeria
Chercheur(e) régulier(ère) au CEF (CEF, UQAT)
Salle plénière - 10h30
Les chemins forestiers sont une des perturbations de plus significatives qui modifie considérablement de manière plus au moins permanente la connectivité et la dynamique naturelle de la forêt boréale canadienne. Sa densification constante soulève plusieurs impacts économiques, environnementaux et sociaux. Même si l’étape de construction est soumise à plusieurs contraintes, le manque de connaissance sur plusieurs formes (qualité de l’information, état et suivi de leur dégradation) met en péril la sécurité des usagers et a des effets nocifs sur la faune (ex. poissons, caribou) et limite les services écosystémiques de la forêt (ex. approvisionnement). Nous allons passer en revue plusieurs travaux de recherche visant en mieux comprendre cet enjeu écologique, économique et social tout en étant critique sur la façon dont nous accédons au territoire et les menaces qui nous guettent sur les changements globaux que subira la forêt boréale.
Mots-clés: lidar, dégradation, accès
5 - Oiseaux et écosystèmes boréaux – Des travaux de terrain appliqués à la modélisation de scénarios futurs
Junior A. Tremblay
Chercheur(e) régulier(ère) au CEF (Environnement Canada)
Salle plénière - 10h45
Durant cette présentation, je vous fera un bref sommaire des activités de mon programme de recherche lequel vise à comprendre l'impact potentiel des perturbations naturelles et anthropiques et des changements climatiques sur la sélection de l’habitat et les paramètres démographiques des oiseaux de la forêt boréale, avec un intérêt particulier aux espèces en péril. Ainsi, mon programme de recherche fournit des informations scientifiques appliquées en support au mandat de conservation et de rétablissement des oiseaux et espèces en péril d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et à la protection de leurs habitats. Mon programme est constitué principalement de deux grands axes de recherches complémentaires, soit 1) des projets de recherche appliqués sur le terrain, et 2) la modélisation des impacts des perturbations naturelles et anthropiques sur les oiseaux dans un contexte de changements climatiques. Je présenterai quelques exemples de projets de recherche appliqués sur le terrain qui comprennent entre autres la détermination des attributs de l’habitat essentiel d’espèces en péril, l’évaluation de meilleures pratiques forestières pour maintenir les attributs d’habitat essentiel, la détermination des routes et haltes migratoires d’espèces en péril ou en déclin, assurer un exploitation durable des ressources naturelles en forêt boréale et, finalement, définir les trajectoires de succession des oiseaux de la forêt boréale après perturbations naturelles ou anthropiques. Je présenterai également quelques exemples de projets de modélisation utilisant des modèles de paysages forestiers qui permettent de prédire les tendances futures des populations d’oiseaux basées sur les impacts des perturbations et changements climatiques sur leur habitat et incluent également des collaborations multi-disciplinaires afin d'intégrer divers enjeux liés aux changements climatiques tels que la séquestration du carbone, le maintien de la ressource ligneuse (enjeu économique) et la conservation de la biodiversité.
6 - Cartographier la canopée des grandes villes du Québec : une mission pour le lidar et l'intelligence artificielle.
Batistin Bour
Chercheur(e) non-membre du CEF (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO))
Autres auteurs
- Mathieu Varin (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO))
- Marc-Antoine Genest (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO))
Balcon Orford - 15h10
Les arbres jouent de nombreux rôles importants en milieu urbain. Ils permettent de réduire les effets dommageables sur notre environnement, notamment en diminuant la température ambiante des villes, en réduisant la présence des gaz polluants dans l'air et en filtrant les petites poussières fines en suspension. Devant tous ces gains et avantages que procure la végétation en milieu urbain, de plus en plus de villes ont le souci d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens, par la mise en place de mesures visant à augmenter la couverture arborescente sur leur territoire. Dans ce contexte, des outils d'évaluation de la présence de la couverture arborescente et de suivi de son évolution dans le temps s'avèrent fort utiles pour les gestionnaires. En effet, de tels outils permettent non seulement de prioriser les secteurs de plantation où le couvert arborescent est jugé insuffisant, mais aussi de fixer des cibles à atteindre, et aussi d'obtenir un portrait qui peut être comparé à celui d'autres villes nord-américaines. L'approche développée consiste à utiliser une donnée uniforme disponible dans le Québec méridional, soit celle acquise par lidar aéroporté. Un modèle par apprentissage profond a été entraîné pour considérer une variété de configurations de données (avec ou sans feuilles, densité variable, etc.), de manière à réaliser une cartographie prédite de la canopée urbaine dans les cinq principales régions métropolitaines de recensement du Québec. Cette approche a l'intérêt d'utiliser une donnée largement déployée, ce qui facilitera la reproductibilité de la méthode afin d'assurer un suivi de la canopée.
Trees play many important roles in urban areas. They reduce the harmful effects on our environment, notably by reducing the ambient temperature of cities, by reducing the presence of polluting gases in the air and by filtering small suspended fine dust. In view of all these gains and advantages provided by vegetation in urban areas, more and more cities are concerned about improving the quality of life of their citizens by implementing measures to increase tree cover on their territory. In this context, tools for evaluating the presence of tree cover and monitoring its evolution over time are very useful for managers. Indeed, such tools allow not only to prioritize plantation sectors where tree cover is deemed insufficient, but also to set targets to be reached, and to obtain a portrait that can be compared to that of other North American cities. The approach developed consists of using a uniform data set available in southern Quebec, namely that acquired by airborne lidar. A deep learning model was trained to consider a variety of data configurations (with or without leaves, variable density, etc.), in order to perform a predicted mapping of the urban canopy in the five main census metropolitan areas of Quebec. This approach has the advantage of using a widely deployed data set, which will facilitate the reproducibility of the method for monitoring the canopy.
Mots-clés: aménagement, biodiversité, télédétection, canopée urbaine, intelligence artificielle, lidar
7 - Outbreaks of spruce budworm (Choristoneura fumiferana): a story of population dynamics, environmental conditions, and defoliation
Morgane Henry
Étudiant(e) au doctorat (CEF, Université McGill)
Autres auteurs
- Patrick James (University of Toronto)
- Brian Leung (Université McGill)
Parterre Orford - 15h10
The spruce budworm (Choristoneura fumiferana) is Canada's most destructive forest disturbance. Its periodic outbreaks cover several million hectares and cause extensive damage to economically important tree species. A key phase of an outbreak is the transition from endemic to epidemic densities: the rising phase. This phase is crucial because it precedes the large defoliation events that forest managers want to mitigate, and knowledge of its dynamics could improve our ability to predict defoliation. However, this phase has never been examined at a large-scale using population data. The overall objective here is to assess population growth during the ongoing outbreak in Québec (2006 - present) and relate the larvae densities to observed defoliation. We first estimated the population growth rates of >1000 time series of spruce budworm larvae counts using a state-space model and identified the effects of environmental conditions on these rates. Second, we linked the population time series to defoliation data retrieved from aerial surveys to identify a potential time lag between increasing densities and the appearance of defoliation. Our results show spatial variability in growth rates, with higher growth rates in Northern locations. Higher growth rates were also associated with a higher proportion of hardwood species and higher elevation. Defoliation was best explained by the cumulative densities of larvae in the previous 3 years. Although the lagged densities had the biggest influence on defoliation, proportions of balsam fir and black spruce were positively and negatively related to defoliation levels, respectively. These results will be used to further develop a suite of predictive models that can predict when and where local spruce budworm populations are at risk of switching to epidemic densities. Understanding how population dynamics, environmental conditions, and defoliation patterns interact over large areas is crucial to adapting our management strategies.
Mots-clés: dynamique des populations, historique des perturbations, spruce budworm, outbreak, predictive modelling, defoliation
8 - Aucun effet des fourmis ou vers de terre sur la conductivité hydraulique des sols urbains
Roberto Sepulveda-Mina
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAM)
Autres auteurs
- Xavier Paradis (UQAM)
- Javier Ibarra-Isassi (Université Concordia)
- Jean-Philippe Lessard (Université Concordia)
- Tanya Handa (CEF, UQAM)
Balcon Orford - 15h30
Les sols urbains supportent une végétation de complexité variée allant de boisés à des communautés végétales très simplifiées comme des pelouses. Ils abritent de nombreux organismes dont les fourmis et vers de terre, qualifiés d'ingénieurs du sol, qui peuvent influencer les propriétés du sol en créant de nombreuses galeries. Nous avons évalué l'état d'invasion par les vers de terre exotiques envahissants et la structure de la communauté des fourmis dans quatre types de végétation (pelouses avec et sans arbres isolés, des aménagements arbustifs et des boisés) à trois sites différents à travers la ville de Montréal. Notre hypothèse était que la structure de végétation plus complexe serait plus résiliente à l'invasion par les vers de terres et que l'abondance des deux types d'ingénieurs d'écosystèmes résulterait dans plus de matière organique et un taux de conductivité hydraulique plus élevé dans les sols. En juillet et août 2020, nous avons échantillonné des fourmis (pièges fosses) et vers de terre (extraction à la moutarde) et avons déterminé le contenu en matière organique des sols (perte au feu) ainsi que la conductivité hydraulique avec un infiltromètre à disque (n=5 par type de végétation et site). Les 540 vers de terre, majoritairement Lumbricus terrestris, étaient deux fois plus abondants dans les boisés que dans les autres types de végétation indiquant que la végétation plus complexe n'était pas plus résiliente à l'invasion. Près de 40 espèces de fourmis ont été recensées avec une communauté distincte dans les boisés caractérisés par une forte présence d'Aphaenogaster picea et ayant plus de matière organique comparée aux sols dans la végétation moins complexe. Cependant, ni le type de végétation ni la présence des ingénieurs d'écosystèmes n'ont influencé la conductivité hydraulique des sols. Nos résultats démontrent l'aspect unique des boisés comparés aux sites aménagés pour la macrofaune des sols urbains.
Mots-clés: biodiversité, aménagement, formicidae, lumbricina, forêt urbaine, sol urbain, matière organique, hydrologie des sols
9 - Facteurs de mortalité chez la régénération préétablie en contexte d'épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette et de coupes de récupération
Sabrina Brisson
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAM)
Autres auteurs
- Kaysandra Waldron (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Daniel Kneeshaw (CEF, UQAM)
- Louis De Grandpré (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
Parterre Orford - 15h30
Depuis 2006, la Côte-Nord est grandement touchée par une épidémie de TBE, la surface de forêt affectée par l'insecte atteignant près de 4.5M ha en 2020. Notre projet de recherche vise à mieux comprendre l'impact l'épidémie sur la dynamique de la régénération préétablie (RP) de sapin baumier (SAB) et d'épinette noire (ÉPN). Cette strate est typiquement moins affectée par la TBE que celle des arbres matures, permettant de régénérer le peuplement après la perturbation. Toutefois, si la densité de TBE devient assez élevée, l'insecte s'alimentera aussi sur la RP. Étant donné son rôle clé dans la résilience du peuplement à la perturbation, il est important de connaître comment elle est affectée par l'épidémie. Or, il existe peu d'études sur l'impact de la TBE sur la dynamique de la RP. À partir d'un dispositif de suivi long-terme de la dynamique de régénération post-TBE, un modèle permettant d'identifier les facteurs influençant la mortalité chez les semis de la RP a été élaboré pour relever l'effet de l'épidémie sur la démographie de la régénération. Deux traitements sont considérés, soit les peuplements affectés par la TBE et ceux affectés par la TBE suivi d'une coupe de récupération. Les variables incluses dans ce modèle sont la taille des semis, l'espèce et le type de peuplement, en plus du traitement. Nos résultats démontrent notamment que la survie de la RP diminue avec une augmentation de la taille des semis et de la proportion de SAB dans le peuplement. De plus, la survie des semis d'ÉPN est supérieure à celle du SAB, mais la différence de survie est moindre en traitement "coupe". Il en ressort que la TBE et la coupe de récupération influencent non seulement les arbres matures, mais aussi la régénération. Ces résultats devraient être pris en compte dans les pratiques d'aménagement post-TBE.
Mots-clés: écologie forestière, perturbations naturelles, coupes de récupération
10 - Impact de la coupe de racines sur la stabilité des arbres en milieu urbain
Clément Pallafray
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, Université Laval)
Autres auteurs
- Jean-Claude Ruel (CEF, Université Laval)
- Janani Sivarajah (CEF, Université Laval)
Balcon Orford - 15h50
L’objectif de l’étude est de quantifier la perte de stabilité due à la coupe de racines. Pour ce faire, on réalise un test de traction avant et un autre après la coupe de racines à une distance prédéterminée. Le test de traction consiste à tirer sur un arbre avec un treuil en mesurant l’inclinaison induite. Avec ces données, il devient possible d’estimer la capacité de l’arbre à résister à une certaine vitesse de vent. La méthode du test de traction utilisée est celle de Brudi et van Wassenaer 2002 (Brudi, E., van Wassenaer, P., 2002. Trees and Statics: Non-Destructive Failure Analysis. Tree Structure and Mechanics Conference Proceedings: How Trees Stand Up and Fall Down. ). Elle est sans dommage pour l’arbre et permet de prendre en compte la forme de l’arbre, les propriétés du bois et les conditions d’emplacement de l’arbre (milieu urbain, périurbain, champs, etc.). L’étude porte sur des érables de Norvège et des tilleuls à petites feuilles. Les arbres sont principalement situés dans des parcs et n’ont de limitation pour le développement racinaire que d’un côté (le trottoir est situé de 2 à 10m). Les arbres choisis font environ 30cm de diamètre à hauteur de poitrine et en moyenne 11m de haut. Les résultats suggèrent que, même en coupant les racines à 1m de l’arbre sur deux côtés perpendiculaires, la stabilité ne serait pas affectée. Le facteur limitant la coupe de racine serait donc plutôt la vigueur de l’arbre que la stabilité. Toutefois, les résultats pourraient être différents pour des arbres plus grands ou dont le développement du système racinaire serait limité à plusieurs endroits.
Mots-clés: foresterie urbaine
11 - Climate warming reduces black spruce growth during an outbreak period
Anoj Subedi
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Philippe Marchand (CEF, UQAT)
- Yves Bergeron (CEF, UQAT)
- Hubert Morin (CEF, UQAC)
- Miguel Montoro Girona (CEF, UQAT)
Parterre Orford - 15h50
Spruce budworm (Choristoneura fumiferana, SBW) outbreaks are one of the major disturbances in boreal forests, with three outbreaks in the last century (1905-1930, 1935-1965, and 1968-1988). The late-century outbreak affected more than 50 million hectares of forest area in Quebec. Consecutive defoliation by SBW over 4-5 years can change the dynamics and productivity of the host stands. The severity and the extent of SBW outbreaks are altered by the changing climate, which poses a challenge to forest management. Our goal was to evaluate the impact of climate change on black spruce (Picea mariana) growth during SBW outbreaks. We compiled dendrochronological (2271 trees), outbreak severity (estimated by observed defoliation aerially) and climate data for 164 sites spread across 900,000 km2 in Quebec. We used a linear mixed-effects model to determine the impacts of climatic parameters and cumulative defoliation (previous five years), as well as their interaction, on basal area growth, while accounting for site-specific differences in mean growth. Our findings showed that the growth of black spruce was reduced by 2.7% for each year at maximal outbreak severity. The following climate variables affected the response of growth to defoliation (climate-SBW interaction): high values of the minimum summer temperature and the previous summer's climate moisture index (CMI) caused a further decrease in growth of 2.1% and 0.7%, respectively in contrast, high values of the preceding spring minimum temperature (1.7%) with the previous summer's high temperature (1.3%) attenuated the negative effect of defoliation. These are standardized effect sizes based on a standard deviation change in the climate variables. Increased temperature favored the earlier emergence of SBW larva that led to start feeding in advance, leading to growth reduction over successive years. This suggests that the positive response of black spruce growth to an increase in temperature might be attenuated or even reversed with an increase synchrony between the larval emergence period of SBW and the timing of budburst. This research will contribute to improve our understanding of SBW-climate interactions on tree growth, which is essential to establish forest management strategies in the face of climate change.
Les épidémies de la tordeuse des bourgeons de l'épinette (Choristoneura fumiferana, TBE) sont l'une des principales perturbations en forêts boréales, avec trois épidémies au cours du dernier siècle (1905-1930, 1935-1965, et 1968-1988). Cette dernière épidémie a touché plus de 50 millions d'hectares de surface forestière au Québec. La défoliation consécutive par la TBE sur 4-5 ans peut changer la dynamique et la productivité des peuplements hôtes. La sévérité et l'étendue des épidémies de TBE sont modifiées par les changements climatique, ce qui pose un défi à l'aménagement forestier. Notre objectif était d'évaluer l'impact des changements climatiques sur la croissance de l'épinette noire (Picea mariana) pendant les épidémies de TBE. Nous avons compilé des données dendrochronologiques (2271 arbres), de sévérité d'épidémie (estimée par la défoliation observée par voie aérienne) et climatiques pour 164 sites répartis sur 900 000 km2 au Québec. Nous avons utilisé un modèle linéaire à effets mixtes pour déterminer l'impact des paramètres climatiques et de la défoliation cumulative (cinq années précédentes), ainsi que leur interaction, sur la croissance en surface terrière, tout en tenant compte des différences de croissance moyenne entre les sites. Nos résultats ont montré que la croissance de l'épinette noire était réduite de 2,7 % pour chaque année à la sévérité maximale de l'épidémie. Les variables climatiques suivantes ont affecté la réponse de la croissance à la défoliation (interaction climat-épinette noire) : des valeurs élevées de la température minimale estivale et l'indice d'humidité climatique (IHC) de l'été précédent ont entraîné une diminution supplémentaire de la croissance de 2,1 % et 0,7 %, respectivement. En revanche, des valeurs élevées de la température minimale du printemps précédent (1,7 %) avec la température élevée de l'été précédent (1,3 %) ont atténué l'effet négatif de la défoliation. Il s'agit de tailles d'effet standardisées basées sur un changement d'écart type dans les variables climatiques. L'augmentation de la température a favorisé l'émergence plus précoce des larves de TBE qui ont commencé à se nourrir plus tôt, entraînant une réduction de la croissance au cours des années suivantes. Cela suggère que la réponse positive de la croissance de l'épinette noire à une augmentation de la température pourrait être atténuée ou même inversée avec une synchronisation accrue entre la période d'émergence des larves de la tordeuse et le moment du débourrement. Cette recherche contribuera à améliorer notre compréhension des interactions TBE-climat sur la croissance des arbres, ce qui est essentiel pour établir des stratégies d'aménagement forestier face aux changements climatiques.
Mots-clés: écologie forestière, historique des perturbations, climate change, defoliation, disturbances, dendrochronology, ecological modelling, forest management
12 - Foliar fungi under urban stress
Maria Faticov
Postdoc (CEF, Université de Sherbrooke)
Autres auteurs
- Jorge Amorim (Swedish Meteorological and Hydrological Institute)
- Ahmed Abdelfattah (Leibniz Institute of Agricultural Engineering and Bio-economy, Germany)
- Laura van Dijk (Stockholm University)
- Isabelle Laforest-Lapointe (CEF, Université de Sherbrooke)
- Ayco Tack (Stockholm University)
Balcon Orford - 16h10
Plant leaves host many different microorganisms, among which fungi are particularly abundant. Foliar fungi play an important role in regulating plant health, biodiversity and ecosystem functioning. Fungal communities may be highly sensitive to anthropogenic activities, e.g. urbanization. However, to what extent urban features influence fungal communities is largely unknown. In this project, we investigated the effects of city microclimate and air quality on oak foliar fungal community. To do that, we sampled leaves from 85 mature oaks (Quercus robur) within Stockholm region, Sweden. We also partnered with Swedish Meteorological and Hydrological Institute to downscale historical and future simulated climatic and air quality data to 1 km × 1 km resolution over Stockholm. This way we explored the relative effect of microclimate and air quality in shaping fungal microbiome along the urbanization gradient. Our results provide the first quantitative results of the biological impacts of urbanization on the fungal diversity.
Mots-clés: biologie moléculaire, dynamique des populations
13 - La défoliation du peuplier faux-tremble par la livrée des forêts modifie la composition de la communauté des collemboles du sol
Essivi Gagnon Koudji
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAM, Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ))
Autres auteurs
- Emma Despland (CEF, Université Concordia, Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ))
- Anne-Sophie Caron (CEF, Université Concordia, Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ))
- Tanya Handa (CEF, UQAM, Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ))
Parterre Orford - 16h10
Les épidémies de la livrée de forêt Malacosoma disstria modifient la physiologie des arbres défoliés et entrainent des dépôts d'une quantité importante de feuilles mortes et de déjections des chenilles avec des conséquences potentielles pour les organismes du sol à travers des mécanismes directs (par ex : changements de température ou humidité) ou indirects (par ex : changements aux réseaux trophiques détritaux et racinaires). Nous avons évalué si une défoliation récente (2015 à 2017) à la Forêt d'enseignement et de recherche du Lac Duparquet (Abitibi, QC) répercutait sur la structure des communautés de collemboles, organismes de mésofaune abondante dans les sols forestiers. En 2018, nous avons échantillonné la litière et le sol (0 à 10 cm de profondeur) à 8 sites chaque dans un peuplement de peuplier faux-tremble défolié et non défolié. La mésofaune a été extraite avec la méthode Tullgren et 728 collemboles ont été triés et identifiés à l'espèce. La défoliation due à la livrée des forêts n'a pas eu d'effet significatif sur l'abondance (individus cm-2) ou la diversité Shannon en comparaison au peuplement non défolié, mais elle a modifié la composition de la communauté des collemboles. Nous avons noté une disparition des espèces Folsomia nivalis (euedaphique) et Anurophorus sp1 (hémiedaphique) dans les sites défoliés, contrairement à l'espèce Lepidocyrtus sp1 qui était moins sensible. Ce changement en composition pourrait refléter un changement dans la disponibilité de ressources alimentaires, car une diminution dans la biomasse microbienne et une modification de la composition microbienne a été observée dans les mêmes sols échantillonnés dans le peuplement défolié. Nos résultats suggèrent que les épidémies répercutent sur les communautés du sol, même quelques années après le pic de l'épidémie de la livrée.
Mots-clés: écologie forestière, biodiversité, défoliation, livrée des forêts, peuplier faux-tremble, collemboles
14 - Au gré des saisons: variations temporelles des patrons de sélection d'habitat à fine échelle spatiale de la martre d'Amérique
Julie-Pier Viau
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAR)
Autres auteurs
- Daniel Sigouin (Parcs Canada)
- Martin-Hugues St-Laurent (CEF, UQAR)
Balcon Orford - 16h30
L'aménagement intensif des forêts a entraîné une simplification de la structure interne des peuplements forestiers, une situation préoccupante considérant que certaines espèces, comme la martre d'Amérique (Martes americana), sont associées aux structures forestières complexes. Le maintien et la restauration de ces caractéristiques d'habitat sont considérés comme essentiels pour la conservation de cette espèce et nécessitent une compréhension fine de ses patrons de sélection d'habitats. Bien que plusieurs études aient documenté les relations entre la martre et les caractéristiques structurelles des forêts, peu d'entre elles ont évalué la variation temporelle de ces relations. Ainsi, notre projet de recherche visait à étudier les patrons de sélection d'habitats de la martre d'Amérique à fine échelle spatiale (4e ordre de Johnson) durant deux périodes annuelles contrastées (sans neige, du 1er mai au 14 novembre, et avec neige, du 15 novembre au 31 avril). Nous avons utilisé la télémétrie GPS pour identifier les lieux visités par les martres dans le Parc National Forillon et dans les secteurs adjacents. À l'aide des fonctions de sélection des ressources, nous avons comparé les caractéristiques de l'habitat rencontrées aux sites utilisés (localisations GPS) à celles d'un nombre égal de sites disponibles (points aléatoires) distribués dans les domaines vitaux individuels saisonniers des martres suivies. L'habitat a été caractérisé à l'aide de relevés de végétation. Nos résultats ont montré que les martres sélectionnaient des caractéristiques d'habitat associées à la disponibilité des proies, à l'évitement des prédateurs et aux contraintes de thermorégulation, mais que ces caractéristiques spécifiques différaient d'une période à l'autre. Nos résultats soulignent l'importance de considérer l'échelle temporelle lors de l'étude des patrons de sélection d'habitats et contribueront à orienter les mesures de gestion forestière et de conservation afin d'harmoniser les pratiques d'aménagement du territoire aux besoins de la martre.
Mots-clés: aménagement, biologie de la conservation, écologie forestière, écologie spatiale, faune, habitat
15 - Les feux de forêt dans le paysage culturel d’Eeyou Istchee chez les utilisateurs cris du territoire de Nemaska et Wemindji
Guillaume Proulx
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Hugo Asselin (CEF, UQAT)
Parterre Orford - 16h30
Les incendies forestiers sont une source récente de danger pour les populations et les infrastructures d’Eeyou Istchee, le territoire traditionnel cri dans le nord-ouest du Québec. Les transformations socioéconomiques et écologiques régionales des 50 dernières années a modifié l’exposition des infrastructures matérielles et immatérielles cries aux feux. Des conditions météorologiques favorables à des feux plus fréquents et plus sévères sont à prévoir d’ici 2050 avec un changement de la composition forestière. Un des premiers objectifs de ma thèse de doctorat vise à comprendre les relations entre les feux de forêt, le territoire et les Cris d’Eeyou Istchee afin d’évaluer le risque lié à l’évolution de l’aléa dans la forêt non commerciale. Une série d’entretiens semi-dirigés a été menée auprès d’utilisateurs du territoire et de Tally-personnes des communautés de Nemaska et de Wemindji durant l’été 2022. Les personnes répondantes ont discuté de leurs expériences d’épisodes d’incendies, des savoirs écologiques liés aux feux et de leur perception de la gestion des incendies forestiers. Les résultats préliminaires de l’analyse thématique du contenu exprimé permettent de dégager un paysage culturel où se mêlent les récits passés, les multiples services écosystémiques et culturels rendus par les incendies et les inquiétudes face à l’avenir. La vulnérabilité face aux incendies est changeante, puisque le passage d’un mode de vie dépendant des cycles de trappe, de chasse, de pêche et de cueillette vers une vie plus sédentaire a exposé de nouvelles infrastructures immobiles. Des pratiques traditionnelles d’aménagement de la forêt sont mobilisées pour protéger certains lieux, mais les mégafeux sont une source d’inquiétude importante puisqu’ils sont à la fois récents et très perturbateurs. L’identification d’un paysage culturel nous permet de mieux évaluer l’évolution future de la vulnérabilité liée à un régime de feu changeant.
Forest fires are a recent source of danger for the populations and infrastructure of Eeyou Istchee, the Cree traditional territory in northwestern Quebec. Regional socio-economic and ecological transformations over the past 50 years have altered the exposure of Cree tangible and intangible infrastructure to fire. Weather conditions favorable to more frequent and severe fires are expected by 2050 with a change in forest composition. One of the objectives of my doctoral dissertation is to understand the relations between forest fires, the land and the Crees of Eeyou Istchee, in order to assess the risk associated with the evolution of the hazard in the non-commercial forest. A series of semi-structured interviews were conducted with land users and Tallypersons in the communities of Nemaska and Wemindji during the summer of 2022. Respondents discussed their experiences of fire episodes, fire-related ecological knowledge, and their perceptions of forest fire management. Preliminary results from the thematic analysis of expressed content
Mots-clés: feu de forêt, paysage culturel, savoir écologique traditionnel, entretien semi-dirigé, cri, eeyou istchee
16 - Les ressources et habitudes alimentaires du Grand Pic sont influencées par l'utilisation des terres en forêt Boréale
Eve-line Bérubé-Beaulieu
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAM)
small email
Autres auteurs
- Alain Leduc (CEF, UQAM)
- Philippe Cadieux (CEF, UQAM)
- Pierre Drapeau (CEF, UQAM)
Balcon Orford - 16h50
Le Grand Pic est considéré comme une espèce clé de voûte puisque ses cavités sont essentielles pour plusieurs espèces. Les activités anthropiques fragmentent son habitat et ciblent les forêts matures dont il dépend, ce qui peut perturber ses activités. Très peu de connaissances sont disponibles à propos de l'impact de différentes utilisations des terres sur i) la densité de ressources alimentaires (arbres sénescents de grand diamètre) et ii) les caractéristiques des peuplements et des arbres plus fortement utilisés pour l'alimentation. Nous anticipions que les paysages forestiers dominés par la coupe ou l'agriculture présenteraient moins de ressources et seraient moins utilisés, et que les caractéristiques des arbres sélectionnés seraient similaires d'un paysage à l'autre. Nous avons caractérisé systématiquement les arbres et les traces d'alimentation sur des transects placés dans différents types d'habitats en forêts boréales. Ces inventaires nous indiquent que les conditions à l'échelle du paysage sont nettement plus propices à l'alimentation dans les forêts conservées que dans les paysages perturbés, en particulier en zone agricole. Dans les peuplements résiduels, on observe la même tendance à un niveau moins important. La réponse du Grand Pic est cohérente avec ces observations, s'alimentant très peu en forêts entourées d'agriculture, peu dans les séparateurs de coupe et fortement dans les zones conservées. Les critères de sélection des arbres d'alimentation ne sont pas modifiés par les caractéristiques du paysage. Ces résultats suggèrent que la fragmentation des forêts matures est un facteur influençant fortement la densité et la présence du Grand Pic en forêt boréale et que ses critères de sélection alimentaires sont assez rigides. En comparant des paysages perturbés à des forêts protégées ayant été très peu étudiées dans le passé, notre étude offre un référent naturel précieux et un témoin utile pour la conservation des excavateurs primaires.
Mots-clés: écologie forestière, biologie de la conservation, coupes forestières, agriculture, fragmentation de l'habitat, forêts résiduelles, cavités d'alimentation
17 - La gouvernance partagée pour la gestion des aires protégées: une avenue possible pour améliorer les pratiques de gestion?
Andréanne Girard-Lemieux
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, Université Laval)
Autres auteurs
- Jean-Michel Beaudoin (CEF, Université Laval)
- Louis Bélanger (CEF, Université Laval)
- Pauline Suffice (CEF, Université Laval)
Parterre Orford - 16h50
Les récents efforts de conservation et le processus de réconciliation avec les communautés autochtones ont permis de nouvelles opportunités de conservation en collaboration avec les communautés. Cependant, le phénomène est relativement nouveau et considérant la diversité et la richesse des cultures des peuples autochtones, force est de constater un manque de connaissances pour mettre en place des projets répondant réellement à leurs aspirations. Il apparait donc essentiel de documenter un plus grand nombre d'initiatives afin de déterminer les facteurs de succès pour la mise en place d'aires protégées misant sur une collaboration entre des acteurs autochtones et non-autochtones.
Une revue de la littérature systématisée a été effectuée pour documenter les initiatives de conservation dans quatre pays similaires au Canada.
Les résultats de la revue de la littérature suggèrent que les éléments contextuels, notamment une meilleure reconnaissance des droits des peuples autochtones, sont une part très importante du succès des aires protégées cogouvernées. Des relations positives entre les peuples autochtones, l'État et les autres acteurs du territoire sont également un facteur essentiel. Enfin, les mécanismes et la structure de gouvernance doivent correspondre aux intérêts, valeurs et besoins des communautés qui participent aux projets de conservation afin de faire durer les projets dans le temps. Pour compléter ce portrait, des groupes de discussion ont été menés auprès des membres de la communauté innue de Pessamit et des employés de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka, deux organisations qui travaillent en collaboration pour la gestion de la réserve de biodiversité Uapishka.
Considérant les nombreux succès de ces initiatives et les bénéfices qu'elles apportent tant aux communautés autochtones qu'aux organisations et à la population non-autochtones, les professionnels de la conservation auraient tout intérêt à envisager de telles collaborations pour les aires protégées du Québec et du Canada.
Mots-clés: gouvernance, autochtone, aire protégée
18 - First characterization of the trophic structure and biodiversity of esker lakes
Akib Hasan
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Miguel Montoro Girona (CEF, UQAT)
- Louis Imbeau (CEF, UQAT)
- Jennifer Lento (Department of Biology, Canadian Rivers Institute, University of New Brunswick)
- Anouschka R Hof (Resource Ecology Group, Wageningen University)
- Guillaume Grosbois (CEF, UQAT)
Balcon Orford - 17h10
Eskers are complex geological formation that provide crucial resources in northern countries such as drinking water, sand/gravel, outdoor recreational sites, and productive forests. However, there is a huge knowledge gap about the biodiversity and functioning of eskers. Esker lakes are different from other boreal lakes as they are mainly fed by groundwaters and precipitations and are naturally not connected to other aquatic ecosystems. Thus, esker lakes should have reduced or absent fish communities, which should promote abundant of aquatic invertebrates and diverse waterbird community. This research aims to characterize the waterbird communities associated to esker lakes and characterize the resources such as fish and aquatic invertebrate that determine waterbird presence, abundance, richness, and diversity using a food web approach. Fifty lakes were sampled including lakes situated on eskers and lakes on the clay belt in Abitibi. We found higher Shannon diversity index for waterbirds in clay lakes (mean ± standard deviation = 1.07 ± 0.44) compared to esker lakes (0.72 ± 0.24). Shannon diversity index of invertebrates is also higher in clay lakes (1.31 ± 0.46), compared to esker lakes (1.24 ± 0.36). For fish, the index value in clay lakes (0.93 ± 0.29) was higher than lakes on esker (0.37 ± 0.30). Additionally, nutrient concentrations, conductivity and macrophyte cover were higher in clay lakes than in esker lakes contrary to dissolved oxygen saturation. The result suggests that the diversity of esker lakes is lower in all trophic level of the food web but provide habitat to few rare and important communities. This project represents the first characterization of biodiversity associated to esker lakes and will therefore, provide the baseline ecological information necessary to establish conservation strategies for this vulnerable ecosystem.
Mots-clés: biodiversité, faune, aquatic food web, waterbird, invertebrate, fish, esker lakes
19 - Reforestation en contexte communautaire, quelle stratégie choisir pour maximiser la séquestration de carbone?
Katia Forgues
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, Université McGill)
Autres auteurs
- Brais Marchena (Smithsonian Tropical Research Institute)
- Catherine Potvin (CEF, Université McGill)
Parterre Orford - 17h10
La recherche suggère que le reboisement communautaire peut jouer un rôle important dans l'atténuation des changements climatiques tout en fournissant des avantages environnementaux et de subsistance. Cependant, il n'y a pas de comparaison directe entre le potentiel de captation de carbone de différents modèles de reboisement et leur pertinence en contexte communautaire. En évaluant quatre modèles de reboisement dans un contexte communautaire, nous comblons un fossé entre la théorie et l'action, facilitant ainsi la mise en œuvre de projets informés. Dans le cadre d'un projet mené depuis 14 ans au Panama, nous comparons des monocultures et des plantation mixtes de bois indigène, l'agroforesterie et la régénération naturelle avec plantation d'enrichissement. Nous utilisons des modèles mixtes linéaires pour comparer la captation de carbone et la survie de cinq espèces de bois indigènes et de sept espèces fruitières, ainsi que des analyses canoniques de redondance pour mesurer l'importance des caractéristiques de design, d'entretien et d'environnement en tant que variables explicatives. Au cours de la première décennie, les plantations en bois d'œuvre ont stocké environ 3x plus de carbone que l'agroforesterie et les plantations d'enrichissement (tCO2/ha moyen : 140, 40 et 53). En ce qui concerne l'espèce, Terminalia amazonia, a montré un stockage de carbone exceptionnel (209 kg/arbre) et pour les variables explicatives, le design a le plus fort pouvoir explicatif, suivi par l'entretien et les caractéristiques environnementales (31%, 14%, 2%). La plus grande menace pour le projet était le risque d'incendie qui a causé la mortalité dans plus de 2/3 des parcelles. Certains dommages ont été compensés par la repousse naturelle qui a représenté 34% du carbone total, mais les participants perçoivent généralement celle-ci comme de la mauvaise herbe. Ils avaient une forte préférence pour l'agroforesterie, en particulier le café (Coffea Sp.), une culture dont la valeur en carbone est négligeable. Nos résultats mettent en évidence les leçons à tirer, les compromis entre les objectifs de carbone et les objectifs communautaires et l'importance de la prévention et de l'atténuation des incendies.
Research suggests that community-based reforestation can play an important role in climate change mitigation while providing environmental and livelihood benefits. However, there lacks direct comparison between different reforestation design's carbon uptake potential and their relevance to community reforestation. By evaluating four reforestation designs in a community context, we bridge a gap between theory and action consequently facilitating informed project implementation. In a 14 years-old project in Panama, we compare native timber mixtures and monocultures, agroforestry, and natural regeneration with enrichment planting. We use Linear Mixed Models to compare carbon uptake and survival of 5 native timber and 7 fruit species and Redundancy Analyses to measure the importance of design, maintenance, and environmental characteristics as explanatory variables. In the first decade, timber designs stored roughly 3x more carbon than agroforestry and enrichment planting (mean tCO2/ha : 140, 40 and 53). For species, Terminalia amazonia, showed outstanding carbon storage (209 kg/tree) and for explanatory variables, design has the strongest explanatory power followed by maintenance and environmental characteristic (31%, 14%, 2%). The largest threat to the project was the risk of fire which caused mortality in more than 2/3 of the plots. Some damage was offset by natural regrowth which accounted for 34% of the total carbon, but the participants generally perceived natural regrowth as "dirty". They had a strong preference for agroforestry, particularly coffee (Coffea Sp.), a crop with negligible carbon value. Our results highlight lessons, tradeoffs between carbon and community goals and the importance of fire prevention and mitigation."
Mots-clés: foresterie sociale, autochtones, séquestration de carbone, science participative
20 - Régénération du thuya occidental : est-ce que le cerf de Virginie court-circuite l'effet de la formation de trouées?
Olivier Villemaire-Côté - ANNULÉE
Étudiant(e) au doctorat (CEF, Université Laval)
Autres auteurs
- Jean-Claude Ruel (CEF, Université Laval)
- Jean-Pierre Tremblay (CEF, Université Laval)
PDF non disponible
Balcon Orford - 08h30
La dynamique des trouées peut jouer un rôle crucial dans la régénération forestière en créant des niches favorables pour la germination et la croissance de certaines plantes. Certains facteurs comme le broutement par les ongulés peuvent par contre limiter, voire éliminer, la régénération amenée par la formation de trouées. Les effets délétères du broutement peuvent d'ailleurs être exacerbés pour des espèces à croissance lente comme le thuya occidental (Thuja occidentalis L.), un arbre fortement sélectionné par le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus Z.) et vivant un déclin sur une bonne partie de son aire de répartition. Nous avons donc cherché à comprendre si et comment le broutement par le cerf et la dynamique des trouées interagissent et affectent la régénération du thuya. Nous avons émis l'hypothèse que la régénération du thuya bénéficierait de la formation de trouées, mais que le broutement par le cerf pourrait neutraliser cet effet. Nous avons inventorié des trouées naturelles le long d'un gradient spatiotemporel d'utilisation de l'habitat par le cerf. Nous avons évalué l'abondance de la régénération de thuya, la hauteur des arbres et de multiples métriques de trouée, de peuplement et de compétition. Nous avons constaté que la pression de broutement limitait grandement la régénération de thuya. Malgré tout, lorsque les populations de cerfs diminuaient, la régénération de thuya augmentait en moins d'une décennie et continuait d'augmenter dans le temps malgré une pression de broutement prolongée. Notre étude illustre que la régénération du thuya peut être favorisée par la formation de trouées et le contrôle des populations de cerf.
Mots-clés: écologie forestière, faune, thuya occidental, herbivorie, régénération, dynamique des trouées
21 - Suivi et modélisation de la dynamique structurelle des forêts perturbées avec les données de LiDAR aéroporté
Victor Danneyrolles
Postdoc (CEF, Université de Sherbrooke)
Autres auteurs
- Yan Boucher (CEF, UQAC)
- Richard Fournier (CEF, Université de Sherbrooke)
- Osvaldo Valeria (CEF, UQAT)
Parterre Orford - 08h30
Les forêts boréales sont affectées par de multiples perturbations naturelles et humaines. On s'attend aussi à ce que les taux des perturbations naturelles telles que les feux ou les épidémies d'insecte augmentent dans les prochaines décennies avec les changements climatiques. Dans ce contexte, la capacité de ces forêts perturbées à se régénérer, à croître et à continuer à fournir des services écosystémiques essentiels soulève de sérieuses inquiétudes. Malgré l'importance des enjeux, il existe pourtant un manque de connaissances concernant le développement de ces forêts issues de perturbations, notamment à cause de la difficulté à mettre en place un suivi généralisé sur le terrain. La disponibilité de données de LiDAR aéroporté pour l'ensemble du Québec méridional procure une source d'informations inestimable pour mettre en place un suivi de l'état des forêts après perturbations, et c'est donc l'objectif général que notre équipe de recherche s'est donné. Plus précisément, l'approche proposée consiste à coupler les caractéristiques structurelles mesurées à une date donnée par le LiDAR, avec les données spatiales d'historiques de perturbations (c.à.d. feux, coupes). Il devient alors possible de modéliser les caractéristiques structurelles mesurées par le LiDAR comme fonction du temps écoulé depuis la dernière perturbation et des variables environnementales clefs influençant la structure des forêts (par ex.: climat, topographie). Dans cette présentation, nous illustrerons différentes applications et résultats obtenus à partir de cette approche. Dans un premier temps, nous présenterons un modèle prédictif de l'effet de l'augmentation des températures sur la croissance en hauteur des forêts après coupe. Dans un deuxième temps, nous montrerons comment ces données peuvent être utilisées pour comparer la croissance des forêts après feux et après coupes. Finalement, nous discuterons de l'implication de ces résultats pour l'aménagement durable des forêts boréales.
Mots-clés: écologie forestière, historique des perturbations, croissance, regeneration, feux, coupes, télédétection
22 - Les propriétés biochimiques des sols associés aux érablières envahies par le hêtre à grandes feuilles diminuent la tolérance de l'érable à sucre au stress hydrique
Audrey Maheu
Chercheur(e) régulier(ère) au CEF (CEF, UQO, Institut des Sciences de la Forêt Tempérée (ISFORT))
Autres auteurs
- Claudele Ghotsa Mekontchou (CEF, UQO, Institut des Sciences de la Forêt Tempérée)
- Francesca Sotelo (Institut des Sciences de la Forêt Tempérée)
- Philippe Nolet (CEF, UQO, Institut des Sciences de la Forêt Tempérée (ISFORT))
- David Rivest (CEF, UQO, Institut des Sciences de la Forêt Tempérée)
Parterre Bellevue - 08h30
Les forêts tempérées québécoises, dominées par l'érable à sucre (ERS), sont actuellement confrontées au phénomène de prolifération du hêtre à grandes à feuilles (HEG) et à des stress hydriques de plus en plus fréquents et intenses. Cependant, les connaissances des effets combinés de ces stress sur la croissance et la survie des semis d'ERS restent limitées. Nous émettons l'hypothèse que les propriétés biochimiques des sols associés aux peuplements dominés par les gaules de HEG conduisent à une plus faible tolérance des semis d'ERS à la sécheresse comparativement à celles des sols des peuplements non dominés. Des échantillons de sols ont été collectés dans des peuplements d'ERS dominés (trois) et non dominés (trois) par les gaules de HEG. Les sols ont ensuite été subdivisés en six traitements de condition de sol dont deux pour les peuplements non dominés (stérilisé et non-stérilisé, i.e. témoin), et quatre pour les peuplements dominés (stérilisé avec et sans litière de HEG, témoin avec et sans litière). Chacune des combinaisons entre le type de peuplement et le traitement de condition du sol ont été répétés six fois dont trois soumis au stress hydrique formant un total de 108 pots où un semis d'ERS a été cultivé en serre pendant une saison de croissance. Sur les sols associés aux peuplements dominés, le stress hydrique a réduit de 6 et 12 fois la croissance en hauteur des semis d'ERS dans les sols non-stérilisés et stérilisés, respectivement. Sur les sols associés aux peuplements non dominés, le stress hydrique a réduit de 2 et 6 fois la croissance en hauteur des semis d'ERS dans les sols non-stérilisés et stérilisés, respectivement. Ces résultats suggèrent qu'autant le microbiome que les propriétés chimiques des sols associés aux peuplements dominés par les HEG peuvent contribuer à diminuer la tolérance des semis d'ERS au stress hydrique.
Mots-clés: écologie forestière, physiologie, effets multi-stress, tolérance à la sècheresse, hêtre à grandes feuilles, érable à sucre, changement climatique
23 - Quand le loup n'est pas là : modélisation de la dynamique de la population d'orignaux du Parc National Forillon en Gaspésie
Louana Tassi
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAR, Centre d'études nordique (CEN))
Autres auteurs
- Pierre Etcheverry (Parcs Canada)
- Martin-Hugues St-Laurent (CEF, UQAR, Centre d'études nordique (CEN))
Balcon Orford - 08h50
Les grands herbivores jouent un rôle clé au sein de la plupart des écosystèmes forestiers. Lorsque la population n'est plus régulée par un ou plusieurs facteurs (p. ex. en absence de prédateur), ils peuvent devenir surabondants et altérer la composition et la structure des communautés végétales. Dans ce contexte, notre étude visait à 1) identifier les facteurs (et leurs interactions) qui régissent la dynamique d'une population d'herbivores à haute densité, vivant dans un milieu protégé (c.-à-d. sans prélèvement ni aménagement forestier) où le prédateur majeur est absent, 2) développer un modèle prédictif de dynamique des populations adapté à un tel système. Nous avons utilisé l'orignal (Alces alces americana) comme espèce focale. À l'aide des données d'inventaire d'orignaux récoltées entre 1982 et 2022 dans le Parc National Forillon (Gaspé, Est-du-Québec), nous avons construit un modèle de dynamique des populations qui inclut les principaux facteurs limitants susceptibles d'influencer la trajectoire démographique de la population (c.-à-d. prédation, chasse, parasitisme, compétition intraspécifique et climat). Nous avons employé la technique du "Pattern-oriented modeling" pour ajuster les valeurs de nos paramètres. Le modèle ainsi calibré s'avère efficace pour représenter les fluctuations d'abondance observées chez l'orignal dans notre aire d'étude. Nos résultats montrent que l'épaisseur de neige au sol en hiver est le facteur expliquant la plus grande part de la variabilité dans l'effectif de la population. La prédation opportuniste (exercée par l'ours et le coyote), la chasse sportive en périphérie du parc ainsi que la quantité de nourriture disponible semblent avoir peu d'influence sur la dynamique de cette population d'orignaux. En plus d'aider à expliquer les variations d'abondance passées observées au Parc Forillon, ce modèle permettra de projeter les changements potentiels de la taille de la population d'orignaux dans le futur, dans une optique de gestion de l'aire protégée.
Mots-clés: dynamique des populations, biologie de la conservation, aire protégée, alces alces americana, modèle, forêt
24 - Automated identification of tree species using deep learning and drone imagery in a deciduous forest
Myriam Cloutier
Étudiant(e) à la maîtrise (Université de Montréal)
Autres auteurs
- Etienne Laliberté (Université de Montréal)
- Mickaël Germain (Université de Sherbrooke)
Parterre Orford - 08h50
The use of drones and remote sensing is booming in ecology and conservation. Combining these technologies with deep learning could allow researchers to map biodiversity in large or inaccessible places. The use of deep learning is still quite recent, and models for different plant ecosystems have not yet been developed. We aimed to develop a functioning deep learning model to classify temperate forest canopies at the species level using remote sensing imagery. Using multitemporal data, we would expect imagery from the fall to improve the model's performance due to tree species taking on more distinct colours in the fall. With a drone, we acquired high-resolution RGB imagery over 43 hectares of temperate forest on 7 different occasions between May and October 2021 in the Laurentides. We used the images to generate orthomosaics and annotated 15 different classes on those orthomosaics, resulting in over 20 000 annotated tree crowns. We used the annotated imagery to train a Convolutional Neural Network (CNN) that could be used to classify tree crowns on new imagery.
We trained a CNN with a sample of the dataset and it had an overall accuracy of 64%. The model was most efficient at predicting the pixels corresponding to Pinus strobus L., Betula papyrifera Marshall and Populus grandidentata Michaux, while Acer rubrum L., Acer pensylvanicum L. and Picea A. Dietrich had a lower score. We believe the predictions can be improved by adjusting the weight of the pixels on the edge of the annotations, considering the blurry contours of tree crowns. The use of remote sensing imagery and deep learning to identify species can lead to a better understanding of plant ecosystems. This method can be customized for a multitude of different uses, such as detecting invasive plants, measuring vegetation cover, or detecting diseased plants.
Mots-clés: biodiversité, écologie forestière, imagery, deep learning, remote sensing, temperate forest
25 - Spatial heterogeneity of climate and stand factors modulate the growth of sugar maple (Acer saccharum Marsh.) trees in eastern Canada
Emmanuel Amoah Boakye
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Yves Bergeron (CEF, UQAM)
- Martin Girardin (Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Laurentian Forestry Centre)
Parterre Bellevue - 08h50
Sugar maple (Acer saccharum Marsh.) is native to eastern North American hardwood forests, where it provides a variety of ecosystem services such as litter to improve soil fertility, fuelwood for heating, food for wildlife, raw material for maple syrup production, high-quality wood for infrastructure, and spectacular foliage colors. However, rising temperatures and changes in precipitation and their effects on tree growth rates have raised concerns about the species’ ability to thrive and provide ecosystem services in the future. Using 1,675 tree-ring data, we investigated the basal area growth response of sugar maple trees to local climate and stand factors within the distribution range of eastern Canada. Generalized Additive Mixed Model (GAMM) was used to relate tree-ring basal area increment data to tree age, size, competition index, terrain altitude, slope, and long-term averages of local seasonal climate variables. An examination of GAMM-predicted basal area growth rates shows that the rate of basal area growth decreased over time between 1950 and 2020. Furthermore, it was observed that the basal area growth was inversely related to terrain altitude, slope and the competition index. We observed that the number of frost days in spring, vapour pressure deficit in summer and minimum temperature in autumn related negatively to basal area growth rate. Our findings suggest that the decline in sugar maple growth is not uniform across eastern Canada, implying that local and regional tree growth responses to climate can differ. Further research will consider the genetic makeup of individual trees, as it controls the mechanisms by which trees respond to climate and utilize environmental resources.
Mots-clés: écologie forestière, aménagement
26 - La fin du chemin : Réponses à court terme d'une communauté de grands mammifères au démantèlement de chemins forestiers
Rebecca Lacerte
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAR)
Autres auteurs
- Martin-Hugues St-Laurent (CEF, UQAR)
- Mathieu Leblond (Environnement Canada)
Balcon Orford - 09h10
Au Canada, le démantèlement des structures anthropiques linéaires, tel que les chemins forestiers, est considéré comme un outil prometteur pour restaurer l'habitat des populations menacées de caribou boréal (Rangifer tarandus caribou). Ce démantèlement a pour but de réduire la disponibilité de la nourriture pour les proies alternatives et de diminuer les probabilités de rencontre avec les prédateurs. À l'aide de 232 caméras automatisées disposées sur 40 km de chemins forestiers démantelés, nous avons suivi l'utilisation de ces chemins par les caribous, les loups gris (Canis lupus), les ours noirs (Ursus americanus) et les orignaux (Alces americanus) 1 à 3 ans après la restauration. Nous avons comparé quatre traitements additifs (c'est-à-dire que chaque traitement successif incluait le traitement précédent) : 1) fermeture du chemin à la circulation, 2) décompaction du sol, 3) plantation d'épinettes noires (Picea mariana) et 4) ajout de terre enrichie. Nous avons évalué l'influence des traitements, de l'utilisation par d'autres grands mammifères et des caractéristiques du milieu environnant sur l'utilisation des chemins par les quatre espèces. Les caribous ont utilisé le traitement planté (qui comprenait également la fermeture et la décompaction) davantage que le traitement fermé seulement. Les traitements n'influençaient pas l'utilisation des chemins par les ours et les orignaux. L'utilisation par les loups n'a pas pu être évaluée en raison de peu d'observation de loups dans l'aire d'étude. L'utilisation des chemins démantelés par les caribous, les ours et les orignaux a également été influencée par l'utilisation par les autres grands mammifères ainsi que par les caractéristiques du milieu environnant. Nos résultats suggèrent que le traitement combinant la fermeture des chemins, la décompaction du sol et la plantation d'arbres pourrait être bénéfique pour les caribous, et soulignent la pertinence d'inclure des efforts de restauration active dans les programmes de rétablissement de l'espèce.
Mots-clés: aménagement, faune, caribou, restauration, chemins forestiers, démantèlement
27 - The influence of tree composition and diversity on carbon storage: combining field and airborne hyperspectral data
Christine Wallis
Postdoc (CEF, Université de Sherbrooke)
Autres auteurs
- Anna Crofts (CEF, Université de Sherbrooke)
- Deep Inamdar (CEF, Université McGill)
- J. Pablo Arroyo-Mora (Conseil national de recherches Canada)
- Margaret Kalacska (CEF, Université McGill)
- Étienne Laliberté (CEF, Université de Montréal)
- Mark Vellend (CEF, Université de Sherbrooke)
Parterre Orford - 09h10
Hyperspectral remote sensing permits modeling biomass and related ecosystem functions such as productivity and carbon (C) content. However, it is not fully understood which canopy tree properties are captured by hyperspectral sensors when predicting ecosystem functions. Here, we use a structural equation model to examine the relationship between hyperspectral reflectance and aboveground C content in forests, testing the relative importance of tree composition and diversity in mediating this relationship. Spectral data covering visible (VIS), near infrared (NIR) and short-wave infrared (SWIR) wavelengths were extracted for 2626 tree crowns within 64 plots distributed in Parc national du Mont Mégantic and Parc national du Mont-Saint-Bruno. We calculated two spectral predictors of C content: (i) spectral composition (the dominant reflectance per plot), and (ii) spectral diversity. From field data we calculated variables characterizing the taxonomic, functional and phylogenetic composition and diversity of canopy trees as well as C content using allometric equations. We found that spectral composition, particularly from the VIS, is related to C content largely indirectly, via changes in taxonomic, functional, and phylogenetic composition along the elevational gradient (a transition from deciduous to coniferous species with increasing elevation). Though spectral diversity was significantly related to tree species diversity, no direct or indirect effects on C content were detected. Overall, our findings support the hypothesis that the dominant spectral reflectance per plot (composition) is more important than spectral diversity for estimating C content, and that hyperspectral remote sensing data can be effectively used as a surrogate of taxonomic, functional, and phylogenetic composition of tree communities with strong links to C storage.
Mots-clés: écologie forestière, biodiversité, remote sensing, ecosystem functions, hyperspectral imaging, tree diversity, tree composition
28 - Caractérisation du microbiome racinaire de l'érable à sucre le long de deux gradients d'élévation
Joey Chamard
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, Université de Sherbrooke)
Autres auteurs
- Tonia DeBellis (Dawson College)
- Pierre-Luc Chagnon (CEF, Université de Montréal)
- Isabelle Laforest-Lapointe (CEF, Université de Sherbrooke)
Parterre Bellevue - 09h10
Les prévisions quant aux réchauffements climatiques vont modifier la distribution des populations végétales (GIEC, 2021). En fonction de ces projections, les espèces d'arbres telles que l'érable à sucre («Acer saccharum») risquent de migrer à la limite nord de sa distributions (Solarik et al., 2018). Néanmoins, des facteurs tels que les propriétés défavorables du sol, la disponibilité en symbiotes racinaires (Carteron et al., 2019), la dominance des plantes ectomycorhiziennes (Carteron, Vellend & Laliberté, 2022) pourraient limiter la migration des arbres dans de nouveaux environnements. Ici, nous avons étudié comment la diversité et la composition des communautés microbiennes racinaires de l'érable à sucre varient le long de deux gradients altitudinaux. Précisément, nous avons cherché à identifier (1) les facteurs déterminants qui structurent les communautés d’endophytes ; et (2) comment ces facteurs affectent la croissance et la santé des jeunes érables. Nous avons sélectionné au hasard 100 jeunes érables à sucre situés le long de deux gradients d'élévation (Mont Écho et Mont Saint-Joseph) et nous avons évalué la diversité végétale autour de chaque semis. Des échantillons foliaires, racinaires et de sol ont ensuite été prélevés afin de (1) évaluer les nutriments foliaires, (2) caractériser les communauté endophytiques (16S/ITS/AMF) et environnementales (AMF) à l'aide du séquençage d'amplicons Illumina MiSEQ et finalement (3) déterminer les paramètres édaphiques le long des gradients. Nos résultats démontrent que les communautés bactériennes et fongiques semblent varier davantage en fonction des paramètres du sol (pH et humidité) alors que les communautés endomycorhiziennes covarient davantage avec les communautés végétales environnantes. Nous avons observé une diminution significative du calcium et magnésium foliaires avec l’altitude aux deux sites, malgré une croissance positivement corrélée avec l’élévation. Bref, nos résultats démontrent que bien au-delà d’un gradient physico-chimique, les gradients altitudinaux arborent une diversité de microsites favorables ou non à l’établissement de l’érable à sucre.
Mots-clés: symbioses mycorhiziennes, écologie foresttère
29 - Explication de l'utilisation des structures linéaires par les prédateurs du caribou boréal ainsi que son compétiteur apparent.
Arnaud Benoit-Pépin
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Louis Imbeau (CEF, UQAT)
- Osvaldo Valeria (CEF, UQAT)
- Mariano Javier Feldman (CEF, UQAT)
Balcon Orford - 09h30
Au Québec, l'exploitation forestière accroît constamment le niveau de perturbation anthropique dans l'écosystème forestier. Ces perturbations rajeunissent la matrice forestière entrainant une modification de la densité et de la distribution des communautés fauniques au détriment de certaines espèces. Entre autres, l'implantation de structures linéaires dans le paysage est un facteur prépondérant du système prédateurs-proies affectant négativement le caribou en favorisant la réponse fonctionnelle et numérique de ses prédateurs. Notre objectif est d'expliquer par des facteurs locaux et du paysage comment l'intensité d'utilisation du loup, de l'ours noir, du lynx ainsi que du compétiteur apparent du caribou, l'orignal, varie sur différentes structures linéaires naturelles et anthropiques avec l'aide de caméras de surveillance. Dans le site faunique du caribou de Val-d'Or, une sélection aléatoire stratifiée des chemins gravelés et des chemins d'hiver de classe inférieure ainsi que du milieu riverain a été faite pour comparer leurs caractéristiques ainsi que l'intensité d'utilisation de ces espèces. Pour ces 4 grands mammifères, la différence du couvert latéral entre le milieu environnant et la structure linéaire explique principalement son niveau d'intensité d'utilisation. Pour le loup et le lynx, l'utilisation par leurs proies respectives (orignal, castor et lièvre) explique aussi l'intensité d'utilisation. La distance à un chemin forestier de classe supérieure affecte légèrement à la baisse l'intensité d'utilisation du loup et de l'ours tandis que le même patron se produit pour le lynx par rapport à la densité de chemins forestiers. Essentiellement, ce sont les chemins gravelés qui présentent l'intensité d'utilisation la plus élevée. Avec une intensité d'utilisation similaire entre les chemins d'hiver et le milieu riverain, nous recommandons que les efforts de restauration liés à la fermeture de chemins forestiers visent principalement les chemins gravelés présentant des conditions propices de différence du couvert latéral.
Mots-clés: faune, aménagement, prédateurs du caribou boréal, structures linéaires, caméras de surveillance, intensité d'utilisation, couvert latéral, aménagement forestier
30 - Linking hyperspectral imagery to canopy tree biodiversity: an examination of the spectral variation hypothesis along an elevation gradient in Quebec, Canada.
Anna Crofts
Étudiant(e) au doctorat (CEF, Université de Sherbrooke)
Autres auteurs
- Christine Wallis (CEF, Université de Sherbrooke)
- Etienne Laliberté (CEF, Université de Montréal)
- Mark Vellend (CEF, Université de Sherbrooke)
Parterre Orford - 09h30
Plants interact with light in unique and complex ways, where plant spectra (i.e., reflectance patterns) are driven by plant biochemical and biophysical properties, and therefore provide a means to study plant form and function. With ongoing and forecasted changes in species' composition and abundance, there is much interest surrounding the application of remotely sensed plant spectra, as acquired by hyperspectral imagers, to quantify plant biodiversity across large spatial extents. One approach, formalized as the spectral variation hypothesis, assumes that plant spectra are fundamental properties of plants and thus, variation in plant spectra should be a direct expression of variation in plant biodiversity. Here, we used hyperspectral imaging data from an airborne survey in combination with precisely geo-located field data on canopy trees to examine the spectral variation hypothesis along a climatic gradient spanning the temperate to boreal forest biomes in southern Québec. We first examine the degree of correspondence between spectral, taxonomic, and functional composition and diversity and then, compare how spectral, taxonomic, and functional composition and diversity respond to environmental gradients. Overall, we found weak support for the spectral variation hypothesis where spectral composition and diversity had low-to-moderate correspondence with taxonomic and functional composition (avg. r = ~0.5) and diversity (avg. r = ~0.3). The low-to-moderate magnitude of correspondence maybe driven by the apparent non-linear relationship between spectral and taxonomic/functional dimensions - beyond a point, increases in spectral diversity doesn't correspond with increases in the other diversity dimensions. However, despite the moderate correspondence, we found that spectral, taxonomic, and functional composition and diversity respond to environmental gradients in similar ways. We conclude that spectral composition and diversity are limited indicators of taxonomic/functional composition and diversity but there is promise in applying plant spectra to further our understanding of how tree composition and diversity vary spatially along environmental gradients.
Mots-clés: biodiversité, écologie forestière, biodiversity, remote sensing, hyperspectral imaging, spectral siversity
31 - Soil properties constrain forest understory plant distributions along a climatic elevational gradient
Ming Ni
Étudiant(e) au doctorat (CEF, Université de Sherbrooke)
Autres auteurs
- Mark Vellend (CEF, Université de Sherbrooke)
Parterre Bellevue - 09h30
Many plant species are predicted to migrate to higher elevations or latitudes in response to climate warming, but predictions come mostly from climate-only models, neglecting the influence of non-climatic factors, such as soil properties and dispersal limitation. Some macroecological studies have relied on soil data at much coarser spatial resolution than that experienced by plants. Studying plant distributions along elevational gradients can overcome such limitations by permitting detailed soil data to be collected, while still covering a wide climatic gradient. Here, we first report an intensive field survey of four spring forest plants and soil properties along an elevational gradient in southern Québec, Canada, testing the hypothesis that soil properties contribute to defining upper elevational range limits. We then report a seven-year transplant experiment with one species, Trillium erectum, testing the hypothesis that climate warming has already created suitable sites at high elevation, with its near-absence explained by dispersal limitation. In our field survey, we found that soil properties had substantial impacts on the occurrence or abundance of all four species, and that soil effects were more pronounced at higher elevations. For two species with very infrequent occurrences at high elevation (>950m), T. erectum and Claytonia caroliniana, microsites with high pH or nutrients appear to be important factors permitting occurrence at high elevation. After being transplanted to high elevation sites, T. erectum individuals grew to much smaller size with very little chance of flowering (<10%) compared to individuals at low or mid-elevations (>60% flowering), suggesting that non-climatic environmental factors rather than dispersal limitations have a major impact on the species range limit. Our study highlights the importance of soil properties in determining plant range limits. Unsuitable soils for plants at high elevations or latitudes may represent an important constraint on future plant migration.
Mots-clés: biodiversité, dynamique des populations
32 - Abaisser le taux de coupe pour atténuer les impacts des changements climatiques sur la qualité d'habitat du caribou forestier au Québec
Martin-Hugues St-Laurent
Chercheur(e) régulier(ère) au CEF (CEF, UQAR)
Autres auteurs
- Yan Boulanger (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Dominic Cyr (Environnement Canada)
- Francis Manka (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Pierre Drapeau (CEF, UQAM)
- Sylvie Gauthier (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
Balcon Orford - 09h50
Plusieurs populations de caribous forestiers (Rangifer tarandus caribou) ont décliné au Canada, une tendance liée à l'augmentation de l'empreinte anthropique et de la pression de prédation en découlant. Toutefois, l'influence des changements climatiques sur ces processus demeure peu étudiée. Nous avons évalué comment les changements climatiques affecteraient l'habitat du caribou forestier sur l'horizon 2000 - 2100 dans une aire d'étude de 9,9 Mha. Nous avons utilisé des simulations climatiques qui intègrent les changements de dynamique forestière et de régimes de feux liés au climat, ainsi que différents niveaux de récolte forestière, et avons évalué l'importance relative de ces facteurs sous différents scénarios de changements climatiques. La qualité d'habitat du caribou a été estimée à l'aide de fonctions de sélection des ressources s'appuyant sur les données télémétriques de 121 caribous, dans 7 populations, entre 2004 et 2011. Au début des simulations, l'habitat du caribou était déjà structuré le long d'un gradient sud-nord de qualité d'habitat. Nos simulations ont montré une modification du couvert forestier induite par les changements de régime de feux et par les différents niveaux de coupe, résultant en une perte de vieilles forêts résineuses et une augmentation des peuplements feuillus. Ces changements ont causé un déclin généralisé de la qualité moyenne de l'habitat du caribou et du pourcentage d'habitat de haute qualité. La coupe forestière était le principal moteur de changement d'ici 2050, bien qu'ensuite lentement remplacée par des changements du régime de feux. Nos résultats montrent clairement qu'il est possible de maintenir des habitats de qualité pour le caribou dans le futur suivant une réduction des volumes récoltés, le seul levier sous notre contrôle. Notre étude suggère que nous avons la capacité de concilier le développement économique et les impératifs de conservation du caribou face aux changements climatiques, un enjeu débattu dans l'ensemble de son aire de répartition.
Mots-clés: biologie de la conservation, faune, caribou des bois, changements climatiques, modélisation, perturbations humaines
33 - Conception d'un indice de suivi de l'état des écosystèmes riverains pour le Québec méridional : Unités spatiales et fonctions écologiques
Richard Fournier
Chercheur(e) régulier(ère) au CEF (CEF, Université de Sherbrooke)
Autres auteurs
- Meghana Paranjape (CEF, Université de Sherbrooke)
- Jérôme Théau (Université de Sherbrooke)
- Lucien Poncelet (Université de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech)
- Adrien Michez (Université de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech)
- Mathieu Varin (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO))
- Simon Magnan (Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques)
Parterre Orford - 09h50
Les écosystèmes riverains (ÉR) sont d'importants écotones qui remplissent de nombreuses fonctions écologiques (FÉ). La cartographie et le suivi de l'état des ÉR sont nécessaires pour leur gestion et leur conservation. L'objectif général de ce projet est de développer un Indice de Suivi de l'État des Écosystèmes Riverains (ISÉÉR) pour le Québec méridional, à partir de données géospatiales. Trois objectifs spécifiques ont été définis : (i) développer une approche de délimitation des écosystèmes riverains selon leurs dimensions longitudinales et latérales (ii) déterminer les métriques les plus adaptées pour mesurer l'intégrité des ÉR et (iii) combiner les métriques représentant les FÉ en un indice de suivi (ISÉÉR) pour le cartographier.
Des résultats préliminaires pour les objectifs 1 et 2 seront présentés. D'abord, les Unités Riveraines Écologiquement Cohérentes (URÉC) ont été développées en délimitant les dimensions longitudinales et latérales de façon hydrogéomorphologiquement cohérente basée sur le modèle Riparian Topographic Toolbox et les données des Unité Écologique Aquatique. Les bassins versant des rivières des Saults, Bulstrode, Jacques-Cartier, et aux Castors ont été sélectionnés comme sites d'étude. Aussi, quatre FÉ ont été sélectionnées pour déterminer l'état des ÉR, soit la connectivité du paysage, la régulation de la productivité des ER, la régulation de la température, et le maintien et la création d'habitat. Des métriques liées aux FÉ ont été tirées de la littérature, et ont été estimées avec des données géospatiales. Puis, des tests statistiques (corrélation de Pearson, analyse par composante principale) ont permis de faire une sélection des métriques les plus adaptées et optimales pour estimer les FÉ. Ces métriques sont combinées en un indice de FÉ (c'est-à-dire l'ISÉÉR) et validés avec l'Indice de Qualité des Bandes Riveraines (IQBR).
Mots-clés: écologie forestière, biologie de la conservation, écosystème riverain, fonction écologique, indice, unité spatiale, géomatique
34 - Nouveaux défis, nouvelle TRIAD : exploration d'un aménagement forestier combinant zonage et plantations fonctionnelles pour augmenter la résilience des forêts
Clément Hardy
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAM)
Autres auteurs
- Christian Messier (CEF, UQAM)
- Yan Boulanger (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Dominic Cyr (CEF, UQAM)
- Élise Filotas (CEF, TELUQ)
Parterre Bellevue - 09h50
L'aménagement forestier TRIAD a été proposé il y a 30 ans pour réconcilier conservation et exploitation des forêts en définissant à travers le paysage des zones protégées, des zones de production de bois intensives, et des zones de production extensive. Plus récemment, la littérature en écologie forestière a souligné l'importance d'augmenter la résilience des forêts aux conditions futures incertaines en maximisant leur diversité fonctionnelle. Dans cette perspective, nous avons revisité l'aménagement TRIAD pour y ajouter une composante d'adaptation : enrichir les zones extensives par des plantations permettant d'augmenter la diversité fonctionnelle. À l'aide du modèle LANDIS-II, nous avons simulé un paysage de 4 millions d'hectares en Mauricie au Québec sur un horizon de 150 ans selon quatre scénarios d'aménagement différents. Le scénario "TRIAD+++", consiste à appliquer des plantations dites fonctionnelles suite à des coupes dans les zones extensives de la TRIAD, se distinguant ainsi du scénario TRIAD "classique". Nous avons également simulé deux scénarios "statu quo" sans zonage, dont l'un comprenait des plantations "fonctionnelles". Nous avons mesuré l'évolution du volume marchand de bois, ainsi qu'un indice de résilience de la biomasse et de la diversité des forêts du paysage face à des perturbations naturelles influencées par les changements climatiques (feux, sécheresse et épidémie d'insectes). Nos résultats suggèrent que la nouvelle approche TRIAD+++ augmente la résilience des forêts aux perturbations simulées en comparaison aux autres scénarios. La TRIAD+++ a également permis d'atteindre un stock de bois récoltable plus stable que les autres scénarios. Cependant, le scénario statu quo avec plantations fonctionnelles a réussi à augmenter la résilience du paysage presque autant que la TRIAD+++. Il semble ainsi que l'approche de la TRIAD+++ a le potentiel de réaliser un compromis intéressant entre conservation, exploitation et adaptation des forêts. En contrepartie, l'industrie forestière devra s'adapter pour récolter un plus grand nombre d'essences.
TRIAD forest management was proposed 30 years ago to reconcile forest conservation and harvesting by defining protected areas, intensive timber production areas, and extensive production areas across the landscape. More recently, the forest ecology literature has emphasized the importance of increasing the resilience of forests to uncertain future conditions by maximizing their functional diversity. With this in mind, we revisited TRIAD management to add an adaptation component: enriching extensive areas with plantations to increase functional diversity. Using the LANDIS-II model, we simulated a 4 million hectare landscape in the Mauricie region of Quebec over a 150 year horizon under four different management scenarios. The "TRIAD+++" scenario consists of applying so-called functional plantations following harvesting in the extensive TRIAD zones, thus distinguishing it from the "classic" TRIAD scenario. We also simulated two "business as usual" scenarios without zoning, one of which included "functional" plantings. We measured changes in merchantable wood volume, as well as an index of resilience of forest biomass and diversity to natural disturbances influenced by climate change (fire, drought, and insect outbreak). Our results suggest that the new TRIAD+++ approach increases the resilience of forests to simulated disturbances compared to other scenarios. The TRIAD+++ also achieved a more stable harvestable wood stock than the other scenarios. However, the business as usual scenario with functional plantations was able to increase landscape resilience almost as much as TRIAD+++. Thus, it appears that the TRIAD+++ approach has the potential to achieve an interesting compromise between forest conservation, harvesting and adaptation. On the other hand, the forest industry will have to adapt to harvest a greater number of species.
Mots-clés: aménagement, écologie forestière, landis, triad, triade, résilience, diversité fonctionelle
35 - La phénologie de formation du bois: variabilité au sein d'une peuplement et conséquences pour la taille de l'échantillon
Roberto Silvestro
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAC)
Autres auteurs
- Qiao Zeng (Guangdong Open Laboratory of Geospatial Information Technology and Application, Guangzhou Institute of Geography, Guangdong Academy of Sciences, Guangzhou, PR China)
- Jean Daniel Sylvain (MFFP)
- Guillaume Drolet (MFFP)
- Valentina Buttò (CEF, UQAT)
- Isabelle Auger (MFFP)
- Maurizio Mencuccini (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Spain)
- Sergio Rossi (CEF, UQAC)
Balcon Orford - 10h40
Les arbres du même peuplement présentent des taux de croissance et des temps de formation du bois variés. Les facteurs qui expliquent ces différences sont encore méconnus, ce qui rend l'estimation de la dynamique de croissance une tâche compliquée, habituellement basée sur des raisons logistiques, plutôt que statistiques. Cette étude a exploré la variabilité de la phénologie du xylème dans 159 sapins baumiers (Abies balsamea (L.) Mill.) à la forêt Montmorency. Des microcarottes de bois ont été prélevées à chaque semaine d'avril à octobre 2018. Nous avons testé l'autocorrélation spatiale, la taille des arbres et les taux de production de cellules comme variables explicatives de la phénologie du xylème. Nous avons évalué les traits anatomiques des trachéides, la taille de l'échantillon et la marge d'erreur pour l'évaluation de la phénologie du bois à différents niveaux de confiance. La durée de la formation du xylème variait entre 40 et 110 jours, produisant entre 12 et 93 cellules. Aucun effet de la proximité spatiale ou de la taille des individus n'a été détecté sur les temps de la phénologie du xylème. Les arbres avec des taux de production de cellules plus élevés ont montré une saison de croissance plus longue et un bois moins dense en raison d'une taille moyenne de cellules plus élevée et d'un pourcentage de bois tardif plus faible. Un échantillon de 23 arbres a produit des estimations de la phénologie du xylème à un niveau de confiance de 95 % avec une marge d'erreur d'une semaine. Cette étude a mis en évidence l'énorme variabilité dans le temps de formation du bois des arbres au sein d'une peuplement. Nous soulignons la nécessité d'examiner soigneusement la taille de l'échantillon lors de l'évaluation de la phénologie du xylème afin de permettre une mise à l'échelle fiable et représentative de l'allocation du carbone des écosystèmes forestiers.
Mots-clés: écologie forestière, écophysiologie, croissance des arbres, taille de l'arbre, formation du bois, anatomie du bois, phénologie
36 - Biogéographie mondiale des traits fonctionnels des arbres
Elise Bouchard
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAM)
Autres auteurs
- Alain Paquette (CEF, UQAM)
- Eric Searle (Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry)
- Pierre Drapeau (CEF, UQAM)
- Jingjing Liang (Purdue University)
Parterre Orford - 10h40
La distribution mondiale des biomes forestiers s'explique étonnamment bien avec peu de variables climatiques, et cette transition d'un biome à l'autre s'accompagne généralement d'un gradient grandissant de richesse spécifique des pôles vers l'équateur. Toutefois, au-delà de ce dénombrement d'espèces, il existe peu d'information sur comment les stratégies adaptatives de ces espèces diffèrent le long des gradients environnementaux mondiaux, et pourquoi.
Nous avons voulu explorer ces questions en étudiant les variations de traits fonctionnels des arbres (densité du bois, surface spécifique foliaire et masse des graines) selon des contraintes climatiques et édaphiques à large échelle. Pour ce faire, nous avons rassemblé une base de données d'environ 167 000 placettes d'inventaires forestiers à l'aide du réseau "GFBi", dans lesquelles nous avons attribué des valeurs de traits fonctionnels aux espèces d'arbres à partir des données de "TRY".
À l'échelle mondiale, nos résultats montrent que la disponibilité en énergie est le gradient environnemental qui a la plus forte influence sur les traits. Cependant, le portrait diffère à l'échelle des biomes. La composition fonctionnelle de la forêt tropicale est généralement plus influencée par les précipitations et les propriétés du sol que par la disponibilité en énergie, alors que les forêts tempérées montrent le résultat inverse. Les forêts boréales présentent une plus grande variabilité dans leur réponse aux gradients environnementaux selon le trait étudié.
Finalement, les relations trait-environnement des communautés forestières sont modulées par des effets interactifs climatiques et pédologiques et peu d'entre elles sont consistantes à différentes échelles et biomes d'étude. Par conséquent, nous recommandons d'évaluer la sensibilité des traits fonctionnels des arbres aux changements environnementaux dans leur contexte géographique et en tenant compte de la complexité des liens entre les sols et le climat.
Mots-clés: écologie forestière, biodiversité, biogéographie, climat, traits fonctionnels, densité du bois, masse des graines, surface spécifique foliaire
37 - Effet de la prolifération du hêtre sur la transpiration de l'érable à sucre
Mamitiana Rasoanaivo
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQO, Institut des Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT))
Autres auteurs
- Claudele Ghotsa Mekontchou (CEF, UQO, Institut des Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT))
- Pascal Rochon (Institut des Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT))
- Philippe Nolet (UQO, Institut des Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT))
- Audrey Maheu (CEF, UQO, Institut des Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT))
Balcon Orford - 11h00
La formation de végétation récalcitrante de sous-bois peut limiter la régénération des arbres et, à long terme, modifier la composition, la succession et le bilan hydrique des forêts. Dans les forêts tempérées du sud du Québec (Canada), la prolifération du hêtre à grandes feuilles Fagus grandifolia dans les peuplements dominés par l'érable à sucre Acer saccharum est apparentée au phénomène de végétation récalcitrante. Avec une augmentation prévue de la sévérité et de la durée des sécheresses, une meilleure compréhension des effets de la prolifération du hêtre sur les flux hydriques est cruciale pour comprendre la trajectoire des forêts. L'objectif de cette étude était de comprendre comment la prolifération du hêtre influence l'utilisation de l'eau par les arbres. Nous avons comparé la transpiration i) des arbres de la strate supérieure (c'est-à-dire les érables à sucre) et ii) des gaules de la strate inférieure (c'est-à-dire le hêtre) dans des sites avec et sans sous-étage dominé par le hêtre. À chacun des six sites, nous avons mesuré la densité de flux de sève (Fd) de deux érables à sucre (DHP > 9 cm) et d'une gaule de hêtre (1 cm < DHP < 9 cm) à l'aide de capteurs de dissipation thermique pendant la saison de croissance. À l'échelle de l'arbre, le Fd des érables à sucre était significativement plus grand dans les sites dominés par le hêtre en comparaison aux sites témoins indiquant ainsi une plus grande consommation de l'eau par l'érable à sucre. A l'échelle du peuplement, la transpiration totale a varié entre 140 et 296 mm pour la période d'étude, sans différence significative entre les sites dominés par le hêtre et les sites témoins. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes régissant l'utilisation de l'eau par les arbres dans un contexte de prolifération du hêtre.
Mots-clés: écologie forestière, écophysiologie
38 - L’effet de la diversité sur la croissance individuelle des arbres: comment les espèces réagissent-elles à la diversité de leur voisinage?
Vanessa Di Maurizio
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAM)
Autres auteurs
- Eric Searle (CEF, UQAM, Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry)
- Alain Paquette (CEF, UQAM)
Parterre Orford - 11h00
On a largement démontré que les forêts plus diversifiées sont en moyenne plus productives. Mais, au-delà de l'effet observé à l'échelle de la communauté, qu'en est-il des espèces? Est ce que certaines espèces sont plus susceptibles de profiter de la diversité et ce, au détriment des autres? Bien que de plus en plus d'études s'intéressent à savoir comment la diversité influence la croissance des arbres à l'échelle du voisinage, le nombre d'espèces étudié est souvent trop faible pour savoir si les réponses sont similaires entre les espèces qui partagent les mêmes traits fonctionnels ou les mêmes stratégies d'histoire de vie. Il est généralement admis que des différences de traits fonctionnels entre les espèces permettent de mieux partager les ressources, mais étant donné que le potentiel de croissance et la compétitivité changent d'une espèce à l'autre, il est peu probable qu'elles bénéficient toutes également d'une augmentation de la dissimilarité de leur voisinage. Ainsi, notre étude vise à comprendre (1) comment les différentes espèces réagissent à la dissimilarité de leur voisinage et (2) s'il est possible de dégager des patrons de réponses similaires en fonction des différents types d'espèces. À partir des données de croissance du vaste réseau de placettes permanentes du Québec et des traits fonctionnels des espèces, nous avons analysé les réponses des 19 espèces les plus abondantes de la forêt tempérée et de la forêt boréale. Nos résultats montrent que la plupart des espèces réagissent positivement à la dissimilarité de leur voisinage, mais que la force de cette relation change d'une espèce à l'autre. Néanmoins, certaines espèces réagissent négativement à la dissimilarité de leur voisinage et d'autres sont simplement indifférentes à celle-ci. Nos résultats permettent ainsi de mieux caractériser la relation entre espèces voisines, laquelle est sous-jacente à la relation diversité-productivité observée à l'échelle de la communauté.
Mots-clés: écologie forestière, biodiversité, dissimilarité, diversité, croissance individuelle, variabilité interspécifique, traits fonctionnels, stratégies d'histoire de vie, analyse de voisinage
39 - The early bud gets the cold: spring phenology drives exposure to late frost
Claudio Mura
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAC)
Autres auteurs
- Valentina Buttò (CEF, UQAT)
- Roberto Silvestro (CEF, UQAC)
- Annie Deslauriers (CEF, UQAC)
- Guillaume Charrier (Institut national de la recherche agronomique (INRAE), UMR Laboratoire de Physique et Physiologie intégratives de l'Arbre en environnement Fluctuant (PIAF, France))
- Patricia Raymond (MFFP)
- Sergio Rossi (CEF, UQAC)
Balcon Orford - 11h20
Under climate change, the increased occurrence of late frost combined to earlier bud break could increase the risk of frost damages on developing buds and leaves, affecting tree productivity. Tree populations can exhibit large variability in their bud break phenology, and consequently different potential risks of exposure to late frosts. This study analyzed the effects of the late frost occurring in May 2021 in Quebec on flushing buds. We measured frost damages in a common garden of black spruce (Picea mariana L. Karst) in Simoncouche (48°12' N, 71°14'W), QC, Canada. The common garden has 371 trees planted in 2014, originating from 5 different provenances located along a latitudinal gradient between 48 and 53° N. Phenological measurements of bud break were performed every year since 2015, including the time of frost occurrence in 2021. Temperatures <0°C occurred between 28 and 30 May, reaching a minimum of -1.9°C. Frost damages were assessed by the proportion of damaged buds on each tree. At the time of frost occurrence, the percentage of trees that completed their bud break varied from 0% for the southernmost to 63.4% for the northernmost provenance. The percentage of trees showing frost damages varied from 60% in the southernmost to 100% in the northernmost. Severe damage occurred more frequently in northern provenances. Overall, we found a correlation between bud break and frost damage, with the highest probability of frost damages being observed in the northern provenances, i.e. those with the earlier phenology. We provide field-based evidence that phenological differences between provenances influence the risk of frost damage. Our results indicate that Northern provenances reactivate growth earlier than Southern provenances when moved to warmer conditions, increasing the risk of late frost damage. This highlights the importance of provenance selection in boreal forest management under climate change.
Mots-clés: écophysiologie, écologie forestière, bud break, common garden, false spring, frost hardiness, picea mariana, provenance trial
40 - Réponse de la végétation de sous-bois 12 ans après éclaircie commerciale et la création de trouées dans des peuplements naturellement régénérés et des plantations d'épinettes blanches.
Raphaël Turquin
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAR)
Autres auteurs
- Isabelle Aubin (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Luc Sirois (CEF, UQAR)
- Robert Schneider (CEF, UQAR)
- Martin Barrette (MFFP)
Parterre Orford - 11h20
L'éclaircie commerciale a gagné en popularité au cours des dernières décennies, et a été proposé comme pratique pouvant permettre de mieux atteindre les objectifs d'aménagement écosystémique. Le sous-bois, qui remplit de nombreuses fonctions écologiques, peut cependant être altéré par cette pratique. Dans certaines circonstances, l'éclaircie commerciale et les trouées pourraient contribuer à la restauration de la structure complexe des peuplements régénérés naturellement et plantés. Toutefois, la réponse du sous-bois à ces traitements n'est pas encore bien connue. Notre objectif était d'évaluer l'effet de ces traitements sur la flore du sous-bois dans des peuplements naturellement régénérés et plantés d'épinette blanche (Picea glauca) dans l'Est du Québec. Les communautés floristiques ont été étudiées avant l'éclaircie et la création de trouées, et 1, 2 et 12 ans après le traitement. Le plan expérimental était composé d'unités expérimentales qui ont été éclaircies commercialement (aucune, éclaircie par le bas et éclaircie par dégagement de 50 ou 100 arbres élites/hectare) et combinées à 3 types de trouées (aucune, 100m2 et 500m2) où nous avons comparé la composition, l'assemblage fonctionnel et la structure du sous-étage. Nos résultats ont montré des différences dans la diversité spécifique, la richesse fonctionnelle et la structure verticale entre les peuplements naturellement régénérés et les plantations. Par rapport aux petites trouées (100m2), les grandes trouées (500m2) ont favorisé les espèces intolérantes et rudérales ainsi que le développement de couches denses d'arbustes et d'herbacées. L'effet des grandes trouées était plus important dans les peuplements plantés que dans les peuplements régénérés naturellement. L'éclaircie commerciale, par contre, n'a pas affecté les communautés floristiques. Nos résultats suggèrent que l'éclaircie commerciale a un effet limité sur la diversité des plantes de sous-bois, mais que les changements floristiques persistent jusqu'à 12 ans après la création de trouées petites à modérées, en particulier dans les plantations.
Mots-clés: écologie forestière, aménagement, flore du sous-bois, diversité spécifique, traits fonctionnels, structure verticale, éclaircie de conversion structurale, évolution temporelle
41 - Dynamique de l'azote au cours de la décomposition du bois : Etude sur 5 espèces représentatives des forêts de l'Est du Canada.
Apolline Benoist
Étudiant(e) au doctorat (CEF, Université de Sherbrooke, Centre Sève)
Autres auteurs
- Daniel Houle (Environnement Canada, Ouranos)
- Robert Bradley (CEF, Université de Sherbrooke, Centre Sève)
- Jean-Philippe Bellenger (Centre Sève, Université de Sherbrooke)
Balcon Orford - 11h40
Le bois mort est essentiel à la structure et la stabilité des écosystèmes forestiers et contribue au maintien de la biodiversité. Il représente aussi un important réservoir de carbone stockant jusqu'à 76 Pg de C à l'échelle de la planète. Cependant la dynamique de l'azote (N) au cours de la décomposition du bois reste encore largement méconnue. Le bois étant une matrice pauvre en N, l'entrée de N exogène est importante pour soutenir l'activité microbienne et ainsi la décomposition. Dans un contexte de changements globaux ou les quantités de bois mort pourraient augmenter (ex. feux de forêts, épidémies d'insectes), il est important de mieux comprendre les facteurs influençant sa décomposition, notamment les flux de N. L'objectif principal de notre étude est d'évaluer comment le, climat, la chimie du sol, et la composition des peuplements interagissent pour contrôler la vitesse de décomposition du bois. Le second objectif est d'évaluer le rôle de la fixation biologique de N et de la colonisation fongique sur les flux entrants de N dans le bois. Pour cela, nous avons suivi la décomposition en de 1300 lamelles de bois de 5 essences représentatives de l'Est du Canada (épinette noire, sapin baumier, hêtre, érable à sucre et bouleau blanc) pendant 3 ans le long d'un gradient de climat et de composition forestière. Certaines lamelles de bois préalablement enrichies en 15N nous ont permis d'estimer les flux nets de N (gain et perte). Nos résultats montrent que la décomposition est fortement corrélée avec l'espèce d'arbre (30 %) et la biomasse fongique (50 %), et dans une moindre mesure avec le climat (12 %). Nos résultats montrent également que la majorité de l'N incorporée dans le bois est relâchée durant la décomposition et que jusqu'à 90 % du N exogène peut provenir de la colonisation fongique.
Mots-clés: écologie forestière, sols, flux d'azote, bois mort
42 - Diversité végétale et fonctionnelle dans les plantations mixtes de peupliers hybrides et les monocultures
Mialintsoa Aroniaina Randriamananjara
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT)
small email
Autres auteurs
- Nicole Fenton (CEF, UQAT)
- Xavier Cavard (CEF, UQAT)
- Mélanie Jean (Université de Moncton)
- Annie DesRochers (CEF, UQAT)
Parterre Orford - 11h40
Au Québec, l'afforestation des friches agricoles par la plantation d'espèces exotiques à croissance rapide comme le peuplier hybride Populus spp. constitue un moyen efficace pour produire une importante quantité de bois. Toutefois, il n'y a pas de consensus sur l'impact des espèces exotiques en plantation sur la diversité fonctionnelle et végétale du sous-bois. Des questions se posent sur comment cette diversité peut être influencée par les types de plantations d'espèces exotiques notamment des monocultures et des plantations mixtes. On pose l'hypothèse que (i) parce qu'elle offre une structure plus complexe, la mixité du couvert devrait favoriser la diversité du sous-bois. On émet aussi l'hypothèse que (ii) la végétation de sous-bois diffère de manière significative en termes de composition et de traits fonctionnels entre les plantations mixtes et les monocultures. Finalement, on s'attend à ce que (iii) les plantes tolérantes à l'ombre comme les bryophytes seront plus présentes dans les monocultures de conifères par rapport aux plantations mixtes et aux monocultures de peuplier hybride. Pour comparer chaque type de plantation, on a mesuré la lumière incidente du sous-bois, le pourcentage de couverture, la diversité taxonomique et fonctionnelle végétale du sous-bois et récolté les espèces de bryophytes et lichens pour identification au laboratoire. Les résultats préliminaires montrent que (i) la richesse spécifique totale des plantations de peupliers hybrides s'améliore lorsqu'elles sont mélangées avec des conifères (ii) la richesse spécifique des plantes vasculaires était la même dans tous les types de plantations (iii) Les monocultures de conifères et les plantations mixtes favorisent l'établissement des bryophytes comparativement aux monocultures de peuplier hybride.
Mots-clés: biodiversité, végétation de sous-bois, plantation, espèce exotique, peuplier hybride
43 - Le réchauffement climatique comme bouc émissaire : quantifier l'importance du climat dans la rétraction vers le nord de l'aire de distribution du caribou forestier au Québec depuis 1850
Chloé Morineau
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAR)
Autres auteurs
- Yan Boulanger (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Martin-Hugues St-Laurent (CEF, UQAR, Centre d'études nordiques (CEN))
Parterre Orford - 15h30
La réduction de l'aire de distribution des espèces est un facteur majeur de perte de biodiversité à échelle globale. Bien que les activités et la dégradation d'habitat d'origine anthropique soient souvent désignées comme responsables, les changements climatiques ne sont pas en reste. Chez les espèces menacées, distinguer les effets de la présence humaine des effets du réchauffement climatique sur l'aire de distribution des espèces est un pas supplémentaire vers leur conservation. En associant des cartes de distributions historiques passées avec les données climatiques de plusieurs réanalyses, nous avons évalué les effets potentiels des changements climatiques récents sur la rétraction vers le nord de l'aire de distribution du caribou forestier (Rangifer tarandus caribou, population boréale) au Québec depuis 1850. Nous avons mis en évidence les différences entre les limites sud d'aire de distribution historiques, prises comme références, et celles reconstituées grâce à des modèles de niche climatique. Les limites sud reconstituées présentaient un déplacement vers le nord à travers le temps de ~105 km, et ce pour toutes les réanalyses, une tendance drastiquement différente de celle observées pour les limites sud historiques, lesquelles se sont rétractées de 620 km depuis 1850. Ces différences suggèrent que le réchauffement climatique récent serait responsable de seulement ~17% du recul vers le nord de l'aire de distribution du caribou forestier depuis 1850. Cet impact limité du climat souligne l'importance des moteurs de changement anthropiques ayant façonné la structure et la composition du paysage forestier québécois (c.-à-d. coupe forestière, voirie, développement agricole, urbanisation, autres perturbations anthropiques) comme explication de la contraction de l'aire de distribution du caribou vers le nord au cours des 160 dernières années. Nos résultats rappellent l'importance de considérer les aires de distribution passées dans l'établissement des projections des aires de répartition futures, en particulier pour les espèces menacées.
Mots-clés: faune, biologie de la conservation, changements climatiques, modèle, niche, ongulé, perturbations anthropiques
44 - Of Microbiomes and Mosses: Functions of the boreal moss microbiome from north Québec
Sarah Ishak
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, Université de Sherbrooke)
Parterre Bellevue - 15h30
Interactions between mosses and their associated microbiomes contribute substantially to boreal ecosystem processes. While moss-cyanobacteria interactions are very well studied, mosses harbour an array of microbial species that facilitate nitrogen cycling, as well as organic matter decomposition, carbon storage, nutrient acquisition and phosphorus cycling. Variables such as moisture, shade, leaf-litter type and host moss species impact moss microbiome communities. Previous studies also allude to moss microbiome differences between the photosynthetically active green parts and decaying brown parts of mosses. Unfortunately, these moss compartment variables have not yet been fully explored in microbiome research. Furthermore, mosses are also one of the first few species to begin colonising mine sites. However, the use of mosses in remediation, and the functions of the microbiome of mosses living in mine sites have been severely understudied too. Thus, the objective of the current project was to investigate the functional diversity of 7 boreal non-feathermoss/peatmoss species from the Eeyou Istchee region of Quebec, including the Nemaska Lithium mine site. Shotgun sequencing was used in order to obtain both functional gene data, as well as microbial taxonomy. Overall, it was found that moss compartments were a significant driver of moss microbiome community structure, both taxonomically and in terms of functional gene diversity. In mine sites, the alpha-diversity of the moss microbiome taxonomy was significantly lower compared to natural sites. However, functional alpha-diversity differences were not statistically significant, indicating that it is important to not only focus on taxonomic diversity when analysing microbiomes. Knowledge of the functions of the moss microbiome can provide insight into the role of moss-associated microorganisms in driving ecosystem functions such as productivity, carbon sinks, nitrogen fixation, and resilience to global change.
Mots-clés: écologie forestière, moss, microbiome
45 - Daily timings of sap production in sugar maple in Quebec, Canada
Sara Yumi Sassamoto Kurokawa
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAC)
Autres auteurs
- Gabriel Weiss (CEF, UQAC)
- David Lapointe
- Sylvain Delagrange (CEF, UQO)
- Sergio Rossi (CEF, UQAC)
Balcon Orford - 15h30
The production of maple syrup has a high economic importance in Canada, with the province of Quebec being the world's leading producer and exporter. Climate warming is affecting plant phenology, with potential consequences on the dynamics of growth reactivation of sugar maple and the timings of maple syrup production. In this study, we assess the temperatures inducing the daily reactivation or cessation of sap production. We selected 19 sugarbushes across Quebec, Canada, using a tapping method associated with the tubing system. We recorded the daily timings of onset and ending of sap production during winter and spring 2018, and we associated the hourly temperatures at each site. Sap production occurred from mid-February to the end of April, starting on average between 10 AM and 11 AM, and ending from 6 PM to 8 PM. We observed a seasonal pattern in the onset and ending of sap production during spring, with the onset showing a greater change than the ending. Onset and ending of sap production occurred mostly under temperatures ranging between -2 and 2°C. The production of sap in maple is closely related to circadian freeze-thaw cycles, and occurs under nighttime and daytime temperatures fluctuating below and above 0 °C. The daily lengthening of the duration of sap production mirrors the changes in the timings of freeze and thaw events and can be explained by the physical properties of the water and the physiological processes occurring during growth reactivation. The ongoing warming will result in earlier and warmer springs, which may anticipate the cycles of freeze and thaw and advance sap production in sugar maple.
Mots-clés: sylviculture, physiologie, phenology, hourly scale, sap exudation, acer saccharum marsh., temperature, maple syrup
46 - Impacts des changements climatiques sur les forêts québécoises : ce qu'une analyse intégrée régionale nous a appris
Yan Boulanger
Chercheur(e) associé(e) (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
Autres auteurs
- Jesus Pascual (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Annie-Claude Belisle (Conseil de la Première Nation Abitibiwinni)
- Yves Bergeron (CEF, UQAT)
- Marie-Hélène Brice (CEF, Université de Montréal)
- Dominic Cyr (Environnement et Changement climatique Canada)
Parterre Orford - 15h50
Les forêts sont l'un des écosystèmes les plus susceptibles d'être touchés de manière significative par le changement climatique. Les analyses régionales évaluant les vulnérabilités des écosystèmes forestiers et du secteur forestier aux changements climatiques sont essentielles pour prendre en compte l'hétérogénéité des impacts des changements climatiques mais aussi le fait que les risques, les opportunités et les capacités d'adaptation peuvent différer d'une région à l'autre. Nous présentons ici un aperçu de l'Évaluation régionale intégrée des changements climatiques sur les forêts du Québec, un travail qui a impliqué plusieurs équipes de recherche et qui s'est concentré sur les impacts des changements climatiques sur les forêts commerciales du Québec et sur les solutions d'adaptation potentielles. Nos travaux ont montré que les changements climatiques modifieront plusieurs processus écologiques dans les forêts du Québec. Notamment, la croissance des conifères boréaux diminuera alors que la productivité des espèces feuillues thermophiles augmentera. Les régimes de perturbation naturelle, y compris les épidémies d'insectes (par exemple, les épidémies de tordeuse des bourgeons de l'épinette) ainsi que les feux de forêt, seront fortement modifiés. Comme le prévoient plusieurs modèles différents, ces changements entraîneront d'importantes modifications des paysages forestiers, notamment un déclin de la biomasse des espèces boréales en fin de succession, tandis que les espèces thermophiles à feuilles larges et les espèces pionnières devraient être favorisées, ainsi qu'une accélération du renouvellement des espèces dans les régions les plus méridionales. La récolte se cumulera avec le changement climatique pour modifier davantage les futurs paysages forestiers, ce qui aura également des conséquences sur l'habitat de la faune, la biodiversité aviaire, le bilan carbone et les valeurs indigènes. Nous préconisons que l'adaptation du secteur forestier est essentielle pour atténuer les impacts du changement climatique sur plusieurs services écosystémiques forestiers. Ces stratégies devraient améliorer la résilience des services écosystémiques. Par exemple, la réduction de la récolte pourrait être bénéfique à l'habitat du caribou, à la biodiversité aviaire, au stockage du carbone et aux activités traditionnelles autochtones, ou contribuerait à stabiliser les taux de récolte du bois et à réduire les échecs de régénération après incendie dans les régions actuelles ou futures sujettes aux incendies. D'après nos travaux, nous préconisons que ne pas mettre en œuvre les options d'adaptation pourrait représenter des risques économiques et écologiques importants pour les forêts du Québec.
Forests are one of the ecosystems that are most likely to be significantly impacted by climate change. Regional analyses assessing the vulnerabilities of forest ecosystems and the forest sector to climate change are key to take into account the heterogeneity of climate change impacts but also the fact that risks, opportunities and adaptation capacities might differ from one region to another. Here we provide a synthesis of the Regional Integrated Assessment of climate change on Quebec's forests, a work that involved several research teams and that focused on climate change impacts on Quebec's commercial forests and on potential adaptation solutions. Our work showed that climate change will alter several ecological processes within Quebec's forests. Notably, boreal conifer growth will decline while the productivity of thermophilous deciduous species will increase. Natural disturbance regimes, including insect outbreaks (e.g., spruce budworm outbreaks) as well as wildland fires will be strongly altered. As projected by several different models, these changes will result in important modifications in forest landscapes, notably a decline in late-succession boreal species biomass while thermophilous broadleaf and pioneer species should be favored along with an acceleration of species turnover within the southernmost regions. Harvest will cumulate with climate change effects to further alter future forest landscapes which will have consequences also on wildlife habitat, avian biodiversity, carbon budget and Indigenous values. We advocate that adaptation of the forest sector is therefore key to mitigating the impacts of climate change on several forest ecosystem services. These strategies should improve the resilience of ecosystem services. For instance, reducing harvesting could benefit caribou habitat, avian biodiversity, carbon storage, and Indigenous traditional activities or would help to stabilize timber harvest rates and reduce post-fire regeneration failures within current or future fire-prone regions. We conclude that without adaptation options implementation significant economical and ecological risks will affect Quebec's forests
Mots-clés: changements climatiques, forêt boréale, analyse intégrée, québec, adaptation
47 - Les communautés de bactéries, de champignons et de mycorhizes dans le sol en forêt boréale diffèrent entre coupe totale et épidémie d'insecte 50 ans après perturbation
Philip Bell-Doyon
Étudiant(e) au doctorat (CEF, Université Laval)
Autres auteurs
- Virginie Bellavance (CEF, Université Laval)
- Louis Bélanger (CEF, Université Laval)
- Marc J. Mazerolle (CEF, Université Laval)
- Juan Carlos Villarreal A. (CEF, Université Laval)
Parterre Bellevue - 15h50
Les microorganismes du sol influencent les fonctions et les processus des écosystèmes forestiers, et leur composition est affectée par les perturbations naturelles et anthropiques. L'exploitation forestière perturbe le microbiome des sols en forêt boréale, particulièrement les communautés d'ectomycorhizes qui seraient moins diversifiées dans la première décennie suivant une coupe totale. Toutefois, l'impact à long terme de la récolte forestière sur les microorganismes du sol a rarement été investigué ou comparé aux perturbations naturelles. Notre objectif est de comparer la composition et la diversité des communautés de bactéries, de champignons et de mycorhizes entre des vieilles sapinières et des sapinières de 50 ans régénérées à la suite d'une coupe totale ou d'une épidémie d'insecte. Nous avons collecté 90 échantillons dans 30 parcelles et six peuplements dominés par Abies balsamea. Nous avons séquencé les régions génomiques 16S rRNA v3v4 pour les bactéries et ITS1 pour les champignons et nous avons construit des matrices de distance pour évaluer les changements dans la composition des communautés à l'aide d'analyses de variance permutationelles. Les résultats montrent que 10,2% à 12,4% de la variabilité observée dans la composition des communautés de bactéries, de champignons et de mycorhizes peut être expliquée seulement par le type de peuplement. De plus, les peuplements se régénérant à la suite d'une coupe totale présentent une plus grande diversité alpha (H') de champignons et de mycorhizes que ceux issus d'une épidémie d'insecte. Nos données indiquent que le microbiome des sols associés à la dynamique naturelle des perturbations diffère des coupes totales, quoique les mécanismes expliquant ce patron demeurent troubles. Ainsi, nous suggérons que les aménagistes épargnent les plus grandes superficies possibles de forêts non-aménagées à travers le paysage exploité, incluant des zones affectées par les perturbations naturelles, afin que des communautés témoins demeurent accessibles pour des études futures.
Soil microorganisms influence the functions and processes of forest ecosystems, and their composition is affected by natural and anthropogenic disturbances. Timber harvesting disturbs boreal soil microbiomes, most notably ectomycorrhizal communities which are reportedly less diverse in the first decade following a clearcut. However, the long-term impact of harvesting on forest soil microorganism communities have rarely been investigated nor compared with natural disturbances. Our objective was to compare the composition and diversity of bacterial, fungal, and mycorrhizal communities between boreal old-growth and nearby 50 year old stands regenerating after either an insect outbreak or a clearcut. Our main hypothesis was that the nature of the stand replacing disturbance influences the composition of the soil microbiome, and that the effect is still detectable 50 years later. We collected 90 samples from 30 plots across six forest stands dominated by Abies balsamea. We sequenced the genome regions 16S rRNA v3v4 for bacteria and ITS1 for fungi and we constructed distance matrices to evaluate changes in community composition with permutational analyses of variance. Results show that 10.2% to 12.4% of the variability in community composition can be explained by stand type alone for bacteria, fungi, and mycorrhizae. The composition of soil microbiomes did not vary with soil physicochemical properties. Stands regenerating after a clearcut had a greater alpha diversity (H') of fungi and mycorrhizae than stands regenerating after an insect outbreak, while old growth stands were intermediate. Our data indicate that soil microbiomes associated with natural disturbance dynamics differ from those of clearcutted stands, although the mechanisms underlying this pattern remain unclear. Therefore, we suggest that forest managers spare the largest possible tracts of unmanaged forests across the harvested landscape, including areas affected by natural disturbances, so that benchmark soil communities remain available for future studies.
Mots-clés: biodiversité, historique des perturbations, conservation boréale, choristoneura fumiferana, metagénomique, adn environnemental, microbiologie, sol forestier
48 - Contrôler l'aulne rugueux (Alnus rugosa (Du Roi) Clausen) pour restaurer la productivité en forêt boréale
Jonathan Kusa Kimbukusu
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Annie DesRochers (CEF, UQAT, Groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi (GREMA))
- Nelson Thiffault (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
Balcon Orford - 15h50
L'augmentation de la disponibilité de la lumière et l'élévation de la nappe phréatique après la récolte dans les peuplements aménagés favorise l'envahissement rapide par l'aulne rugueux. D'un autre côté l'aulne a la capacité de fixer naturellement l'azote de l'air, ce qui peut donc contribuer à l'enrichissement du sol dans le peuplement. L'aulne peut également jouer un rôle important dans le bilan d'évapotranspiration des tourbières boisées en abaissant la nappe phréatique. Dans ce contexte, la présence d'aulnes pourrait, grâce à une préparation mécanique de terrain, favoriser la croissance des conifères dans les écosystèmes forestiers où la disponibilité de l'azote dans le sol est faible et où la nappe phréatique est proche de la surface. Par contre, par son feuillage dense et abondant, l'aulne peut nuire à la croissance de plants forestiers utilisés pour la remise en production des peuplements coupés. Dans cette étude, nous testons comment la préparation mécanique de terrain peut être utilisée pour contrôler simultanément l'abondance des aulnes et favoriser la croissance des arbres. A l'automne 2019, nous avons mis en place un dispositif dans lequel nous avons testé quatre méthodes de préparation de terrain (décapage, inversion, déchiquetage et un témoin non traité), à la forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet (FERLD). L'année suivante, à l'été 2020, nous avons reboisé le site avec des plants d'épinette noire. L'effet des méthodes de préparation de terrain sur la survie et la croissance des plants reboisés, et sur les variables environnementales ont été mesurés à la fin de l'été 2021. Les résultats montrent que tous les traitements ont amélioré la croissance des plants d'épinette noire, comparé au traitement témoin sans préparation de terrain. Les données environnementales et nutritionnelles en cours d'analyse permettront de mettre davantage en évidence leurs effets sur la croissance de l'épinette noire.
Mots-clés: aulne rugueux, préparation mécanique de terrain, sylviculture, aménagement, remise en production
49 - Le climat interagit avec la diversité des espèces d'arbres pour influencer la productivité forestière
Laurie Dupont-Leduc
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAR)
Autres auteurs
- Robert Schneider (CEF, UQAR)
- Hugues Power (MFFP)
- Mathieu Fortin (Ressources naturelles Canada, Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB))
Parterre Orford - 16h10
La diversité des arbres peut augmenter la productivité des forêts en améliorant les interactions interspécifiques, en plus d’offrir une plus grande stabilité face au changement climatique. Cependant, très peu d’études se sont intéressées à l’influence de la diversité sur, à la fois, la croissance des arbres survivants, le recrutement de nouveaux arbres et la mortalité, qui sont pourtant les principaux moteurs de la dynamique des communautés forestières. Ici nous explorons les relations diversité–productivité–climat afin de mieux comprendre l’effet de la diversité sur la productivité forestière, ainsi que pour déterminer dans quelles circonstances la diversité des arbres devrait être promue pour assurer la résilience des forêts dans le climat du futur. À l'aide de modèles Random Forest et d'un réseau de placettes permanentes couvrant un large gradient de conditions climatiques, les effets de la diversité et des variables climatiques sur la productivité nette ont pu être isolés. De fortes interactions entre le climat et la diversité ont été observées. Cependant, en fonction de la diversité fonctionnelle des communautés considérées, des patrons contrastés de réaction face à la variabilité climatique ont été identifiés. Une plus grande diversité fonctionnelle n’est pas toujours synonyme d’une plus grande productivité. Cette étude fournit un cadre utile pour identifier les caractéristiques de diversité qui devraient être favorisées selon différents scénarios climatiques pour anticiper les changements et aider à renforcer la capacité adaptative des forêts.
Mots-clés: écologie forestière, biodiversité
50 - L'augmentation de la productivité du peuplier hybride ne se traduit pas par une augmentation linéaire du carbone organique du sol
Toky Jeriniaina Rabearison
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Vincent Poirier (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)
- Adam Gillespie (University of Guelph)
- Jérôme Laganière (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Annie DesRochers (CEF, UQAT)
Parterre Bellevue - 16h10
La séquestration du carbone (C) dans le sol fait partie des solutions pour atténuer les changements climatiques. Les arbres à croissance rapide constituent un outil potentiel dans ce contexte puisqu'ils accumulent rapidement du C dans leur biomasse et pourraient transférer davantage de matière organique dans le sol. Toutefois, l'impact de la productivité aérienne des arbres à croissance rapide sur la séquestration du C organique du sol (COS) demeure méconnu. Cinq clones ayant une productivité différente ont été sélectionnés dans une plantation de peuplier hybride située à New Liskeard, ON, Canada. Nous avons prélevé des carottes de sol à 87,5 et 175,0 cm du tronc ainsi qu'à 0-20, 20-40 et 40-60 cm de profondeur dans le sol pour en analyser les concentrations en C. Le clone le plus productif DN2 a stocké moins de COS (83 Mg C ha-1) que les clones à productivité moyenne 1079 et 915005 (95 et 96 Mg C ha-1 respectivement) entre 0 et 60 cm de profondeur. Le clone le moins productif 747210 stockait également moins de COS par rapport aux autres clones, mais pas de façon significative. La relation entre la productivité des clones et le stock de COS n'était pas linéaire. Les stocks totaux de COS ont augmenté de 6% lorsque la distance de prélèvement était plus proche du tronc. La différence de stocks de COS entre les clones était majoritairement observée dans la profondeur 20-40 cm suggérant la contribution prépondérante des racines dans la séquestration du COS. Par ailleurs, le clone le plus productif avait un ratio C/N du sol plus faible que le clone 915005 dans la profondeur 20-40 cm. Ainsi, la séquestration du C dans le sol pourrait dépendre davantage de la qualité de la matière organique apportée que de la productivité des arbres.
Mots-clés: écologie forestière, carbone organique du sol, productivité, horizon profond, peuplier hybride, changements climatiques
51 - Intensifier la récolte de bois pour l'approvisionnement en biomasse forestière : quels impacts sur la rentabilité de la filière bois et la régénération des sites?
Claudie-Maude Canuel
Étudiant(e) au doctorat (CEF, Université Laval, Ressources naturelles Canada, Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB), Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR))
Autres auteurs
- Evelyne Thiffault (Université Laval, Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR))
- Nelson Thiffault (Ressources naturelles Canada, Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB), CEF-ULaval (professeur associé))
Balcon Orford - 16h10
L'utilisation de la biomasse forestière pour la bioénergie peut contribuer à la transition énergétique nécessaire à la lutte aux changements climatiques. L'intégration de la récolte de biomasse à l'approvisionnement en bois pour les produits conventionnels est une solution pour réduire les coûts des systèmes de bioénergie dans le respect de l'aménagement durable des forêts. Cependant, nous ignorons comment les caractéristiques forestières et le taux de prélèvement interagissent pour influencer la rentabilité de la filière bois et la régénération forestière. Ainsi, nous avons étudié les opérations de récolte de bois, incluant la biomasse sous forme de sections d'arbres, en complémentarité à la récolte pour les produits conventionnels. D'une part, nous avons évalué les effets de la récolte de biomasse sur la rentabilité de la chaîne d'approvisionnement. D'autre part, nous avons évalué les relations entre l'intensité de récolte et la remise en production des sites, particulièrement en regard de l'apport en débris au sol. Nous avons testé quatre intensités croissantes de récolte sur six sites situés en forêts tempérées et boréales. Dans trois sites d'étude, la récolte de biomasse forestière n'a pas affecté significativement la rentabilité de la chaîne d'approvisionnement lorsque les besoins sylvicoles pour la remise en production des sites étaient considérés. Les effets liés à l'augmentation de l'intensité de récolte étaient les plus marqués dans les peuplements résineux denses. Nos résultats soutiennent que la composition forestière influence le recouvrement des débris au sol et peut avoir des effets variés sur la remise en production des sites. Les conditions de marché, l'intensité de récolte et les caractéristiques forestières sont des éléments importants pour l'aménagement forestier, puisqu'ils influencent la rentabilité de l'approvisionnement et le succès de régénération. Notre étude souligne l'importance de considérer la récolte de biomasse comme une partie intégrante d'un système sylvicole efficace pour tirer davantage de valeur des forêts.
Mots-clés: sylviculture, écologie forestière, lutte aux changements climatiques, biomasse forestière, approvisionnement en bois, analyse financière, débris ligneux, régénération, microsites
52 - Effets des changements climatiques et de l'aménagement forestier sur les communautés d'oiseaux en forêts mixte et boréale du Québec
Guillemette Labadie
Postdoc (CEF, UQAM)
Autres auteurs
- Philippe Cadieux (CEF, UQAM)
- Evelyne Thiffault (Université Laval, Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR))
- Dominic Cyr (Environnement Canada)
- Yan Boulanger (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Diana Stralberg (Ressources naturelles Canada, University of Alberta)
- Junior A. Tremblay (Environnement Canada)
Parterre Orford - 16h30
Les changements climatiques et les perturbations anthropiques affectent grandement les communautés d'oiseaux, notamment en raison des changements induits sur les paysages forestiers. Ces changements risquent d'être spatialement hétérogènes et donc de différer en fonction des biomes. L'objectif de cette étude est d'évaluer les effets cumulés de l'aménagement forestier et des changements climatiques sur les communautés d'oiseaux en forêt tempérée (Forêt Hereford) et en forêt boréale (Forêt Montmorency) au Québec. Nous avons utilisé un modèle de simulation spatialement explicite des paysages forestiers, afin de projeter les impacts de quatre scénarios d'aménagement forestier et trois scénarios de changement climatique sur la composition des forêts, et sur les communautés d'oiseaux. Plus précisément, nous avons évalué les différences dans les changements des communautés d'oiseaux entre les deux forêts, et comment cela affectait plus spécifiquement les espèces sensibles et de même que celles en péril. Nos résultats indiquent que l'aménagement forestier ainsi que les changements climatiques devraient entraîner des changements importants sur les communautés d'oiseaux dans les deux types de forêts à travers les changements de compositions des peuplements forestiers. L'augmentation de la biomasse de feuillus devrait favoriser les communautés d'oiseaux associées aux peuplements mixtes et feuillus, au détriment des communautés associées aux vieux peuplements de conifères. L'ampleur des changements devrait être généralement plus grande à la forêt Hereford qu'à la forêt Montmorency. De plus, les communautés d'oiseaux de la forêt d'Hereford devraient être principalement affectées par les changements climatiques, contrairement aux communautés vivant dans la forêt de Montmorency qui seront plus impactées par l'aménagement forestier. Nous avons estimé que 35% des espèces étudiées à Hereford et 12% à Montmorency seront sensibles aux changements climatiques alors qu'elles présenteront un changement d'abondance supérieure à 25%. Nos résultats prévoient que les communautés d'oiseaux des forêts tempérées seront davantage touchées que celles de la forêt boréale d'ici 2100.
Mots-clés: biodiversité, aménagement, changements climatiques, aménagement forestier, oiseaux, forêt boréale, forêt tempérée
53 - La science du sol à l'ère du Big Data
David Paré
Chercheur(e) associé(e) (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
Autres auteurs
- Kara Webster (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Charlotte Norris (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Brandon Heung Brandon.Heung@dal.ca (Université Dalhousie)
- Xiaoyuan Geng (Agriculture et Agroalimentaire Canada)
- Osvaldo Valeria (CEF, UQAT)
Parterre Bellevue - 16h30
Les sols assurent de nombreux services fournis par les écosystèmes forestiers. Ils filtrent l'eau, recyclent et stockent la matière organique, fournissent les nutriments pour la croissance des arbres en plus de supporter une vaste biodiversité. La cartographie numérique des sols (DSM), domaine en plein essor, constitue une nouvelle source de connaissance qui a le potentiel de révolutionner l'écologie forestière en aidant à mieux comprendre et modéliser les écosystèmes forestiers et leurs fonctions. À l'heure du Big Data et de la digitalisation des données, le Canada fait cependant piètre figure dans ce domaine: les données sont dispersées, peu harmonisées, peu accessibles et les produits cartographiques sont produits à une échelle grossière sans appréciation de l'incertitude. Le problème des données de sol n'est pas unique au Canada il est reconnu par la FAO comme un enjeu majeur. Après quelques exemples illustrant le potentiel du DSM pour faire émerger de nouvelles connaissances et mieux aménager nos forêts, la présentation donnera plusieurs pistes pour changer cette situation: 1-quelles mesures prendre pour que votre fastidieux travail de recherche soit utile aux efforts locaux et internationaux de DSM, vous amène des collaborations et maximise l'héritage de votre travail? 2-Quels sont les ressources disponibles dont en particulier le Portail canadien de données de sols supporter par la société canadienne de science du sol, le Service canadien d'information sur les sols (CANSIS) ainsi que des récentes initiatives du Service canadien des forêts et d'un nouveau projet CRSNG-Alliance de l'UQAT.
Soil science in the age of Big Data. Soils provide many of the services provided by forest ecosystems. They filter water, recycle and store organic matter, provide nutrients for tree growth, and support a vast biodiversity. Digital Soil Mapping (DSM), a rapidly growing field, is a new source of knowledge that has the potential to revolutionize forest ecology by helping to better understand and model forest ecosystems and their functions. However, in the era of Big Data and digitalization of data, Canada has a poor record in this field: data are scattered, poorly harmonized, not easily accessible and map products are produced at a coarse scale without appreciation of uncertainty. The problem of soil data is not unique to Canada it is recognized by the FAO as a major issue. After a few examples illustrating the potential of DSM to generate new knowledge and better manage our forests, the presentation will provide several avenues to change this situation: 1-what steps can you take to ensure that your tedious research work is useful to local and international DSM efforts, leads to collaborations and maximizes the legacy of your work? 2-What resources are available, in particular the Canadian Soil Data Portal supported by the Canadian Society for Soil Science, the Canadian Soil Information Service (CANSIS), as well as recent initiatives by the Canadian Forest Service and a new NSERC-Alliance project at UQAT.
Mots-clés: écologie forestière, sols, modélisation, biodiversité, services écosystémiques
54 - De l'importance des entailles et des arbres en acériculture
Tim Rademacher
Postdoc (CEF, UQO)
Autres auteurs
- Michaël Cliche (CEF, UQO)
- Elise Bouchard (CEF, UQAM)
- Sara Yumi Sassamoto Kurokawa (CEF, UQAC)
- Joshua Rapp (Mass Audubon Society)
- Christian Messier (CEF, UQO)
- Annie Deslauriers (CEF, UQAC)
Balcon Orford - 16h30
L'acériculture est un secteur d'importance économique et culturelle. Beaucoup d'études ont traité de l'importance des caractéristiques individuelles des entailles et des arbres, telle que la largeur de l'entaille ou la grandeur de l'érable, sur la production acéricole. Pourtant, ces facteurs n'ont jamais été étudiés à travers plusieurs sites et années en combinaison. Nous avons compilé des données récoltées avec des méthodes similaire à travers onze sites et 12 ans pour quantifier la variabilité attribuée aux entailles et des arbres, ainsi que leurs effets sur le volume de sève et la teneur en sucre. Nos résultats montent que les caractéristiques de l'arbre sont la source de variabilité la plus important, suivi des caractéristiques des entailles. Les variabilités dû aux arbres, entailles, et sites étaient supérieur à la variabilité interannuelle, qui a reçu beaucoup plus d'intérêt dans le passé. En plus de quantifier les sources de variabilité, nos résultats nous permettent à supporter ou réfuter des hypothèses ou encore à éclairer un besoin de données additionnelles concernant des facteurs spécifiques. Par exemple, nous trouvons que le volume de sève récolté est fortement lié à la grandeur de l'érable et que les érables à sucre donnent plus de sève qui est plus sucré que celle-lui de l'érable rouge. Vu que les acériculteurs et acéricultrices peuvent choisir les arbres qu'ils entaillent et la façon comment ils entaillent chaque année, les connaissances de notre travail peuvent être appliquer pour assurer une gestion durable des érablières. Finalement, nos résultats démontrent que des séries de mesures de longue durée à travers d'un réseau de site peux contribuer énormément aux connaissances en acériculture, donc il est impératif de supporter des tels réseaux.
55 - Explorer comment différentes pratiques d'aménagements forestiers ont affecté la capacité d'adaptation des peuplements forestiers du nord-est du Canada.
Benjamin Marquis
Chercheur(e) non-membre du CEF (RNCan-Centre de foresterie des Grands Lacs)
Autres auteurs
- Samuel Royer-Tardif (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO))
- Julien Bellerose (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Grands Lacs)
- Frédérik Doyon (CEF, UQO)
- Julie Godbout (MFFP)
- Isabelle Aubin (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Grands Lacs)
Parterre Orford - 16h50
Puisque les arbres migrent moins vite que la vitesse à laquelle se déplace leur niche climatique, leur survie dépendra principalement de leur capacité à s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Cependant, la capacité d'adaptation est moins étudiée que l'exposition et la sensibilité. De plus, en favorisant la régénération de certaines espèces, les différentes pratiques d'aménagements forestiers pourraient avoir affecté la capacité d'adaptation des peuplements forestiers. Par conséquent, de grandes incertitudes subsistent dans notre capacité à prédire l'impact des changements climatiques sur les espèces d'arbres et les écosystèmes forestiers. Dans ce travail, nous avons intégré les traits (disponibles à partir de la base de données TOPIC), la plasticité phénotypique (en déterminant les différences de surface foliaire spécifique [SLA] le long d'un gradient de lumière), la diversité génétique (mesurée comme la moyenne de l'hétérozygotie attendue [He] calculé sur 11 457 SNP) et l'échange génétique (mesuré comme le nombre de graines viables génétiquement distinctes de leurs parents [NVSGD]) pour mesurer la capacité d'adaptation de chacune des trois strates (semis, gaule et arborescentes) de 13 espèces d'arbres abondantes dans le paysage forestier du sud-ouest du Québec. Pour déterminer l'impact de l'aménagement forestier sur la capacité d'adaptation des peuplements, nous avons échantillonnées 18 peuplements réparties dans trois types d'aménagements forestiers : 1) des forêts centenaires faiblement affecté par l'humain, 2) des peuplements gérés pour la production de sirop d'érable et 3) des peuplements qui se sont régénérées sur des pâturages abandonnés. Nos résultats indiquent que la capacité d'adaptation est la plus élevée dans les forêts secondaires (pâturages abandonnés). Cette capacité d'adaptation accrue s'explique surtout par une plus forte présence d'espèce comme l'érable rouge et le peuplier faux-tremble qui présentent les deux plus fort niveau d'échange génétique intra-population. Les peuplements forestiers plus perturbés pourraient donc mieux s'adapter aux changements climatiques et s'avérer importants à conserver.
Mots-clés: écologie forestière, aménagement, capacité d'adaptation, vulnérabiité, changements climatiques
56 - Quel est la contribution des mousses aux entrées d'azote en forêt boréale de l'Est canadien ?
Charlotte Blasi - ANNULÉE
Étudiant(e) au doctorat (CEF, Université de Sherbrooke, Centre Sève)
Autres auteurs
- Romain Darnajoux (Princeton University, Geoscience Department)
- Jean-Philippe Bellenger (Princeton University, Geoscience Department)
PDF non disponible
Parterre Bellevue - 16h50
Les mousses hypnacées (bryophytes) qui couvrent de 70 à 100% du sol forestier contribuent de manière significative à l'accumulation de carbone en forêt boréale. Ce sont également une source potentielle d'entrée d'azote réactif via la fixation biologique de l'azote (FBA) atmosphérique par des cyanobactéries présentes à leur surface. En Europe, les mousses sont des sources importantes d'azote contribuant jusqu'à 3-5 kgN.ha-1an-1, soit des apports équivalents ou supérieurs aux dépositions atmosphériques. Bien que faibles, ces apports d'azote par les mousses contribuent au maintien du budget azoté de la forêt sur le long terme. Récemment, une étude en Alaska a montré que la capacité de fixer l'azote atmosphérique est un trait qui serait partagé par de nombreuse espèce de mousse. Mais le rôle des mousses sur les entrées d'azote dans l'Est Canadien reste peu documenté. Ainsi le but principal de notre étude est d'évaluer quelles espèces de mousses contribuent le plus aux entrées d'azote en forêt boréale de l'Est canadien et dans quelle mesure ces entrées contribuent au besoin en azote de la mousse et de manière plus générale au bilan azoté de la forêt. Pour atteindre cet objectif nous avons réalisé un recensement des principales espèces de mousses couvrant le sol forestier sur 5 sites le long d'un transect latitudinal de 500Km. Nous avons mesuré la croissance des mousses et leur activité fixatrice d'azote tout au long de la saison de croissance sur un site représentatif. Les résultats montrent que Ptilium crista-castrensis est l'espèce de mousse contribuant de manière majoritaire et que la fixation d'azote fournit de 10 à 30% de l'azote nécessaire à la croissance des mousses, en fonction des espèces.
Mots-clés: forêt boréale, fixation d'azote, azote, bryophyte
57 - Effects of Partial Harvest and Stand Structure on Conifer Regeneration in Black Spruce Stands: The MISA Project
Sanghyun Kim
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Miguel Montoro Girona (CEF, UQAT)
- Patricia Raymond (MFFP)
- Annie DesRochers (CEF, UQAT)
- Hubert Morin (CEF, UQAC)
- Yves Bergeron (CEF, UQAT)
Balcon Orford - 16h50
In Canada, clearcutting has been the dominant forest management practices, causing forest simplification, biodiversity loss, and vulnerability of regeneration to natural disturbances. Thus, retaining mature trees has been suggested to maintain stand structure and biodiversity, especially for promoting regeneration of shade tolerant species. Partial harvest such as uniform shelterwood system is considered as a promising alternative to clearcutting system to integrate ecological, economical, and social objectives into silvicultural planning. However, partial harvest has not been widely adapted to the Canadian boreal forest yet and needs further evaluation for multidisciplinary research to adopt it to achieve sustainable management goals. The aim of this study is to evaluate the effects of experimental partial harvests on conifer regeneration in natural even-aged black spruce (Picea mariana (Mill.) B.S.P.) stands 18 years after cutting. An experimental design with six sites (younger stands: 2,316 trees/ha, 79 years old; older stands: 1,272 trees/ha, 156 years old) and six silvicultural treatments (clearcut: 100% of basal area removal; seed-tree: 75%; close-selection, distant-selection, mini-strip: 50%; unmanaged as a control) was established by Canadian Forest Service in Saguenay and North Shore regions of Quebec. We counted and categorized all seedlings by species and height class in each micro-plot and assessed a dominant seedling for growth variables (age, height, diameter, reproduction type) and micro-environment (climate, solar radiation, rooting substrate, soil properties). Our preliminary results showed that conifer regeneration in uniform shelterwood systems promoted a higher level of seedling density than deciduous plants. However, they were less efficient promoting growth. Regeneration density for black spruce was around four times higher than that for balsam fir. We expect that partial harvest will be silvicultural alternatives to clearcutting for conifer regeneration by providing appropriate seedbed and intermediate level of disturbances in black spruce boreal forests.
Mots-clés: aménagement, sylviculture, boreal forest, bonifer regeneration, bcosystem-based management, bartial harvest, bicea mariana, seedling competition, stable isotope analysis, uniform shelterwood systems
Résumés des affiches (par ordre du numéro d'affiche)
Sauter à la section présentations orales | Retour à la page du Colloque
1 - How do partial cuts influence the edge effect, the growth shock, and the after-harvest mortality?
Martín Alcalá Pajares
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Miguel Montoro Girona (CEF, UQAT)
- Annie DesRochers (CEF, UQAT)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 01
Increasing concerns regarding the impacts of traditional even-aged management practices are leading to a diversification in the silvicultural treatments to implement ecosystem-based management. Consequently, the development of partial cuts has been a priority during the last two decades. Although important advances have been made, the effects of partial cuts in terms in tree growth and mortality are not well understood. This thesis will study the influence of several harvest intensity partial cuts on the edge effect, the after-harvest growth shock and tree mortality 10 years after harvesting, in esker forests and in forests located over clayey soils of the Abitibi-Témiscamingue region (Quebec, Canada). Black spruce and jack pine forests will be selected on both soil types. Two partial cut treatments in addition with uncut (control) stands will be evaluated in each forest type in order to establish a harvest intensity gradient. A total of four replicates per treatment will be selected and one 600 m2 experimental plot will be installed in each replicate to study radial growth by using a dendrological approach by extracting cores and analyzing tree-ring series. Around 35 trees will be sampled in each replicate extracting a total of around 1,680 cores. Tree mortality and root grafting will be studied in 50 m2 permanent rectangular plots to evaluate the relationship among both phenomena. Dead trees will be classified as snags, broken, or uprooted. In addition, a high-pressure water spray from a water pump will be used to excavate, expose, and extract the grafted root systems for their following analysis. Results of this research will be essential to provide silvicultural prescriptions for the implementation of partial cuts in the Canadian boreal forests. Moreover, this thesis will be pioneer in the evaluation of the effects of partial cuts in esker ecosystems and the complex relationship between root grafting and tree mortality.
Mots-clés: écologie forestière, sylviculture, dendrochronology, edge effect, growth shock, radial growth, root grafting, silviculture, windthrow.
2 - Réponses des semis d'arbres plantés en sous-bois forestier, sous différents niveaux de lumière à différentes conditions de stress hydriques, de broutement et de concurrence végétale
Houssam Amraoui
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQO)
Autres auteurs
- Frédérik Doyon (CEF, UQO)
- Philippe Balandier (Institut national de la recherche agronomique (INRAE), UMR Laboratoire de Physique et Physiologie intégratives de l'Arbre en environnement Fluctuant (PIAF, France))
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 02
Dans le contexte des changements globaux, le succès de la régénération forestière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, pourra être limitée par plusieurs stress biotiques et abiotiques. Des récents travaux dans les forêts feuillues au sud du Québec montrent que les menaces les plus probantes pour les semis seront les sècheresses, les coups de chaleur, le broutement par les grands cervidés (Cerf de Virginie et Orignal) ainsi que l'envahissement du sous-étage par la végétation compétitrice (arbustes et herbacée). Ces stress, soit individuellement considérés, ou en interactions entre eux, viendront affecter la disponibilité en ressources (lumière, eau, nutriments, espace) ainsi que la capacité des semis à compétitionner pour y avoir accès. Ce projet a pour but d'évaluer la performance en croissance et en survie de semis de différentes espèces d'arbres plantés sous couvert forestier soumis à la sécheresse, au broutement par les grands herbivores et à la concurrence végétale dans le sous-bois afin d'identifier les espèces offrant une meilleure capacité d'adaptation aux stress. Nous souhaitons aussi pouvoir comprendre quels attributs morphologiques et physiologiques leur confèrent cette capacité d'adaptation.
Mots-clés: écologie forestière, écophysiologie, régénération forestière, semis d'arbres, forêt feuillue, sud du Québec, sylviculture d'adaptation, dispositif d'exclusion des précipitations, exclos contre l'herbivorie, éclaircie, broutement des grands herbivores, sécheresse, compétition végétale dans le sous-bois, traits fonctionnels des semis
3 - Comment les traitements sylvicoles affectent les stocks de carbone aérien des pessières le long d'un gradient longitudinal ?
Miray Andrianirinarimanana
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Xavier Cavard (CEF, UQAT)
- Jean-François Boucher (CEF, UQAC)
- Nelson Thiffault (Ressources naturelles Canada, Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB))
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 03
Les vastes forêts d'épinettes noires (Picea mariana (Mill.) BSP) (EPN) du Québec constituent un puits important de carbone (C), faisant d'elles un atout important face aux changements climatiques (CC). Cependant, les traitements sylvicoles peuvent, dans certaines circonstances, compromettre leur rôle en modifiant la régénération, la croissance et la mortalité des arbres. Il importe d'identifier les traitements qui favorisent le stockage de C tout en maintenant les divers services écosystémiques qu'elles supportent. Nos objectifs sont d'étudier les impacts (i) de traitements sylvicoles relativement intenses (coupe totale, scarifiage, plantation) et (ii) moins intenses (éclaircies commerciales EC), réalisés il y a 20 ans sur la biomasse de différents étages de végétation. Également, nous visons à (iii) étudier les effets interactifs du climat et des traitements sylvicoles sur la croissance des arbres. Pour y arriver, nous installerons 90 placettes d'échantillonnage de la végétation le long d'un gradient longitudinal. Nous prélèverons des carottes sur 30 arbres par placette ainsi que des sections transversales de bois morts, afin de reconstituer la croissance et la mortalité depuis les coupes. Ces données permettront aussi de déterminer si et comment les traitements sylvicoles modifient les relations croissance-climat de la régénération et des tiges résiduelles. Nous anticipons une biomasse du sous-étage plus élevée après scarifiage, par rapport aux parcelles non-scarifiées. La captation de C depuis le traitement devrait être plus élevée dans les EC, et ce, malgré une mortalité supérieure durant les premières années après coupe. Finalement, nous prévoyons que la tolérance des arbres à la sècheresse sera plus élevée après les EC que dans les autres traitements, avec un effet plus marqué dans les régions au climat plus continental.
Quebec's vast black spruce (Picea mariana (Mill.) BSP) forests (EPN) are an important carbon (C) sink, making them an important asset against climate change (CC). However, silvicultural treatments can, under certain circumstances, compromise their role by modifying tree regeneration, growth and mortality. It is important to identify treatments that promote forest C storage while maintaining the various ecosystem services they support. Our objectives are to study the impacts of silvicultural treatments which are (i) relatively intense (clearcut, scarification, planting) and (ii) less intense (commercial thinning CT) carried out 20 years ago on the biomass of different vegetation layer. We also aim to (iii) study the interactive effects of climate and silvicultural treatments on tree growth. To achieve this, we will install 90 vegetation sample plots along a longitudinal gradient. We will collect cores from 30 trees per plot as well as cross-sections of dead wood to reconstruct growth and mortality since harvesting. These data will also allow us to determine if and how silvicultural treatments alter the growth-climate relationships of regeneration and residual stems. We anticipate higher understory biomass after scarification compared to unscarified plots. C uptake since treatment is expected to be higher in CTs, despite higher mortality in the early years after cutting. Finally, we expect tree drought tolerance to be higher after CT than in other treatments, with a stronger effect in regions with a more continental climate.
Mots-clés: aménagement, sylviculture, stock de carbone, traitements sylvicoles, changement climatique, dendrochronologie, épinettes noires, gradient longitudinal
4 - L'influence de la prolifération du hêtre et de la sécheresse sur l'utilisation de l'eau par les arbres dans les érablières Québécoises
Pierrick Arnault
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQO)
Autres auteurs
- Claudele Ghotsa Mekontchou (CEF, UQO)
- Pascal Rochon (Institut des Sciences de la Forêt tempérée (ISFORT))
- Gabriel St-Onge
- Philippe Nolet (CEF, UQO)
- Audrey Maheu (CEF, UQO)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 04
Les érablières du sud du Québec font face à une prolifération du hêtre à grandes feuilles et à une augmentation de la fréquence et de la sévérité des sécheresses avec les changements climatiques. Ces perturbations risquent d'entraîner une compétition accrue pour les ressources hydriques. Ces augmentations de fréquence et de sévérité des périodes de sécheresse pourraient accentuer la prolifération du hêtre à grande feuilles dans les érablières québécoises. L'objectif de ce projet est d'étudier les effets cumulatifs de la prolifération du hêtre et de la sécheresse sur l'utilisation de l'eau à l'échelle de l'arbre et la transpiration à l'échelle du peuplement dans les érablières québécoises. Au sein du territoire de la réserve privée de Kenauk, six sites ont été sélectionnés, incluant trois sites avec prolifération du hêtre (surface terrière occupée par des gaules de hêtre > 2 m2/ha) et trois sites de contrôle (surface terrière occupée par des gaules de hêtre < 0,5m2/ha). À chacun des sites, le suivi de deux parcelles de 400 m2 (20 x 20 m) a été fait, une parcelle avec un traitement d'exclusion artificielle des précipitations mis en place afin de simuler une sécheresse sévère et une parcelle de contrôle. Plusieurs suivis de transpiration ont été effectués. À l'aide de senseurs de dissipation thermique de type Granier, un suivi de la densité de flux de sève a été fait pour 87 arbres de juin à août 2022, principalement des érables à sucre (Acer saccharum) et des hêtres à grandes feuilles (Fagus grandifolia). La caractérisation du statut social des arbres a été effectué. Un suivi de l'humidité atmosphérique (déficit de tension de vapeur) et de l'humidité du sol a également été réalisé à chacune des parcelles. Les données recueillies permettront de mieux comprendre l'impact des changements globaux sur la transpiration des érablières québécoises.
Mots-clés: écologie forestière, écophysiologie, erable à sucre, hêtre à grandes feuilles, sécheresse, densité de flux de sève, prolifération du hêtre, transpiration
5 - Influences relatives d'un gradient climatique, de la structure forestière et des substrats sur les communautés de macrolichens de la côte nord du lac Supérieur (Ontario)
Rémi Boisvert
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Nicole Fenton (CEF, UQAT)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 05
La biosphère change rapidement et les données sur la biodiversité sont essentielles pour planifier l'aménagement du territoire et la conservation des espèces. Comme de nombreux taxons, les lichens sont menacés par la perte d'habitats, les changements climatiques et la pollution. Le développement des connaissances sur leurs patrons de distribution en forêt boréale et sur leur réponse aux conditions environnementales est primordial pour assurer leur conservation à long terme. Dans la forêt boréale, cependant, on en connaît peu sur l'importance du macroclimat en tant que déterminant des communautés de lichens.
Notre objectif est de déterminer les effets relatifs du macroclimat, de la structure forestière et des caractéristiques du substrat sur les communautés de macrolichens dans les forêts boréales mixtes de la côte nord du lac Supérieur (Ontario, Canada). Plus précisément, nous nous concentrons sur les réponses de la richesse des espèces, de la composition des espèces et de la diversité fonctionnelle.
Le lac Supérieur génère un gradient climatique qui s'étend jusqu'à 80 km de sa côte, influençant la température, les précipitations et l'humidité de l'air. Sur huit transects positionnés perpendiculairement à la côte, nous avons effectué des inventaires de macrolichens sur les épinettes, les bouleaux, les chicots et les surfaces rocheuses, et ce à différentes distances du lac. Des données relatives à la structure forestière et aux substrats ont également été recueillies.
Des PCoA préliminaires à l'échelle du site démontrent la différenciation de deux zones dans l'aire d'étude et que, dans chacune d'elle, la distance par rapport au lac a le plus d'impact sur la composition des communautés. Dans le contexte des changements climatiques, nos résultats aideront à anticiper d'éventuels changements dans la répartition des lichens en forêt boréale et pourraient être utilisés pour élaborer des plans de conservation à long terme de la biodiversité des lichens.
Mots-clés: biodiversité, écologie forestière
6 - Foresterie multifonctionnelle : est-il possible de favoriser à la fois la biodiversité et la séquestration du carbone ?
Clémence Boivin
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Xavier Cavard (CEF, UQAT)
- Nicole J. Fenton (CEF, UQAT)
- Mebarek Lamara (CEF, UQAT)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 06
Dans un contexte où les émissions de carbone sont deux fois supérieures à la situation préindustrielle, le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat tire la sonnette d'alarme, avec son 6ème rapport. Pour séquestrer plus de carbone, il est indispensable de s'appuyer sur les cycles biogéochimiques et les puits de carbone naturels, comme la forêt boréale du Québec. Jusqu'à récemment, la séquestration du carbone a été négligée dans l'étude des pratiques sylvicoles, au profit de la diversité spécifique. On propose d'étudier les traits fonctionnels d'effets de la végétation de sous-bois et du microbiome du sol, en lien avec la séquestration du carbone, sur un gradient allant de l'Est à l'Ouest de la forêt boréale du Québec, suite à différents traitements sylvicoles. On mesurera également les effets de l'herbivorie sur les stocks de carbone dans le sous-bois. Le microbiome du sol sera étudié grâce à l'ADN environnemental. Des échantillons de plantes vasculaires et de bryophytes seront prélevés dans le but de quantifier leur rôle dans les cycles biogéochimiques, via la mesure de traits foliaires comme la surface foliaire spécifique (SLA) et la teneur en matière sèche des feuilles (LDMC). Enfin, les traces de broutage par les mammifères herbivores seront quantifiées pour évaluer l'effet de l'herbivorie dans les stocks de carbone. Cette étude permettra de faire le lien entre la dynamique du carbone forestier et la diversité fonctionnelle de plusieurs groupes taxonomiques, et ainsi de déterminer dans quelles conditions les pratiques d'aménagement forestier durable peuvent assurer le maintien conjoint de ces deux importants services écosystémiques.
Mots-clés: écologie forestière, sylviculture, aménagement forestier écosystémique, bryophytes, carbone, herbivorie, microbiome du sol, traits fonctionnels, végétation de sous-bois
7 - De l'ADN pour contrôler la tordeuse des bourgeons de l'épinette ?
Sirine Boubeker
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAC, Centre intersectoriel en santé durable (CISD))
Autres auteurs
- Lionel Ripoll (Centre intersectoriel en santé durable (CISD))
- Ilga Porth (CEF, Université Laval)
- Catherine Girard (Centre intersectoriel en santé durable (CISD))
- Éric Bauce (CEF, Université Laval)
- Annie Deslauriers (CEF, UQAC)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 07
Les épidémies de la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) sont des perturbations naturelles et récurrentes en forêt boréale. Elles entraînent des ravages importants aux peuplements de conifères lorsque l'insecte se nourrit des bourgeons et du nouveau feuillage chez les épinettes et le sapin baumier. Le seul insecticide permis pour limiter les dommages causés par la TBE est le Btk, un insecticide microbien affectant tous les lépidoptères et causant, sur le terrain, environ 50% de mortalité chez les larves traitées. Au cours des dernières années, un effet inhibiteur de l'ADN conspécifique (l'ADN de la même espèce que celle ciblée) fut découvert chez les insectes et pourrait donc permettre le développement d'une nouvelle génération d'agents phytoprotecteurs. L'objectif global de cette recherche est de développer un agent phytoprotecteur pulvérisable, naturel, biodégradable et ciblé, contenant l'ADN fragmenté de la TBE (ADNfr) encapsulé. L'évaluation de la toxicité de l'ADNfr de la TBE a été effectué via la quantification des doses létales sur elle-même et un autre lépidoptère pour vérifier la spécificité du traitement. Pour cela, de l'ADN a été extrait à partir de larves de TBE, puis concentré et fragmenté au besoin. Les tests sont en cours sur des TBE où différentes doses (1, 3 et 5 µg) sont ingérées par les TBE. En parallèle, des nanocapsules ont été produites pour encapsuler le principe actif. Le contexte biochimique novateur dans lequel s'inscrit cette recherche, permettra de révolutionner le secteur industriel des pesticides et leurs gestions (notamment en agroalimentaire), en minimisant leurs dommages sur l'écosystème.
Mots-clés: foresterie, insecte ravageur, phytoprotection, écotoxicologie, pesticide, formulation, adn
8 - Dynamique des communautés végétales du sous-bois de la forêt boréale mixte de l'ouest du Québec.
Manon Carboni
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Nicole Fenton (CEF, UQAT)
- Yves Bergeron (CEF, UQAT)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 08
En forêt boréale mixte, la végétation de sous-bois comprenant les plantes vasculaires et invasculaires (bryophytes), est une des composantes les plus diversifiées de l'écosystème forestier. Ces communautés végétales de sous-bois sont très dynamiques, car elles sont influencées par de nombreux facteurs comme les perturbations naturelles, la succession du couvert forestier ou encore les variations environnementales à petite échelle. Par ailleurs, ces communautés végétales sont également importantes puisqu'elles influencent de façon directe ou non, la succession et la structure de la strate supérieure ainsi que le cycle des nutriments. L'objectif de cette étude est de comprendre les changements qui se produisent dans la strate des plantes herbacées du sous-bois, et d'évaluer la diversité des bryophytes après une perturbation par le feu au cours du temps. La chronoséquence étudiée s'échelonne sur plus de 200 ans après feu et montre une transition graduelle entre forêts feuillues dominées par le tremble, à une forêt de conifères dominée par le cèdre et le sapin baumier. La succession des plantes herbacées présentes du sous-bois suit le même schéma de succession que celle du couvert arborescent, c'est-à-dire, en début de succession on observe plus de plantes exigeantes en lumière et en éléments nutritifs. Par la suite, on suppose que des plantes plus tolérantes à l'ombre et moins exigeantes en nutriments devraient progressivement s'installer. De plus, les résultats renforcent l'idée que les plantes de sous-bois sont fortement associées aux effets de la luminosité et de la litière que produit le couvert arborescent présent. Les bryophytes montrent une diversité plus importante sur des sites où la perturbation par le feu est la plus ancienne, ce qui peut être expliqué par une présence plus importante de micro-habitat tel que le bois mort. Une bonne compréhension de cette relation est importante, notamment pour l'inclure dans les plans d'aménagement écosystémique.
Mots-clés: biodiversité, bryophytes, plantes herbacées
9 - Soil fungal communities in esker forests
Jonathan Cazabonne
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAT, Groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi)
Autres auteurs
- Miguel Montoro Girona (CEF, UQAT)
- Annie DesRochers (CEF, UQAT)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 09
Eskers are fluvioglacial geological formations providing natural resources important for the economy and the population. The associated fungal communities have barely been investigated to date. These ecosystems are vulnerable as they are highly sought over for water, wood, sand and gravel. As a result, fungal communities of esker forests might be threatened since most of these forests are being altered by human exploitation. This warrants the need to fill the gap in our fundamental knowledge and understanding of these communities, before it is irreversibly altered. Moreover, vertical spatial patterns and environmental factors shaping soil fungal communities remains misunderstood, especially in fluvioglacial deposits. This research project aims to characterize the fungal communities in esker podzols through their vertical spatial patterns, as one of the major drivers of soil fungal distribution. We will characterize the diversity, composition and structure of esker podzol fungal communities in Abitibi, as well as evaluate their spatial distribution from functional and taxonomic levels between esker and clay soils. For each soil horizon, abiotic (i.e., soil chemistry, including oxygen content) and biotic (i.e., root tip characteristics) factors will be measured, as well as soil fungal communities characterized through environmental DNA metabarcoding techniques. We expect that soil fungal communities will show distinct horizontal (esker versus clay) and vertical (between horizons) patterns and differences in fungal composition will be related to the magnitude of differences in soil chemistry. This project is the first molecular-based study to assess soil fungal communities of Abitibi esker forests. It will help us better understand the key role of soil fungi in the functioning of esker forest ecosystems, the spatial distribution of ecological niches, as well as how they are shaped by their environment. It fits into metagenomic-based and fungi-focused forest management perspectives and will contribute to the protection and conservation of esker forests' fungi.
Mots-clés: biodiversité, biologie moléculaire, environmental dna, mycodiversity, pinus banksiana, soil ecology, vertical patterns.
10 - Habitat selection by fisher (Pekania pennanti) in Quebec deciduous forest
Nathan Chabaud
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Louis Imbeau (CEF, UQAT)
- Marc Mazerolle (CEF, Université Laval)
- Pierre Drapeau (CEF, UQAM)
- Pauline Suffice (CEF, Université Laval)
- Marianne Cheveau (MFFP)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 10
The fisher (Pekania pennanti) is a North American mustelid. Found in Canada and the United States, it has declined sharply in the U.S. due to habitat alteration by agricultural intensification, urbanization, and forestry development. The fisher is associated with dense forest characteristics and closed canopies. Indeed, the structural complexity of this forest type provides resting structures and maternal dens. Thus, fishers are considered sensitive to forest management and are an indicator of forest health. The Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs in Quebec, eastern Canada, targets fisher as a forest management sensitive species in the yellow birch maple forest. Forests are composed of both hardwood and softwood species in this bioclimatic area. Softwood forests appear to be a suitable environment for fisher in winter, retaining some of the snowfall and thus reducing the energy cost of moving fisher. One of the goals of this project is the creation of a forest management tool, accounting for forest structure and composition available on forestry maps, in the form of a habitat quality model for fisher. The first step of the project is to characterize habitat selection by fisher at the stand scale. Between November 2021 and March 2022 we captured and fitted GPS collars (Iridium TGW-4170-4 and GlobalStar TGW-4065-4, Telonics, Mesa, Arizona, USA) on 30 fisher, 13 females and 17 males, in the Témiscamingue region of Quebec. The monitoring period covered the winter (December-March) and the calving seasons (March-April). We present here the preliminary results of the GPS tracking in terms of home range size and habitat selection.
Mots-clés: faune, écologie forestière, pekania pennanti, sélection d'habitat, collier gps
11 - Combiner les arts et la science pour cartographier les territoires autochtones
Kloé Chagnon-Taillon
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAT, CEF-UQO)
Autres auteurs
- Hugo Asselin (CEF, UQAT, Chaire Desjardins en développement des petites collectivités, L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue)
- Jérôme Dupras (CEF, UQO, Chaire de recherche du Canada en économie écologique)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 11
Les arts et les sciences sont des domaines abordés de façon distincte, alors qu'ils ont un point commun : la créativité. Les méthodes basées sur les arts (MBA) représentent pourtant une avenue intéressante et peuvent être utiles à plusieurs étapes du processus de recherche. Au sein d'un projet de cartographie participative, les MBA permettent : (A) de couvrir de multiples dimensions qui ne peuvent pas toujours s'exprimer par des mots et qui ne correspondent pas toujours à des lieux précis (B) de faciliter la communication de connaissances tacites (C) de dévoiler les émotions et d'autres aspects intangibles liés à l'utilisation de certains lieux et par conséquent (D) de mieux comprendre la complexité du lien au territoire. Dans le cadre d'un projet en partenariat avec le MELCC visant à développer des outils pour la mise en place d'aires protégées au Québec, cette étude tentera de développer une méthodologie d'identification et d'évaluation des services écologiques (SE) basée sur les perspectives et les savoirs autochtones, intégrant les valeurs tangibles et intangibles associées au territoire. Des ateliers de cartographie participative seront réalisés en utilisant différentes MBA dans le but d'identifier et de cartographier les SE prioritaires au sein d'un territoire identifié pour un projet d'aire protégée. Cette étude se basera notamment sur des séances de draw, write and tell, des cercles de partage inspirés de la méthode photovoice, ainsi que des ateliers de cartographie par le dessin utilisant l'approche des chorèmes.
Arts and science are commonly approached in a distinct way, although they have one thing in common: creativity. Arts-based methods (ABM) represent an interesting avenue and can be useful at several stages of the research process. Within a participatory mapping project, ABMs make it possible: (A) to cover a wide range of dimensions that sometimes cannot be expressed with words, and which do not always correspond to specific places (B) to facilitate the communication of tacit knowledge (C) to reveal emotions and other intangible aspects of how places are used and consequently (D) to better understand the complexity of people's link to the land. As part of a project in partnership with the MELCC aimed to develop tools for the implementation of protected areas in Quebec, this study will attempt to develop a methodology for identifying and evaluating ecological services (ES) based on Indigenous perspectives and knowledge, integrating the tangible and intangible values associated with the land. Participatory mapping workshops will be carried out using different ABMs to identify and to map priority ES within a territory identified for a protected area project. This study will be based in particular on draw, write and tell sessions, sharing circles inspired by the photovoice method, as well as drawing mapping workshops using the choreme approach.
Mots-clés: écologie forestière, foresterie sociale, cartographie, services écosystémiques, autochtones, lien au territoire, art et sciences
12 - Exposition des cyclistes de Montréal aux pollens allergènes
Gabriel Davidson-Roy
Étudiant(e) au baccalauréat (CEF, UQAM)
Autres auteurs
- Sarah Tardif (CEF, UQAM)
- Rita Sousa-Silva (Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) - University of Freiburg)
- Alain Paquette (CEF, UQAM)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 12
Avec l'augmentation du nombre d'arbres mâles plantés et l'allongement de la saison pollinique, les concentrations de pollen augmentent et de plus en plus de personnes développent des allergies et de l'asthme. En raison de leur niveau d'activité physique, les cyclistes ventilent plus d'air que les personnes à pied, ils sont donc davantage exposés aux pollens et aux allergies. Les pistes cyclables de Montréal n'étant pas bordées de végétation identiquement, l'exposition des cyclistes aux pollens allergènes pourraient varier. Dans cette étude de cas, des échantillonneurs portables ont été montés sur des bicyclettes pour échantillonner le pollen le long de transects de 10 minutes couvrant une gamme de couvertures arborées et herbacées différentes, le long de deux itinéraires cyclables les plus populaires de Montréal, le Canal Lachine et le REV Saint-Denis. Les résultats préliminaires des analyses révèlent que les cyclistes du Canal Lachine inhalent en moyenne trois fois plus de pollens que les cyclistes du REV Saint-Denis. Dans le futur, une application pratique des résultats d'une telle étude de cas serait la prise en compte des données polliniques lors de la conception ou de la modification des systèmes de partage de vélos afin de maximiser leur utilisation. Les mêmes informations pourraient être utilisées dans les applications de fitness populaires que les gens utilisent pour planifier des itinéraires de cyclisme et de course à pied. L'importance de ces études de cas réside également dans leur capacité à alimenter les modèles de prévision des concentrations de pollen et des charges sanitaires liées au pollen.
Mots-clés: écologie forestière, santé humaine, foresterie urbaine
13 - Influence des traits fonctionnels de tolérance et de dispersion sur la vélocité de migration des arbres du nord-est de l'Amérique du Nord
Mégane Déziel
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAM)
Autres auteurs
- Alain Paquette (CEF, UQAM)
- Dominique Gravel (CEF, Université de Sherbrooke)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 13
Les changements globaux engendrent le déplacement des niches écologiques de plusieurs espèces d'arbres, menant à un réassemblage spatial des communautés forestières ainsi qu'à des modifications dans la répartition et l'abondance des processus et services écosystémiques qu'elles assurent. Pour mieux prédire les futurs patrons de distribution des espèces, il est de mise d'améliorer notre compréhension des facteurs gouvernant la migration. La variabilité interspécifique de traits fonctionnels liés à la tolérance, à l'adaptation ainsi qu'aux capacités intrinsèques de reproduction et de dispersion pourrait s'avérer être particulièrement déterminante pour expliquer les capacités des espèces à se déplacer en fonction du climat. Cette étude vise à évaluer comment les attributs fonctionnels des arbres sont liés à leurs vélocités de migration des 40 dernières années. Pour ce faire, nous avons d'abord utilisé des données d'inventaires forestiers du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et du nord-est des États-Unis afin de modéliser la répartition spatiale de plusieurs espèces à différents intervalles de temps en fonction de variables environnementales selon l'algorithme Random Forest. À l'aide de ces modèles, nous avons généré des cartes montrant la répartition spatiale continue des espèces pour le nord-est de l'Amérique du Nord pour les périodes temporelles 1980 à 1989 et 2010 à 2019. Pour chaque 1 km de longitude, nous avons ensuite calculé les vélocités de migration vers le nord des aires répartition entre les deux périodes temporelles. Pour expliquer la relation entre les vélocités et les traits fonctionnels des arbres, ces données de vélocités ont finalement été couplées à des valeurs spécifiques de traits fonctionnels tirées de la littérature afin de paramétrer un modèle linéaire généralisé mixte.
Mots-clés: écologie forestière, dynamique des populations, dynamique des aires de distribution, traits fonctionnels
14 - La diversité de structure et de composition des vieilles forêts boréales mixtes du Québec fournit-elle des habitats différents pour l'avifaune?
Ines Diamant
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAC)
Autres auteurs
- Maxence Martin (CEF, UQAC, CEF-UQAT)
- Jacques Ibarzabal (CEF, UQAC)
- Junior A. Tremblay (Environnement et Changement Climatique Canada)
- Hubert Morin (CEF, UQAC)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 14
Les forêts boréales sont souvent perçues comme un ensemble homogène, alors qu'elles se définissent en réalité par une grande diversité structurelle. Cette hétérogénéité qui caractérise les vieilles forêts offre de nombreux habitats spécifiques, pouvant profiter à de nombreuses espèces d'oiseaux. Cependant, depuis les dernières décennies, l'aménagement forestier contribue au rajeunissement, à l'homogénéisation et à la fragmentation des paysages boréaux. La perte de structures et/ou d'attributs spécifiques des vieilles forêts boréales, tels les débris ligneux ou les arbres-habitats, peuvent avoir des conséquences sur les espèces forestières qui en dépendent. Ce projet a pour but de comprendre comment les attributs structuraux des vieilles forêts boréales et leurs combinaisons affectent les communautés d'oiseaux. Notre objectif est de déterminer comment la composition des communautés d'oiseaux varie en fonction de différents attributs structuraux des vieilles forêts ainsi que du stade de succession. Le territoire d'étude se situe dans le Parc National des Monts-Valin dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay. Nous avons sélectionné 40 placettes, 20 placettes en vieilles forêts "en transition" (brûlées il y a 90 ans) et 20 autres en vieilles forêts "avancée" (non-brûlées depuis au moins 130 ans), dans lesquelles ont été inventoriés des attributs structuraux, dont les dendromicrohabitats et les débris ligneux. Des enregistreurs bioacoustiques ont été installés dans chaque placette, dans le but d'identifier les différentes espèces d'oiseaux et leur abondance. Nous nous attendons à observer des assemblages d'oiseaux différents selon la présence d'attributs structuraux précis (chicots, diversité des dendromicrohabitats) dépendant partiellement du stade de succession, ici en combinaison avec les conditions environnementales et l'impact des perturbations secondaires récentes. En quantifiant la présence de certains attributs structuraux, ce projet permettra de diriger de manière plus efficace les efforts de conservation et de restauration des vieilles forêts dans le contexte de l'aménagement forestier écosystémique.
Mots-clés: écologie forestière, faune, dendromicrohabitats, débris ligneux, avifaune, vieilles forêts, forêt boréale mixte
15 - La diversité des espèces d'arbres façonne la structure du couvert forestier boréal
Laurie Dupont-Leduc
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAR)
Autres auteurs
- Robert Schneider (CEF, UQAR)
- Hugues Power (MFFP)
- Richard Fournier (CEF, Université de Sherbrooke)
- Mathieu Fortin (Ressources naturelles Canada, Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB))
- Olivier van Lier (Ressources naturelles Canada, Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB))
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 15
Il existe un consensus scientifique sur le gain en productivité forestière associé à une plus grande diversité en espèces. Toutefois, les mécanismes à l'œuvre restent mal compris. La complémentarité spatiale des houppiers pourrait être un des facteurs déterminants. Pour expliquer comment la diversité modifie l'utilisation de l'espace disponible dans le couvert forestier, nous avons étudié la relation entre la diversité des espèces d'arbres et la structure du couvert en forêt boréale à partir d'un réseau de placettes échantillons disposant à la fois de relevés d'inventaire forestier et de relevés de lidar aéroporté. Nous avons utilisé une approche de modèles Random Forest pour mettre en relation la structure du couvert décrite à l'aide des métriques lidar et des variables décrivant la structure de la forêt, l'environnement et la diversité fonctionnelle. À travers un gradient de diversité, les résultats démontrent que les arbres peuvent optimiser l'utilisation de l'espace grâce à la plasticité de leurs houppiers, permettant ainsi un remplissage plus dense du couvert forestier. En effet, les communautés à faible masse foliaire par unité de surface (LMA) se sont avérées avoir un couvert forestier fermé, caractérisé par des houppiers poreux de faible densité, avec peu de variabilité horizontale et verticale. Ces arbres occupaient plus d'espace, produisant un couvert dense et homogène. En revanche, dans les communautés à LMA élevée, les couverts étaient plus hétérogènes, en partie à cause de la morphologie de leurs houppiers. Ces résultats fournissent une preuve de la contribution significative de la diversité à la structure du couvert forestier. De plus, puisque la structure du couvert a été associée avec succès à des variables obtenues par le biais d'inventaires forestiers traditionnels, de nouvelles avenues de recherche sont maintenant possibles puisque nos modèles peuvent prédire la structure de forêt sans données lidar.
Mots-clés: écologie forestière, biodiversité
16 - Caractérisation de la voirie forestière et de ses effets sur les macroinvertébrés aquatiques en Outaouais
Cecilia Estable
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQO)
Autres auteurs
- Katrine Turgeon (CEF, UQO)
- Audrey Maheu (CEF, UQO)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 16
Un important réseau de chemins forestiers parsème le territoire québécois et différentes études ont montré l'absence d'entretien des chemins et traverses de cours d'eau. Cette étude vise i) à décrire l'état des chemins et des traverses de cours d'eau dans les forêts publiques et privées de l'Outaouais et ii) évaluer leur influence sur la composition et la biodiversité des communautés de macroinvertébrés aquatiques. Premièrement, nous avons recensé l'état des chemins et des traverses de cours d'eau dans des terres sous tenure publique et privée dans deux zones de l'Outaouais, soit le Pontiac et la Petite Nation. L'état structurel des ponceaux a été évalué au cours de l'été 2022. L'état des chemins forestiers contigus aux ponceaux a également été évalué afin de recenser la présence d'érosion ainsi que la perte de surface de roulement associée à la reprise de la végétation. Deuxièmement, nous avons échantillonné les macroinvertébrés aquatiques en amont et en aval de ponceaux. Nous avons sélectionné des sites i) ayant des ponceaux avec un bon état structurel vs. un état de dégradation avancé et ii) ayant un chemin avec vs. sans entretien récent. Le temps depuis le dernier entretien routier a été caractérisé à partir de la perte de surface de roulement associée à la végétation. À partir de ces données, il est prévu d'évaluer l'effet de l'état des chemins et des ponceaux sur l'abondance de macroinvertébrés, la richesse spécifique et la présence de taxons intolérants. Ce projet permettra de guider les meilleures pratiques de surveillance et d'entretien pour encadrer la voirie forestière en terre publique et privée
Mots-clés: biodiversité, aménagement
17 - Effets des traitements sylvicoles sur les flux de carbone des épinettes noires (Picea Mariana (Mill.) B.S.P.) en réponse à la disponibilité en eau.
Axelle Favro
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Xavier Cavard (CEF, UQAT)
- Fabio Gennaretti (CEF, UQAT)
- Jérôme Laganière (CEF, UQAM)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 17
Les forêts boréales couvrent près de 11% de la surface terrestre. Au Canada, l'épinette noire (EPN) est l'une des principales espèces dominantes formant des peuplements capable de stocker d'importantes quantités de carbone et jouant un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. Ce dernier se traduit notamment par une augmentation de la fréquence et de la durée des épisodes de sécheresse à laquelle l'EPN pourrait être particulièrement sensible. Une modification de sa croissance ou de sa survie pourrait entraîner des changements majeurs pour les écosystèmes du Canada, notamment dans le stockage du carbone forestier.
Dans ce contexte, nous pouvons nous demander quel traitement serait le plus adapté pour répondre à la demande grandissante en produits ligneux tout en favorisant la séquestration du carbone en forêt. Toutefois, des incertitudes demeurent quant à leurs effets sur la dynamique du carbone forestier. Pour étudier l'impact des traitements sylvicoles sur les flux de carbone des EPN en réponse aux variations météorologiques susceptibles d'induire un stress hydrique, nous chercherons à : déterminer l'influence de différents types de coupe sur la xylogénèse des EPN déterminer l'effet de ces traitements sur la dynamique des racines fines, et enfin étudier leur impact sur la respiration du sol en fonction de la disponibilité en eau. Pour répondre à ces questions, nous considérerons la coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) suivie de plantation, la CPRS suivie de scarifiage et de plantation (CPRS-S), ainsi que l'éclaircie commerciale (EC). Les prélèvements et les suivis se feront grâce à des microcarottages, la mise en place de minirizotrons, des carottes de sol, ainsi qu'un suivi continu des conditions microclimatiques dans des peuplements d'épinettes noir traités il y a 15 - 20 ans et des témoins matures de 50 ans.
Boreal forests cover nearly 11% of the earth's surface. In Canada, black spruce (BS) is one of the main dominant species forming stands capable of storing large quantities of carbon and playing an important role in the fight against climate change. BS may be particularly sensitive to the resulting increase in frequency and duration of drought events. A change in its growth or survival could lead to major changes in Canada's ecosystems, particularly in forest carbon storage.
In this context, we can ask ourselves what treatment would be the most appropriate to meet the growing demand for wood products while promoting carbon sequestration in the forest. However, uncertainties remain regarding their effects on forest carbon dynamics. To study the impact of silvicultural treatments on BS carbon fluxes in response to meteorological variations likely to induce water stress, we will seek to : determine the influence of different cuts on BS xylogenesis determine the effect of these treatments on fine root dynamics and study their impact on soil respiration in relation to water availability. To answer these questions, we will consider cutting with regeneration and soil protection (CPRS) followed by planting, CPRS followed by scarification and planting (CPRS-S), and commercial thinning (CT). Sampling and monitoring will be carried out using micro-coring, minirizotrons, soil cores, and continuous monitoring of microclimatic conditions in 15-20 year old treated BS stands and 50 year old mature controls.
Mots-clés: écologie forestière, écophysiologie, épinettes noires, changement climatique, dynamique du carbone, traitements sylvicoles, xylogénèse, respiration du sol, racines fines.
18 - Microbiomes associés aux peuplements multi-clonaux de peuplier faux-tremble
Océane Fogliani
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Yves Bergeron (CEF-UQAT/UQAM)
- Christine Martineau (Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Mebarek Lamara (CEF, UQAT)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 18
Le peuplier faux-tremble (Populus tremuloïdes) est l'espèce à croissance rapide la plus largement répandue dans la forêt boréale mixte de l'Est canadien. La capacité de cette espèce d'envahir les milieux perturbés est liée à sa capacité de se reproduire facilement par drageonnement. Ce phénomène par lequel des individus génétiquement identiques apparaissent de manière clonale pourrait conduire à une diminution de la diversité génotypique (clonale) dans les peuplements et, par conséquent, à une diminution de la résilience aux changements climatiques. Le peuplier faux-tremble a, non seulement un intérêt écologique important, mais aussi un intérêt socio-économique pour les nombreux services écosystémiques rendus et pour lesquels il est valorisé. Ces services écosystémiques du peuplier sont influencés par plusieurs facteurs dont les micro-organismes qui lui sont associés. La composition chimique des feuilles de peupliers pourrait varier selon le génotype et sa litière pourrait donc influencer la composition des communautés microbiennes des sols. L'objectif principal du projet est de déterminer l'influence du génotype du peuplier faux-tremble sur la structure et la composition des communautés végétales du sous-bois et sur le microbiome des racines et du sol. Cette étude vise à 1) déterminer l'influence du génotype sur la chimie des feuilles, 2) caractériser la composition du sous-bois et 3) analyser la composition, la diversité et l'abondance des communautés microbiennes de l'endosphère racinaire, et du sol rhizosphérique. La technique du métabarcoding (séquençage à haut débit des amplicons) sera utilisée pour étudier les communautés bactériennes et fongiques des différents types d'échantillons. Cette étude sera réalisée sur 10 clones de peupliers faux-tremble situés à la forêt d'enseignement et de recherche du Lac Duparquet.
Mots-clés: écologie forestière
19 - Urbanisation and insects: urban forests as sites of refuge?
Jérémy Fraysse
Étudiant(e) au doctorat (CEF, Université de Sherbrooke)
Autres auteurs
- Alain Paquette (CEF, UQAM)
- Isabelle Laforest-Lapointe (CEF, Université de Sherbrooke)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 19
Biodiversity is more than a scientific research topic it is now an important societal, political and economic issue. From the microscopic scale of microorganisms to the macroscopic scale of animals and plants, biodiversity supports innumerable ecosystem services that are crucial for societies worldwide. The intensification of human activities and the disturbance of habitats, linked in particular to increasing urbanization, are significantly affecting biodiversity. No other environment is changing and developing as rapidly as the urban environment. It is therefore imperative to understand the links between urban biodiversity and ecosystem services in cities in order to document and support sustainable management of urban ecosystems.
Despite the excitement surrounding urban ecology research, the effect of urbanization on the evolution of organisms is still poorly understood. Urbanization is indeed an important driver of biodiversity change and the knowledge and concepts of classical ecology are difficult to apply in the context of cities. While it is commonly accepted that urban expansion has a negative impact on many species groups, it can also be beneficial for others. Recent studies have shown that our cities could represent refuges for certain species and notably insects.
My research project is part of a multidisciplinary project supported by the New Frontiers Research Fund and focuses on studying insect communities across an urban and vegetation gradient. One aspect of this project is to study the biodiversity of insects in urban forests and the biogeographic dynamics that apply to their populations. Although still in its early stages, it will be a great pleasure to be available to present my research proposal and its experimental design at the 15th CFR Annual Conference.
At a time when global warming and its impacts are ever increasing, it is important not to neglect any living group. And urban forests could represent a hitherto unsuspected reservoir of biodiversity in entomofauna.
Plus qu'un sujet de recherche scientifique, la biodiversité est désormais un enjeu sociétal, politique et économique important. De l'échelle microscopique des microorganismes à l'échelle macroscopique des animaux et des plantes, la biodiversité supporte d'innombrables services écosystémiques, cruciaux pour les sociétés à travers le monde. L'intensification des activités anthropiques et la perturbation des habitats, liées notamment à l'urbanisation croissante, affectent de manière importante la biodiversité. Aucun autre environnement n'évolue et ne se développe aussi rapidement que l'environnement urbain. Il est donc impératif de comprendre les liens entre biodiversité urbaine et services écosystémiques en ville afin de documenter et accompagner une gestion durable des écosystèmes urbains.
Malgré l'engouement autour des recherches en écologie urbaine, l'effet de l'urbanisation sur l'évolution des organismes est encore mal compris. L'urbanisation est en effet un facteur important de changements et les connaissances et notions en écologie classique sont difficilement applicables dans le contexte des villes. S'il est couramment admis que l'expansion de ces dernières a un impact négatif pour de nombreux groupes d'espèces, elles peuvent aussi être bénéfiques pour d'autres. De récentes études ont montré que nos villes pourraient représenter des refuges pour certaines espèces, notamment d'insectes.
Mon projet de recherche s'inscrit dans un projet multidisciplinaire soutenu par le Fonds Nouvelles Frontières en Recherche et se concentre sur l'étude des communautés d'insectes à travers un gradient urbain et végétal. L'un des aspects de ce projet et notamment d'étudier la biodiversité des insectes dans les forêts urbaines et les dynamiques de biogéographie qui s'appliquent à leurs populations. Bien qu'encore à ses débuts, c'est avec un immense plaisir que je me rendrai disponible pour présenter ma proposition de recherche et son design expérimental lors du 15e Colloque du CEF.
À l'heure où le réchauffement climatique et ses impacts sont toujours plus importants, il est important de ne négliger aucun groupe du vivant. Et les forêts urbaines pourraient représenter un réservoir de biodiversité en entomofaune jusqu'ici insoupçonné.
Mots-clés: biodiversité, écologie forestière, urban forestry, entomology, urbanisation, ecology, dynamic biogeography
20 - Prescribed burning as a restoration tool for white and red pines
Sylvain Gagnon
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAT, RnCan-CFL)
Autres auteurs
- Yves Bergeron (CEF, UQAT, CEF-UQAM)
- Jonathan Boucher (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Anne Cotton-Gagnon (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Mélanie Nicoletti (CEF, UQAT)
- Tadeusz Spalwinski (CEF, UQAT, Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO))
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 20
In eastern North America, white pine (Pinus strobus L.) and red pine (Pinus resinosa Aiton.) have been experiencing a marked decline in abundance since industrialization. This is due to multiple factors, including logging and reduced fire recurrence. Prescribed fire is a technique used for restoring habitat and population of white and red pines. However, the use of prescribed burn in a silvicultural context favoring these pine species is not well integrated due to a lack of science-based guidelines. The objective of this project is thus to identify the best post-fire conditions for the establishment of white and red pine seedlings in the northern part of their range, in order to define the optimal parameters for the use of prescribed fire in terms of intensity. It is hypothesized that medium-severity fires would offer the best conditions for pine regeneration by causing a sufficient reduction in plant and tree competition, allowing adequate canopy opening, while forming better seedbeds, through the reduction of the organic layer from combustion. Field inventory was conducted in three different regions that burned between 2016 and 2018: La Mauricie National Park, Opémican National Park in Témiscamingue (QC), and the Temagami region (ON). Inventory included dendrometric measurements, characterization of pine regeneration, characterization of herbaceous and shrubby competition, characterization of pine seedlings seedbed as well as visual assessment of fire severity to estimate the intensity of fire passage. Generalized linear mixed modeling will be used to model seedling density and seedbed quality and quantity as a function of fire severity and stand characteristics. Preliminary results indicate a quadratic effect of severity on white and red pine seedling establishment with an optimal situation associated with medium severity fires.
Dans l'est de l'Amérique du Nord, le pin blanc (Pinus strobus L.) et le pin rouge (Pinus resinosa Aiton.) connaissent un déclin marqué de leur abondance depuis l'industrialisation. De multiples facteurs en sont à l'origine, dont l'exploitation forestière et la diminution de la récurrence des feux. Le brûlage dirigé est une technique utilisée pour restaurer l'habitat et la population des pins. Cependant, l'utilisation du brûlage dirigé dans un contexte sylvicole favorisant ces espèces de pins n'est pas bien intégrée en raison d'un manque de connaissances. L'objectif de ce projet est donc d'identifier les meilleures conditions post-incendie pour l'établissement de semis de pins blancs et rouges dans la zone nord de leur aire de répartition afin de définir les paramètres optimaux pour l'utilisation du brûlage dirigé en termes d'intensité. L'hypothèse est que les feux de sévérité moyenne offriraient les meilleures conditions pour la régénération des pins en provoquant une réduction suffisante de la concurrence entre les plantes et les arbres, permettant ainsi une ouverture adéquate de la canopée tout en formant de meilleurs lits de semences, et ce, grâce à la réduction de la couche organique issue de la combustion. L'inventaire de terrain a été réalisé dans trois régions différentes qui ont brûlé entre 2016 et 2018 : le Parc national de la Mauricie, le Parc national de l'Opémican au Témiscamingue (QC) et la région de Temagami (ON). L'inventaire comprenait des mesures dendrométriques, la caractérisation de la régénération des pins, la caractérisation de la compétition herbacée et arbustive, la caractérisation du lit de semence des semis de pins ainsi que l'évaluation visuelle de la sévérité du feu pour estimer l'intensité du passage du feu. Une modélisation linéaire mixte généralisée sera utilisée pour modéliser la densité des semis ainsi que la qualité et la quantité du lit de germination en fonction de la sévérité du feu et des caractéristiques du peuplement. Les résultats préliminaires indiquent un effet quadratique de la sévérité sur l'établissement des semis de pins blancs et rouges avec une situation optimale associée à des feux de sévérité moyenne.
Mots-clés: écologie forestière, sylviculture, eastern white pine, red pine, prescribed burning, ecosystem restoration, regeneration, seedbed preparation
21 - Consequences of climate change for the duration of the high light period for early spring flowering herbs in northern forests.
Hasanki Gamhewa
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, Université de Sherbrooke)
small email
Autres auteurs
- Anna Anna L. Crofts (CEF, Université de Sherbrooke)
- Mark Vellend (CEF, Université de Sherbrooke)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 21
Background/Question/Methods:
The spring period of high light in the deciduous forest understory is crucial for the yearly photosynthesis of early spring herbs that leaf out prior to canopy trees. The duration of this high light period could be disrupted or enhanced, if herbs and trees respond differently to climate warming. In this study, we examined the effects of spatial and temporal variation in spring temperature on the timing of leaf expansion of the early spring herb, red trillium (Trillium erectum) and the overstory canopy, which was predominantly composed of sugar maple (Acer saccharum) and yellow birch (Betula alleghaniensis). We used estimates of phenology derived from automated cameras from 2017 to 2021 across 10 sites along an elevational gradient in Mont Mégantic National Park, Québec, Canada (n = 50 site-year combinations).
Results/Conclusion: Both T. erectum and the tree canopy were sensitive to spatial and temporal changes in spring temperature, with earlier leaf expansion occurring at warmer sites (i.e., low elevations) and in warmer years. We found that the effect of spatial temperature (i.e., elevation) on leaf expansion was greater for the overstory than the understory (t = 3.3, p = 0.001), resulting in a shorter high light period at warmer, low elevations than at colder, high elevations. In contrast, the effect of temporal temperature was greater for understory spring herbs than the overstory canopy trees (t = - 3.7, p = 0.0003), resulting in a longer high light period in warmer years. Our results indicate that in the short term, as warming occurs, understory spring herbs may benefit from a greater high light period, but in the long term as the overstory tree composition changes, understory spring herbs might experience a shorter period of high light.
22 - Évaluation des risques actuels d'effondrement des écosystèmes forestiers en forêt tempérée québécoise
Nejm Eddine Jmii
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQO)
Autres auteurs
- Frédérik Doyon (CEF, UQO)
- Marie-Hélène Brice (CEF, Université de Montréal)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 22
Les impacts des changements globaux, particulièrement ceux climatiques sont déjà perçues sur la fréquence et/ou l'intensité des évènements extrêmes et des perturbations assez élevées. Ces changements créent des conditions spécifiques conduisant le plus souvent à des réponses abruptes des écosystèmes qui, dans certains cas, subissent un effondrement écosystémique (EÉ). Ce phénomène se produit lorsqu'un écosystème change drastiquement du point de vue de sa composition, structure et de son fonctionnement. En forêt tempérée québécoise, l'EÉ est principalement observé lorsqu'une strate de végétation basse en vient à prendre le contrôle de la lumière et ainsi à empêcher l'établissement de la régénération des espèces d'arbres. La mise en œuvre des stratégies de gestion est donc nécessaire pour lutter contre l'effondrement. Or, il est difficile de formuler des pratiques de gestion efficaces sans connaître l'ampleur actuelle de ce phénomène, ses mécanismes d'action (patrons et processus) et l'importance que prendra ce phénomène dans le futur. Dès lors, nous cherchons à documenter ce phénomène d'EÉ dans la zone tempérée nordique pour mieux comprendre les mécanismes qui en sont responsables et voir à estimer comment ce phénomène évoluera sous changement globaux. Ce projet offrira des connaissances et des outils aux intervenants du secteur forestier afin de faciliter la prise de décisions concernant la prévention de l'EÉ des forêts tempérées et ainsi atténuer les risques face aux changements globaux.
Mots-clés: dynamique des populations, historique des perturbations, changement climatique, forêt tempérée du nord-est de l'amérique du nord, dynamique forestière, résilience, perturbations, changement d'état, transition bassin d'attraction, effondrement écosystémique
23 - La planification systématique de la conservation peut-elle faciliter la cohabitation du caribou forestier et de l'aménagement forestier?
Pierre-Alexandre Labranche
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, Université Laval)
Autres auteurs
- Monique Poulin (Centre de la science de la biodiversité du Québec (CSBQ))
- Jérôme Cimon-Morin (CEF, Université Laval)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 23
La protection d'espaces naturels est une des stratégies largement employées pour freiner le déclin de la biodiversité. Cette stratégie est toutefois limitée par l'exploitation des ressources naturelles nécessaires pour satisfaire les besoins humains. Or, certaines espèces sont particulièrement sensible aux perturbations anthropiques de leurs habitats. C'est notamment le cas du caribou forestier (Rangifer tarandus caribou) pour lequel l'aménagement forestier et ses impacts indirects sont parmi les principales menaces à son maintien au sud de la limite nordique des forêts attribuables. Trouver un compromis entre l'exploitation des ressources ligneuses et le maintien du caribou est ainsi un défi majeur pour la conservation du 21e siècle.
La planification systématique de la conservation (PSC) est un outil d'aide à la décision développé pour favoriser l'atteinte des objectifs de conservation tout en minimisant les impacts sur les activités économiques. Mais bien que la PSC fut brièvement utilisée pour établir le réseau actuel d'aires protégées au Québec, elle n'a jamais été employée pour la conservation du caribou forestier.
Notre projet de recherche vise ainsi à développer une approche de PSC adaptée à la réalité du caribou forestier au Québec, dont une grande portion de l'habitat est soumise à la récolte des ressources ligneuses. Nous utiliserons le logiciel Marxan et ses extensions (Connect, Probability, Zones) pour réaliser des réseaux de conservation qui intégreront à la fois les paramètres écologiques du caribou et la valeur de la forêt pour l'industrie. Nos analyses nous permettront de comparer des réseaux visant uniquement la protection du caribou avec d'autres ayant pour objectif une conciliation entre le maintien du caribou et de l'aménagement forestier. Ce processus d'optimisation pourra ensuite servir d'exemple ailleurs au Canada et dans le monde.
Mots-clés: biologie de la conservation, aménagement, foresterie, planification systématique de la conservation, marxan, aires protégées
24 - Quels impacts ont les perturbations sur la dynamique des pinèdes?
Janie Lavoie
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT, Institut de recherche sur les forêts (IRF), Groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi (GREMA))
Autres auteurs
- Miguel Montoro Girona (CEF, UQAT, Institut de recherche sur les forêts (IRF), Groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi (GREMA))
- Yves Bergeron (CEF, UQAT, Institut de recherche sur les forêts (IRF))
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 24
Avec le déclin des peuplements de pin rouge (Pinus resinosa Ait.) et de pin blanc (Pinus strobus L.), il devient crucial de développer des pratiques forestières durables qui visent à rétablir leur dynamique naturelle en émulant les effets des perturbations naturelles. Dans cette optique, l'aménagement forestier écosystémique a été mis en place. Malgré ces efforts, les impacts des perturbations naturelles secondaires des pinèdes ne sont pas considérés dans les solutions d'aménagement. Parmi celles-ci, les épidémies de la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE Choristoneura fumiferana Clems.) font particulièrement des ravages dans l'aire de répartition nordique des pins rouges et blancs. En sachant que les fréquences et les intensités de ces épidémies tendent à augmenter avec les changements climatiques, il est primordial d'en apprendre davantage sur les effets de cet insecte sur la dynamique de la régénération des pinèdes ainsi que l'interaction entre les coupes forestières et les perturbations secondaires. Ce projet vise à répondre à trois questions spécifiques : (1) est-ce que l'épidémie de la TBE influence l'établissement de la régénération des pinèdes?, (2) est-ce que la TBE influence le patron de biodiversité des pinèdes? et (3) quels impacts ont les perturbations multiples sur la dynamique des pinèdes? Pour y répondre, six peuplements affectés par la TBE, six peuplements de coupe progressive irrégulière (CPI), six peuplements doublement perturbés (Coupe partielle + TBE) et six peuplements non perturbés seront sélectionnés dans la forêt boréale mixte, plus précisément dans la sapinière à bouleau jaune et l'érablière à bouleau jaune localisés dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour chacun des sites, la caractérisation biotique (compositions végétales, hauteurs, DHP, etc.) et abiotique (luminosité, type et composition du sol) des peuplements seront faites. Parmi les mesures, la croissance et l'abondance de la régénération de pins, le recouvrement des espèces végétales et l'échantillonnage de carottes d'arbres permettront de répondre aux questions de recherche. Cette étude permettra d'évaluer l'impact de la TBE dans la dynamique des pinèdes à pin blanc et rouge.
Mots-clés: écologie forestière, sylviculture, biodiversité, choristoneura fumiferana, croissance radiale, dendrologie, écologie des perturbations, pinus resinosa, pinus strobus, régénération, sylviculture
25 - Dynamique hydrologique d'un lac urbain et des milieux humides environnants
Samuel Le Vallée-Valdés
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQO)
Autres auteurs
- Audrey Maheu (CEF, UQO)
- Marie Larocque (Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie (GRIL-UQAM))
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 25
Le lac Beauchamp situé à proximité du centre-ville de Gatineau aperçoit une dégradation progressive de son écosystème. Le pompage d'eau souterraine vers le lac a été proposé comme une solution à la ville de Gatineau pour résoudre la problématique de qualité d'eau du lac. Le pompage viendrait directement augmenter le niveau d'eau, facilitant ainsi un renouvellement accéléré de l'eau. Ce projet de maîtrise vise à faire le point sur l'effet du pompage sur deux aspects distincts de l'écosystème: le lac et les milieux humides. Des mesures initiales de différents flux hydriques ont été faites durant l'année 2022, pour pouvoir ensuite les comparer à celles suivant le pompage d'eau souterraine débutant l'an suivant. Le bilan hydrique du lac Beauchamp sera déterminé pour pouvoir noter si des changements pertinents sont notables avant et après le pompage d'eau souterraine. Pour caractériser le bilan hydrique du lac, des mesures du niveau du lac, du débit à l'exutoire, de l'évaporation et du niveau d'eau souterraine ont été entreprises. Des mesures de radon seront également faites pour quantifier l'apport en eau souterraine au lac. Dans les milieux humides adjacents au lac, des piézomètres ont également été installés afin de faire le suivi du niveau de la nappe phréatique. La composition végétale et l'étendue des milieux humides seront comparées entre les deux différentes années pour déterminer s'il y a une variation biologique suite au pompage. Ce projet de recherche permettra de mieux comprendre la dynamique hydrologique du lac Beauchamp et d'évaluer si le pompage d'eau souterraine vers le lac pourra être bénéfique ou non à la réhabilitation du lac.
Mots-clés: hydrogéologie
26 - Impacts de la température et du temps d'entreposage de l'insecticide microbien Bt sur son efficacité
Henri Lecrosnier
Étudiant(e) au baccalauréat (CEF, Université Laval)
Autres auteurs
- Éric Bauce (CEF, Université Laval)
- Martin Charest (CEF, Université Laval)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 26
Le Bacillus Thuringiensis (Bt) est une bactérie de type bacille Gram positif, qui est utilisée comme insecticide d'ingestion dans le monde forestier contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette Choristoneura Fumiferana Clem., et dans les cultures agricoles. Il est efficace principalement sur les lépidoptères, les coléoptères et les diptères. Par son efficacité spécifique, sa présence naturelle dans l'environnement et son utilisation sous certification biologique, cette bactérie est l'un des piliers de la lutte biologique.
Le Bt est principalement pulvérisé sur les feuillages lorsque les bactéries sont vivantes et actives. Lors de l'ingestion, la bactérie va atteindre le mésentéron où un cristal protéinique généré par la bactérie va être solubilisé par le pH basique, et va s'attaquer aux cellules du système digestif pour les détruire en créant ainsi un milieu idéal pour la sporulation de la bactérie. Cette chaîne d'événements va se répéter jusqu'à la mort de l'insecte via une septicémie.
Les principales faiblesses de cette bactérie sont une fragilité aux hautes températures, aux ultraviolets et dessèchement. Par ce fait, après quelques jours d'exposition aux milieux naturels, les bactéries non ingérées par un hôte potentiel meurent.
Actuellement, l'impact de la durée de conservation du Bt dans des conditions variables est méconnu. Nous avons évalué l'impact de la température et du temps d'entreposage sur son efficacité.
Le test a été réalisé sur la fausse arpenteuse du chou Trichoplusia ni lors de son 5ème stade larvaire. Les chenilles sont mises à jeûner pendant 24 h, puis elles s'alimentent dans une enceinte pendant 24 h sur disque de cellulose traité au Bt. Par la suite, elles sont remises sur diète artificielle, où la mortalité est comptabilisée sur une période après l'ingestion (jour initial, puis les trois, six et quinze jours suivants).
Mots-clés: aménagement, sylviculture, bt, tordeuses des bourgeons de l'épinette
27 - Cartographie des services écologiques et du potentiel de restauration des milieux naturels en paysage agricole québécois
Rosemarie Léger
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, Université de Sherbrooke)
Autres auteurs
- Richard Fournier (CEF, Université de Sherbrooke)
- Mathieu Varin (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO))
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 27
En réponse aux changements climatiques, les pratiques agricoles doivent évoluer afin de s'adapter aux conditions climatiques changeantes tout en diminuant leurs impacts sur l'environnement. L'agroforesterie, soit la combinaison volontaire d'arbres et de cultures, pourrait être une solution judicieuse à ce défi. Les différents types d'aménagements agroforestiers peuvent prendre la forme de bandes riveraines productives, de haies brise-vent, d'îlots forestiers, de plantations arborescentes ou de restaurations de milieux humides. Ceux-ci peuvent procurer plusieurs services écologiques tel que l'approvisionnement en matière première, l'amélioration la qualité de l'eau, l'amélioration de la qualité de l'air, la conservation de la biodiversité, la régulation du climat local, le maintien de la santé des sols et l'apport d'insectes pollinisateurs. L'objectif de ce projet est de fournir un outil cartographique d'aide à la décision permettant de faciliter et d'uniformiser la priorisation des sites d'implantations d'aménagements agroforestiers. Pour ce faire, deux échelles spatiales sont considérées, l'échelle locale et l'échelle du paysage. Le premier volet comprend une analyse multicritère permettant de recenser les sites disponibles à l'échelle locale pour la mise en place de pratiques agroforestières dans le bassin versant de la rivière Chaudière. Le deuxième volet porte sur la cartographie des services écologiques à l'échelle du paysage afin de permettre la priorisation et la sélection des sites propices à l'agroforesterie. Les résultats préliminaires correspondent à la cartographie à l'échelle locale des sites disponibles pour chaque type d'aménagements agroforestiers abordés (premier volet). La méthode de cartographie développée pourra être appliquée sur d'autres régions du Québec et pourra permettre de maximiser les bénéfices associés à l'agroforesterie tout en simplifiant la prise de décision lors de la planification. Ainsi, la transition environnementale du paysage agricole québécois vers des cultures plus résilientes aux aléas climatiques sera favorisée.
Mots-clés: aménagement, biodiversité, agroforesterie, agriculture, services écologiques
28 - Impact of different thinning regimes on wood properties and carbon sequestration in white spruce (Picea glauca) plantations
Dipak Mahatara
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAR)
Autres auteurs
- Robert Schneider (CEF, UQAR)
- Julie Barrette (CEF, Université Laval)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 28
Stand density management is one of the most important and widely used silvicultural tools that directly influence tree growth, wood quality and carbon content. The impact of the silvicultural treatments on wood quality and carbon content has been a subject of concern to forest managers for decades. Although the prime objective of forest managers is to produce a higher quantity of large-sized trees by using proper silvicultural treatments, everyone wants to maintain the wood quality and store more carbon at the same time. White spruce (Picea glauca (Moench) Voss) is a conifer tree species native to the northern temperate and boreal forests of North America. It is an ecologically and economically important tree species that has been managed intensively in these regions, and one of the main species that has been used for plantations. Studies showed that productivity and growth of white spruce are sensitive to tree spacing. While different wood properties of white spruce have been studied extensively, including genetic effects on wood quality traits, acoustic velocity, and modulus of elasticity, very few have made the attempt to study the growth characteristics and carbon content of white spruce after commercial thinning. In this project, the dynamics of growth-ring characteristics and carbon sequestration rates associated with four thinning methods (control, thinning from below, early crop tree (CT) release of 50 CT/ha and release of 100 CT/ha) in plantations will be assessed. The concept of CT release has never been used for softwood species in Eastern Canada. The effect of this innovative approach on the growth-ring characteristics and carbon sequestration rate will be better understood, so that forest managers will have a wider range of information to choose the appropriate silvicultural regime to achieve the desired management goals.
Mots-clés: sylviculture, thinning regimes, carbon sequestration
29 - Aquatic impact of an historical disturbance: the log drive
José Cristiano Freitas Vieira
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Miguel Montoro (CEF, UQAT)
- Yves Bergeron (CEF, UQAT)
- Guillaume Grosbois
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 29
Logging has existed for many centuries in boreal countries where forestry is a major economic force in Canada. Forestry companies were the first to settle in many regions, even preceding colonization (e.g. in the Abitibi-Témiscamingue (Quebec)). In the 19th century, the main objective of forestry in Abitibi was to extract wood from the forest and transport it to its processing site. Due to the lack of infrastructure, the logs extracted by the forest industry in many regions of the world were initially transported by waterways, a transportation technique called log driving. A significant number of the logs transported ended up on the bottom of the lakes used by the drive. Woody debris can provide valuable river habitat for the abundance, diversity, and biomass of aquatic invertebrates that support entire food webs. However, the massive accumulation and slow degradation process of woody material in slow-moving environments such as lakes may result in anoxic and mercury producing zones. The general objective of this project is to evaluate the impacts of log driving on aquatic ecosystems in regions that have been heavily affected by this disturbance i.e. the Temiscamingue and the Mauricie National Parc. We will (i) quantify the biomass of logs in the lakes affected by log drives, (ii) evaluate the impacts of logs on current aquatic communities (plankton, fish and benthic invertebrates) and (iii) assess the potential of log extractionto restore aquatic ecosystems.This restoration potential will be evaluated by analysing the resuspension of contaminants and their concentration in food webs.Studying the impact of log-driving on aquatic organisms is essential to understand how the aquatic organisms have been affected to past human disturbances and therefore make recommendations for a potential restoration of these aquatic ecosystems.
Mots-clés: log driving, aquatic communities, wood debris, ecological restoration
30 - Esker Forest in Peril of Global Warming: Understanding its Response to Low Water Availability
Oloruntobi Gideon Olugbadieye
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Fabio Gennaretti (CEF, UQAT)
- Yves Bergeron (CEF, UQAT)
- Etienne Boucher (CEF, UQAM)
- Eric Rosa
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 30
The earth's surface is becoming significantly warmer with the recent global temperature being the hottest in the past 2,000 years. The global mean temperature may rise from 0.3 to 4.8 oC by the late 21st century. The increase in temperature will lead to low water availability and plant water stress. Sites with coarse surficial deposits where water drains fast such as esker forest will be first to response. The eskers of the Abitibi region of Quebec (Canada) are valuable ecosystem for wood provision, recreational activities, and water recharge but are easily susceptible to water stress. Understanding the interplay between forests on eskers and water is crucial to develop effective conservation strategies for these ecosystems. This study aims to track the water sources and the root water uptake of the soil-plant-atmosphere continuum in the Saint-Mathieu Berry esker of the Abitibi region using stable isotopes of hydrogen and oxygen (δ2H and δ18O). Rainfall, snowpack, groundwater, plant xylem, and soil samples will be collected between April and November from the saturated and unsaturated zone of the esker. Plant and soil water will be extracted using cryogenic vacuum distillation for isotopic analysis. The Bayesian mixing model (MixSIAR) will be used to analyse the contributions of source water to the plant isotopic composition and to quantify the depth of root water uptake. We expect water uptake from the upper soil at the beginning of the growing season and a shift to deeper soil water utilization at the end of the growing season. Changes in isotopic composition of soil water will be monitored at different soil depth during the growing season to detect the influence of variable evaporation, transpiration, and precipitation water. This study will provide a better understanding of plant-soil water interactions and of forest responses on esker to hydroclimatic changes linked to global warming.
Mots-clés: écophysiologie, stable isotopes, esker forest, climate change
31 - Plant-microbe interactions in the phyllosphere: facing challenges of the anthropocene
Rosaëlle Perreault
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, Université de Sherbrooke)
Autres auteurs
- Isabelle Laforest-Lapointe (CEF, Université de Sherbrooke)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 31
Global change is a defining feature of the Anthropocene, the current human-dominated epoch, and poses imminent threats to ecosystem dynamics and services such as plant productivity, biodiversity, and environmental regulation. In this era, terrestrial ecosystems are experiencing perturbations linked to direct habitat modifications as well as indirect effects of global change on species distribution and extreme abiotic conditions. Microorganisms represent an important reservoir of biodiversity that can influence macro-organisms as they face habitat loss, rising atmospheric CO2 concentration, pollution, global warming, and increased frequency of drought. Plant-microbe interactions in the phyllosphere have been shown to support plant growth and increase host resistance to biotic and abiotic stresses. Here, we review how plant-microbe interactions in the phyllosphere can influence host survival and fitness in the context of global change. We highlight evidence that plant-microbe interactions (1) improve urban pollution remediation through the degradation of pollutants such as ultrafine particulate matter, black carbon, and atmospheric hydrocarbons, (2) have contrasting impacts on plant species range shifts through the loss of symbionts or pathogens, and (3) drive plant host adaptation to drought and warming. Finally, we discuss how key community ecology processes could drive plant-microbe interactions facing challenges of the Anthropocene. Therefore, our review suggest that plant microbiota could have an underappreciated impact on terrestrial ecosystem biodiversity and productivity as global change continues in the decades ahead. Harnessing the potential of plant microbiota to support ecosystem services requires studying the role of inter-kingdom interactions through the lens of community ecology. Future research should investigate the rising impacts of synthetic chemicals and biologicals since these products are agents of global change. In this review, we provide evidence that the field of microbial ecology is primed to offer ground-breaking resolutions of the roles of plant-microbe interactions in driving terrestrial ecosystems adaptation in the Anthropocene.
Mots-clés: biodiversité, biologie de la conservation, climate change ecology, community ecology, microbial ecology, microbiome
32 - Les bioaérosols urbains selon des gradients socio-économique et de végétation
Sarah Poirier
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, Université de Sherbrooke)
Autres auteurs
- Catherine Girard (CEF, UQAC)
- Isabelle Laforest-Lapointe (CEF, Université de Sherbrooke)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 32
Dans ce projet, nous nous appuierons sur différentes disciplines telles que la microbiologie, l'écologie microbienne et la génomique pour identifier les moteurs des bioaérosols urbains. Nous testerons l'hypothèse selon laquelle la diversité des infrastructures vertes est le facteur le plus important de la quantité et la diversité des bioaérosols (pollens et microorganismes) ainsi que l'hypothèse selon laquelle il y a une corrélation entre la biodiversité des bioaérosols et le gradient socio-économique dans les villes. Pour ce faire, nous utiliserons 25 pièges à dépôts répartis spatialement le long de gradients socio-économiques à Montréal, Québec et Sherbrooke. Il y aura aussi quelques pièges à Chicoutimi. Au cours de l'été 2022, différents types d'échantillons seront collectés. Nous collecterons (1) des échantillons de pollen chaque deux semaines à partir de chaque piège de mai à septembre pour identifier et quantifier les pollen du site, (2) des échantillons de feuilles à trois reprises durant l'été (mai, juillet, septembre) à partir des arbres et arbustes les plus communs près des pièges pour identifier et quantifier les microbes potentiellement émis par les infrastructures végétales locales, et (3) des échantillons de microbes et de pollen dans l'air près des pièges à trois reprises durant l'été (mai, juillet, septembre), en même temps que les échantillons de feuilles pour identifier et quantifier les bioaérosols urbains. Ces trois types d'échantillons seront utilisés pour identifier et quantifier les pollens et les microbes dans les centres urbains. Les données sur la diversité végétale locale seront obtenues à partir des bases de données municipales. La location des trappes, elle, sera déterminée par un gradient socio-économique, déterminé selon code postal avec les données du recensement de 2021 du Canada. Avec ce projet, nous construirons des modèles prédisant la diversité et la quantité de bioaérosols locaux dans les villes, fournissant ainsi des informations clés aux urbanistes.
In this project, we will draw on different disciplines such as microbiology, microbial ecology and genomics to identify the drivers of urban bioaerosols. We will test the hypothesis that the diversity of green infrastructure is the most important factor in the quantity and diversity of bioaerosols (pollens and microorganisms) as well as the hypothesis that there is a correlation between bioaerosol biodiversity and the socio-economic gradient in cities. To do so, we will use 25 deposition traps spatially distributed along socio-economic gradients in Montreal, Quebec City and Sherbrooke. There will also be a few traps in Chicoutimi. During the summer of 2022, different types of samples will be collected. We will collect (1) bi-weekly pollen samples from each trap from May to September to identify and quantify the pollen from the site, (2) leaf samples three times during the summer (May, July, September) from the most common trees and shrubs near the traps to identify and quantify microbes potentially emitted from local plant infrastructure, and (3) microbe and pollen samples in the air near the traps three times during the summer (May, July, September), along with the leaf samples to identify and quantify urban bioaerosols. These three types of samples will be used to identify and quantify pollens and microbes in urban centers. Data on local plant diversity will be obtained from municipal databases. The location of the traps will be determined by a socio-economic gradient, determined by postal code with data from the 2021 Census of Canada. With this project, we will build models that predict the diversity and quantity of local bioaerosols in cities, providing key information to urban planners.
Mots-clés: biodiversité, biologie moléculaire, bioaérosols, urbain, écologie microbienne
33 - Potentiel d'expansion de l'épinette blanche (Picea glauca) à sa limite altitudinale dans un contexte de changements climatiques
Laura Pothier Guerra
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAR)
Autres auteurs
- Guillaume de Lafontaine (CEF, UQAR)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 33
En réponse aux changements globaux, on s'attend à un déplacement altitudinal et latitudinal des populations naturelles. Toutefois, la migration des espèces sessiles et longévives, comme les arbres, pourrait être décalée par rapport à la vélocité des changements climatiques contemporains. On prévoit que la colonisation des milieux nouvellement favorables impliquera prioritairement les populations actuellement situées à la limite froide de la répartition des espèces. Or, la dynamique éco-évolutive de ces populations marginales pourrait dévier considérablement par rapport à celle des populations centrales. Elles pourraient notamment exhiber un potentiel de dispersion accru, ce qui augmenterait leur capacité à suivre localement la vitesse des changements climatiques. Dans cette étude, nous évaluons la variation intraspécifique du potentiel de dispersion des populations marginales d'épinettes blanches (Picea glauca) à différentes échelles spatiales. À l'échelle latitudinale, la capacité de dispersion est estimée dans des peuplements subalpins à la limite nordique de l'espèce en milieu continental (Monts Groulx, Côte-Nord), au cœur de son aire de répartition (Monts McGerrigle, Gaspésie) ainsi que dans des peuplements de basse altitude en forêt tempérée (Bic, Bas Saint-Laurent). À l'échelle altitudinale, elle est évaluée le long du gradient d'élévation dans les deux massifs montagneux. Nous observons une différence altitudinale au sein des Monts Groulx qui suggère que le potentiel de dispersion est soumis à un tri spatial permettant de moduler la dynamique d'expansion selon la vélocité climatique fine. Ce phénomène n'est pas observé aux Monts McGerrigle où il n'y a aucune différence de la capacité de dissémination le long du gradient altitudinal. Or, nous observons une différence latitudinale entre la Côte-Nord, la Gaspésie et le Bas-St-Laurent qui suggère qu'un tri spatial de la capacité de dispersion s'est fait lors de la migration postglaciaire en réponse à des changements climatiques plus importants induits par une alternance entre les périodes glaciaires et interglaciaires.
Mots-clés: écologie forestière, dynamique des populations, changement climatique, capacité de dissémination, potentiel de dispersion, épinette blanche, altitude, latitude, tri spatial
34 - La complexité de la végétation de la forêt urbaine montréalaise influence la communauté de la faune du sol
Jérémi St-Pierre
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAM, Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal (UQAM))
Autres auteurs
- Roberto Sepulveda-Mina (CEF, UQAM, Institut des sciences de l'environnement, Université du Québec à Montréal (UQAM))
- Tanya Handa (CEF, UQAM, Institut des sciences de l'environnement, Département des Sciences Biologiques, UQAM)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 34
La forêt urbaine est constituée d'une matrice de végétation complexe à très simple, allant de boisés matures à des pelouses presque dépourvues d'arbres. Elle est enracinée dans un sol vivant, entrecoupé par des surfaces minéralisées, qui abrite une diversité importante d'invertébrés. Nous avons testé l'hypothèse que la complexité de la végétation urbaine influence la structure des communautés de la faune du sol. En été 2020, nous avons échantillonné litières et sol de trois boisés à Montréal (Bois-de-Saraguay, la forêt du Mont-Royal et le Bois-de-Liesse) ainsi que des pelouses avec ou sans arbres isolés et des aménagements arbustifs dans trois sites aménagés sur le Campus Pierre-Dansereau de l'UQAM, le Campus Loyola de Concordia et le Parc du Mont-Royal pour tester si le type de végétation urbaine influence la communauté de la faune du sol. Des pièges fosses (macroarthropodes), l'extraction à la moutarde (vers de terre) et des carottes de sol suivi par une extraction Tullgren (mésofaune) ont été utilisés pour échantillonner trois sites pour chacun des quatre types de végétation (n=5 par type de végétation et site). Nous avons évalué la richesse et l'abondance des ordres ainsi que la composition de la communauté des collemboles. Sur les 19 ordres de la macrofaune répertoriés, huit étaient présents dans les quatre types de végétation. Les Coleoptera et Lumbricina étaient surtout abondants dans les boisés où on a mesuré plus de matière organique, tandis que les Araneae ont dominé les pelouses sans arbres où le sol était compacté. Les analyses préliminaires montrent que les communautés de collemboles sont distinctes dans les boisés et les pelouses sans arbres et intermédiaire dans les aménagements arbustifs. Notre étude souligne l'importance de conserver des boisés et d'employer davantage des aménagements arbustifs dans la matrice de végétation urbaine afin de favoriser la biodiversité du sol.
Mots-clés: biodiversité, aménagement, macrofaune, mésofaune, collembole, végétation urbaine, boisés urbains, sol urbain
35 - Urban tree pollen: a step forward in increasing capacity to predict identity and concentrations
Sarah Tardif
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAM)
Autres auteurs
- Rita Sousa-Silva (Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) - University of Freiburg)
- Isabelle Laforest-Lapointe (CEF, Université de Sherbrooke)
- Alain Paquette (CEF, UQAM)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 35
Exposure to allergenic pollen is a risk factor for respiratory allergies and a major public health concern, especially as climate change is lengthening the pollen season. Pollen concentrations vary spatially and temporally, and therefore pollen monitoring is an important tool for research and healthcare improvement. However, little is known about how levels of pollen types and species vary within a city and whether this variation affects the development or exacerbation of allergic reactions. Nowadays, pollen concentrations are often obtained from a single station which is used to represent exposure over a large geographic area. Furthermore, due to negligible morphological differences between related species, pollen grains are rarely identified at the species level. In this project, pollen is being collected with 25 gravimetric traps during the pollen season placed throughout the island of Montreal along a gradient of land cover, population density and household income. Portable samplers are also used to collect pollen in high-traffic areas. Simultaneously, we launched an online survey of pollen allergy sufferers to better understand the relationship between the severity of allergic symptoms and the concentration of each pollen species at the local level. The ultimate goal of our project is to develop spatial and temporal models to characterize pollen exposures based on the collected pollen data and environmental predictors, such as land use and land cover variables, vegetation composition, flowering time, and meteorological parameters relevant to pollen release and dispersal, which will represent a major step forward toward a better pollen forecast for people with pollen-related allergies or asthma to manage their symptoms.
L'exposition aux pollens allergènes est un facteur de risque d'allergies respiratoires et un problème majeur de santé publique, d'autant plus que les changements climatiques allongent la saison pollinique. Les concentrations de pollen varient dans l'espace et dans le temps, et la surveillance du pollen est donc un outil important pour la recherche et l'amélioration des soins de santé. Cependant, on sait peu de choses sur la façon dont les genres et espèces de pollens varient au sein d'une ville et si cette variation affecte le développement ou l'exacerbation des réactions allergiques. Les concentrations de pollen sont souvent obtenues à partir d'une seule station qui est utilisée pour représenter l'exposition sur une large zone géographique. De plus, en raison des différences morphologiques négligeables entre les espèces apparentées, les grains de pollen sont rarement identifiés au niveau de l'espèce. Dans ce projet, les pollens sont collectés à l'aide de 25 capteurs gravimétriques pendant la saison pollinique. Ces derniers sont placés sur l'île de Montréal le long d'un gradient de couverture végétale, de densité de population et de revenu des ménages. Des échantillonneurs portables sont également utilisés pour collecter le pollen dans les zones à fortement achalandées. Simultanément, nous avons lancé une enquête en ligne auprès des personnes souffrant d'allergies au pollen afin de mieux comprendre la relation entre la gravité des symptômes allergiques et la concentration de chaque espèce de pollen au niveau local. L'objectif ultime de notre projet est de développer des modèles spatio-temporels pour caractériser les expositions aux pollens sur la base des données polliniques collectées et des prédicteurs environnementaux, tels que les variables d'utilisation et de couverture des sols, la composition de la végétation, la période de floraison et les paramètres météorologiques pertinents pour la libération et la dispersion des pollens.
Mots-clés: écologie forestière, human health, urban forestry
36 - Déterminants et facteurs de résistance vis à vis l'adoption de l'ADN environnemental comme outil de collecte de données biologiques au Québec
Caroline Thivierge
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQO)
Autres auteurs
- Jérôme Dupras (CEF, UQO, Chaire de recherche du Canada en économie écologique)
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 36
Les êtres humains dépendent des écosystèmes naturels pour satisfaire leurs besoins socioéconomiques et culturels, mais aussi pour assurer leur survie par le biais des services écosystémiques offerts par ces milieux. Ainsi, il existe un lien inextricable entre les activités humaines et les écosystèmes. Les pressions exercées par ces activités sur les milieux naturels sont importantes, causant un déclin accéléré de la biodiversité. Dans ce contexte de changements climatiques et devant le constat d'une utilisation non durable des ressources naturelles, il devient primordial d'effectuer un suivi plus régulier et plus spécifique de la biodiversité locale. Les différentes techniques d'inventaires peuvent à la fois être coûteuses, exiger de nombreuses ressources humaines et peuvent dans certains cas être intrusives et causer un stress pour la faune et la flore. Or, depuis quelques années, un nouvel outil d'acquisition de données biologiques a fait son apparition : l'ADN environnemental. Une approche qui demeure actuellement marginale, mais qui offre d'intéressantes possibilités pour le suivi des espèces exotiques envahissantes ou pour repérer la présence d'espèces menacées et vulnérables qui échapperaient à d'autres techniques d'inventaires. Toutefois, l'acceptation et l'adoption d'une nouvelle technologie par les utilisateurs finaux est un processus complexe, qui repose à la fois sur des déterminants organisationnel, individuel et social, tout autant que sur des barrières fonctionnelles ou psychologiques. Ce projet de recherche vise à identifier les déterminants et facteurs de résistance vis-à-vis l'adoption de l'ADN environnemental comme outil de collecte de données biologiques au Québec. On cherchera d'abord à identifier les barrières actuelles à l'acquisition de données au Québec au moyen d'une analyse institutionnelle et d'une analyse des parties prenantes, puis des entrevues et un questionnaire seront réalisés auprès de ces acteurs en vue d'étudier leurs perceptions et de déterminer les facteurs ayant le plus d'influence sur leur intention d'adopter l'ADN environnemental comme outil d'inventaire.
Our human societies depend on natural ecosystems to meet their socio-economic and cultural needs, but also to ensure their survival through the ecosystem services provided by these environments. Thus, there is an inextricable link between human activities and ecosystems. The impacts of these activities on natural environments are significant, causing an accelerated decline of biodiversity. In this context of climate change and by the fact of our unsustainable use of natural resources, it becomes essential to do more regular and more specific monitoring of local biodiversity. The various inventory techniques can be costly, require many human resources and can in some cases be intrusive and cause stress for fauna and flora. Or, in recent years, a new tool for acquiring biological data has emerged: environmental DNA. An approach which currently remains marginal, but which offers interesting possibilities for monitoring invasive alien species or for identifying the presence of rare species that others inventories techniques could miss. However, the acceptance and adoption of a new technology by end users is a complex process, which is based both on organizational, individual and social determinants, as well as functional or psychological barriers. This research project aims to identify the determinants and factors of resistance to the adoption of environmental DNA as a tool for collecting biological data in Quebec. We will first seek to identify the current barriers to data acquisition in Quebec by means of an institutional analysis and an analysis of the stakeholders, then interviews and a questionnaire will be carried out with these actors in order to study their perceptions and determine the factors that most influence their intention to adopt environmental DNA as an inventory tool.
Mots-clés: biodiversité, adn environnemental, Inventaire biologique, perceptions, technology acceptance, behavioral reasoning theory
37 - Caractérisation de la dynamique de végétation des structures linéaires à l'aide du système de balayage laser aéroporté
Narimene Braham
Étudiant(e) à la maîtrise (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Osvaldo Valeria (CEF, UQAT)
- Louis Imbeau (CEF, UQAT)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 37
Les données de télédétection et la modélisation prédictive sont des outils utiles en fournissant des informations quantitatives précises et détaillées visant l’évaluation de l'état des structures linéaires. Cependant, le potentiel des données de télédétection pour améliorer notre connaissance des caractéristiques de végétation à fine échelle sur les chemins forestiers n'a pas été entièrement exploré. Cette étude a examiné l'utilisation de données LiDAR aéroporté à haute résolution spatiale (1 m), de données climatiques et de terrain dans le but de fournir une meilleure compréhension de la dynamique de végétation des chemins forestiers: i) en développant un modèle prédictif pour l'estimation de la couverture végétale dérivée du modèle de hauteur de canopée (métrique de réponse). ii) en examinant les facteurs ayant un effet sur la couverture végétale en utilisant les mesures LiDAR (topographie: pente, TWI, ombrage et orientation), de l'imagerie optique Sentinel-2 (NDVI), des bases de données climatiques (ensoleillement et vitesse du vent) et de l'inventaire de terrain (largeur de l’ouverture du chemin et le temps depuis la construction ou entretien majeur). Nous avons évalué et comparé les performances des approches de régression par la méthode des moindres carrés et par apprentissage automatique couramment utilisées en modélisation écologique. Les prédictions ont été testées par validation croisée et validées par rapport à un jeu de données indépendant. Nos résultats ont révélé que le modèle rf a montré les résultats les plus précis. Les prédictions à long terme suggèrent qu'il faudra au moins 20 ans pour que les routes larges et étroites présentent respectivement ~50% et ~80% de couverture végétale. Cette étude a permis d'améliorer notre compréhension de la dynamique de végétation des chemins forestiers à fine échelle. Les informations issues du modèle prédictif sont utiles pour la gestion à court et à long terme du réseau existant.
Mots-clés: chemins forestiers, lidar aéroporté, structures linéaires, chemins forestiers, réseau routier, aménagement forestier, forêts aléatoires, dynamique de végétation, forêt boréale
38 - Les peupliers hybrides au Québec : potentiel de croissance en Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec
Mônica Gabira
Étudiant(e) au doctorat (CEF, UQAT)
Autres auteurs
- Annie DesRochers (CEF, UQAT)
- Miguel Montoro Girona (CEF, UQAT, Institut de recherche sur les forêts (IRF), Groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi (GREMA))
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée - Affiche no. 38
Les peupliers hybrides (Populus spp.) ont le potentiel de croissance le plus rapide de toutes les espèces d’arbres cultivées au Canada. Par contre, leur utilisation est relativement récente dans les zones boréales du Canada, et certaines incertitudes subsistent sur leur performance de croissance dans les conditions de sites de l’Abitibi-Temiscamingue et du Nord-du-Québec et des scénarios d'aménagement sylvicole différents. À partir d’un réseau de plantations établies entre 2002 et 2007, nous voulons déterminer les effets des facteurs environnementales (qualité du site et rigueur climatique) et des pratiques culturales (espacement, fertilisation, préparation du sol, variabilité génétique des génotypes) sur les rendements des plantations de peupliers hybrides à croissance rapide. Plus précisément, nous cherchons à évaluer le potentiel de rendement en biomasse de plusieurs génotypes de peupliers hybrides plantés le long d'un large gradient latitudinal couvrant les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, et déterminer les effets du système cultural et la fertilisation sur la croissance et la productivité des plantations. Ultimement, nous cherchons à déterminer l'ensemble des conditions pédoclimatiques, des caractéristiques des cultivars (ex. forme de ramification, système racinaire, physiologie) et les pratiques culturales qui favorisent le meilleur rendement dans ces régions du Québec. Les résultats de ce projet permettront de choisir les pratiques de gestion appropriées pour maximiser et l'utilisation de ces plantations à croissance rapide dans l'outillage des forestiers pour produire au moins une partie de leur approvisionnement en bois, afin d’être moins dépendant des forêts naturelles et alléger les pénuries et les limitations de récolte sur les forêts naturelles.
Mots-clés: amélioration génétique, populus spp., sylviculture intensive, plantation
39 - Eastern white pine regeneration abundance, stocking and damages along a gradient of harvest intensity
Nelson Thiffault
Chercheur(e) régulier(ère) au CEF (Ressources naturelles Canada, Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB))
Autres auteurs
- Michael Hoepting (Ressources naturelles Canada, Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB))
- Maryse Marchand (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Marie Moulin (Ressources naturelles Canada, Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB))
- Holly Deighton (University of Western Ontario)
PDF non disponible
Séance d'affiches - Hall d'entrée
Ne participe pas au concours
The shelterwood system is considered appropriate to regenerate eastern white pine (Pinus strobus). However, modalities known to favour the species are not yet well documented in particular, those regarding the impacts of harvest intensity on regeneration success as they relate to damages to regeneration and soils. We thus compared four harvesting scenarios that varied with respect to the basal area harvested, both in absolute value (42.84 m2 ha-1, 38.78 m2 ha-1, 19.59 m2 ha-1 and 18.56 m2 ha-1) and in percentage (46%, 56%, 40% and 78%). We tested the hypothesis that regeneration quality and quantity increase with decreasing harvest intensity and depend on their pre-harvest value. In addition, we posited that soil disturbance increases with harvest intensity. We evaluated soil disturbance (percentage of unproductive soil and percentage of disturbed soil) as well as the state of regeneration (density, height, diameter, and damage) before and after the final harvest. Results showed that harvesting intensity did not significantly predict the number of damaged stems. The percentage of basal area harvested predicted post-harvest density for low white pine regeneration and stocking for tall white pine regeneration. In addition, the pre-harvest regeneration density and stocking influenced the post-harvest density and stocking for low white pine regeneration. Soil disturbance increased significantly with the increase in the percentage of basal area harvested with skid trails as the main cause. Unproductive soil also increased with the percentage of basal area harvested, with logging debris and trees on the ground being the two main causes. Based on these results, it appears that successful white pine regeneration requires opening the canopy while limiting soil disturbance. Opening the canopy should allow a good supply of light, favour semi-tolerant species and eliminate tolerant competing species. If white pine regeneration before harvest is scarce and poorly distributed, post-harvest regeneration will be similar.
Mots-clés: sylviculture, pinus strobus, natural regeneration, shelterwood system, soil disturbance, harvesting intensity, damage to regeneration
40 - Caméra de suivi de nidification pour cavicole avec téléobjectif et détection de mouvement
Philippe Cadieux
Postdoc (CEF, UQAM)
Autres auteurs
- Pierre Drapeau (CEF, UQAM, Chaire industrielle CRSNG UQAM-UQAT en aménagement forestier durable)
Séance d'affiches - Hall d'entrée
Ne participe pas au concours
Le suivi de nidification des oiseaux est utilisé pour mesurer le succès reproducteur d'une espèce. Cependant, un effort considérable est nécessaire pour suivre plusieurs nids, particulièrement pour les espèces à grand domaine vital, sans compter que chaque inspection directe du nid est un dérangement potentiel pour les oiseaux.Dans le cadre d'un projet avec Hydro-Québec, où l'inspection directe des cavités de nidification dans des poteaux de transmission électrique est impossible (observation directe des œufs ou des jeunes dans le nid), nous avons développé un système de caméra à détection de mouvement à faible coût permettant la surveillance de la cavité ou du nid à partir du lever jusqu'au coucher du soleil (besoin de lumière naturelle). Grâce à un téléobjectif, ce système peut être installé à une grande distance du nid et permet la prise de photos et vidéos dès qu'il y a de l'activité au site de nidification. Cette caméra est constituée d'un Raspberry Pi muni d'un module de caméra. Le tout est alimenté par batterie et panneau solaire et peut être laissé sur le terrain pendant de longues périodes. Nous présentons les résultats préliminaires d'une première campagne de récolte de données sur le terrain.
Mots-clés: faune, écologie forestière, caméra à détection de mouvement, poteaux de transmission électrique, suivi de nidification, cavicole, grand pic
41 - Contrôle biologique d'Erwinia amylovora : le microbiote de la phyllosphère de Malus domestica sous la loupe
Sophie Boutin
Stagiaire de recherche (CEF, Université de Sherbrooke)
Autres auteurs
- Ema Lussier (CEF, Université de Sherbrooke)
- Isabelle Laforest-Lapointe (CEF, Université de Sherbrooke)
Séance d'affiches - Hall d'entrée
Ne participe pas au concours
Erwinia amylovora est une bactérie phytopathogène qui cause la maladie du feu bactérien chez les plantes de la famille des Rosaceae. Cette maladie est particulièrement contagieuse et cause des dommages et des pertes économiques importantes dans les cultures de pommier domestique (Malus domestica). Avant de pénétrer les tissus végétaux et de se propager à l'intérieur de son hôte, E. amylovora vit au sein de la phyllosphère où elle est en contact avec d'autres microorganismes. Certains d'entre eux jouent d'ailleurs un rôle d'antagoniste contre E. amylovora et sont utilisés comme méthodes de contrôle biologique du feu bactérien, limitant ainsi l'utilisation d'antibiotiques dans les vergers. Bien qu'aucun pommier ne soit considéré résistant au feu bactérien, certains cultivars ont des niveaux de susceptibilité différents à la maladie. Dans ce projet, nous cherchons donc à déterminer si le microbiote de la phyllosphère de différents cultivars (Liberty, Cortland et Paulared) pourrait, en partie, expliquer cette différence de susceptibilité. De plus, nous étudions la structure temporelle des communautés microbiennes de la phyllosphère de ces mêmes cultivars. Pour ce faire, nous avons procédé à trois échantillonnages de la phyllosphère du pommier au cours de la dernière saison de croissance, et ce pour les trois cultivars ciblés. Les résultats que nous obtiendrons pourraient éventuellement nous permettre de créer un consortium de microorganismes antagonistes. Cela pourrait permettre d'améliorer les méthodes de lutte biologique qui dépendent présentement de l'action d'une seule souche antagoniste et ayant potentiellement un impact sur la diversité microbienne de la phyllosphère. De plus, les résultats permettront de mieux comprendre l'assemblage des communautés microbiennes de la phyllosphère de Malus domestica.
Biological control of Erwinia amylovora : the phyllosphere's microbiome of Malus domestica under the microscope
Erwinia amylovora is a phytopathogenic bacterium that causes fire blight disease in the Rosaceae plants. This disease is particularly contagious, and it causes important damage and economic loss in the apple-tree (Malus domestica) cultures. Before E. amylovora enters its host, it lives and interacts with other microbes on the surface of flowers and leaves. Indeed, the phyllosphere of M. domestica is colonized by epiphytic microbial communities that can interfere with E. amylovora. Some of these microbes are used as biological control agents of fire blight in order to reduce the use of antibiotics in the apple orchards. As no apple cultivar is known to be resistant to fire blight, some of them still have different levels of susceptibility to the disease. In this project, we wish to determine if the phyllosphere's microbiome of different cultivars (Liberty, Cortland, and Paulared) could partially explain the different susceptibility levels between these cultivars. Moreover, we aim to study the temporal structure of the microbial communities of these same apple cultivars. To do so, we proceeded to the sampling of the phyllosphere of these three cultivars at three time points during the last growing season. Most current biological control agents depend on the action of one microbial strain against E. amylovora. This can potentially have an impact on the microbial diversity of the apple-tree phyllosphere. The results that we will obtain could potentially enable us to improve current biological control of the causal agent of fire blight by creating an antagonist microbial consortium as well as providing a better understanding of microbial community assembly.
Mots-clés: agroforesterie, microbiologie environnementale