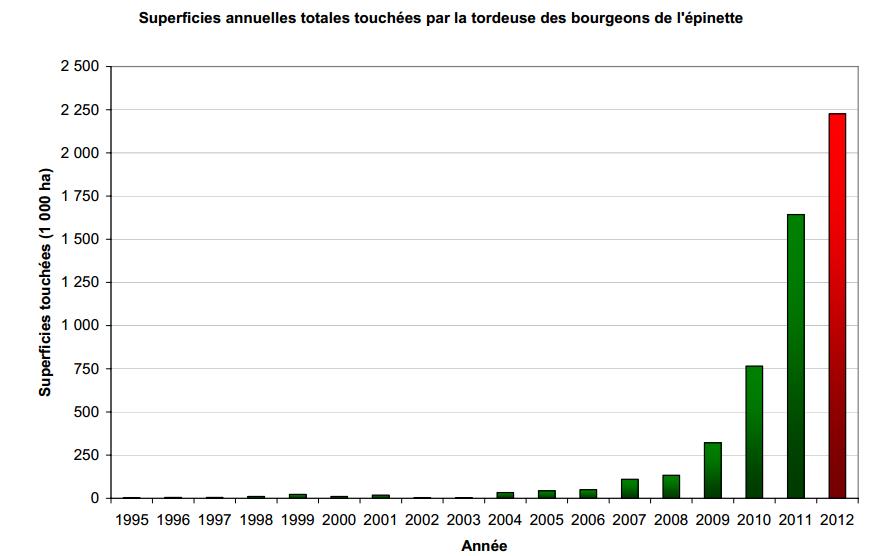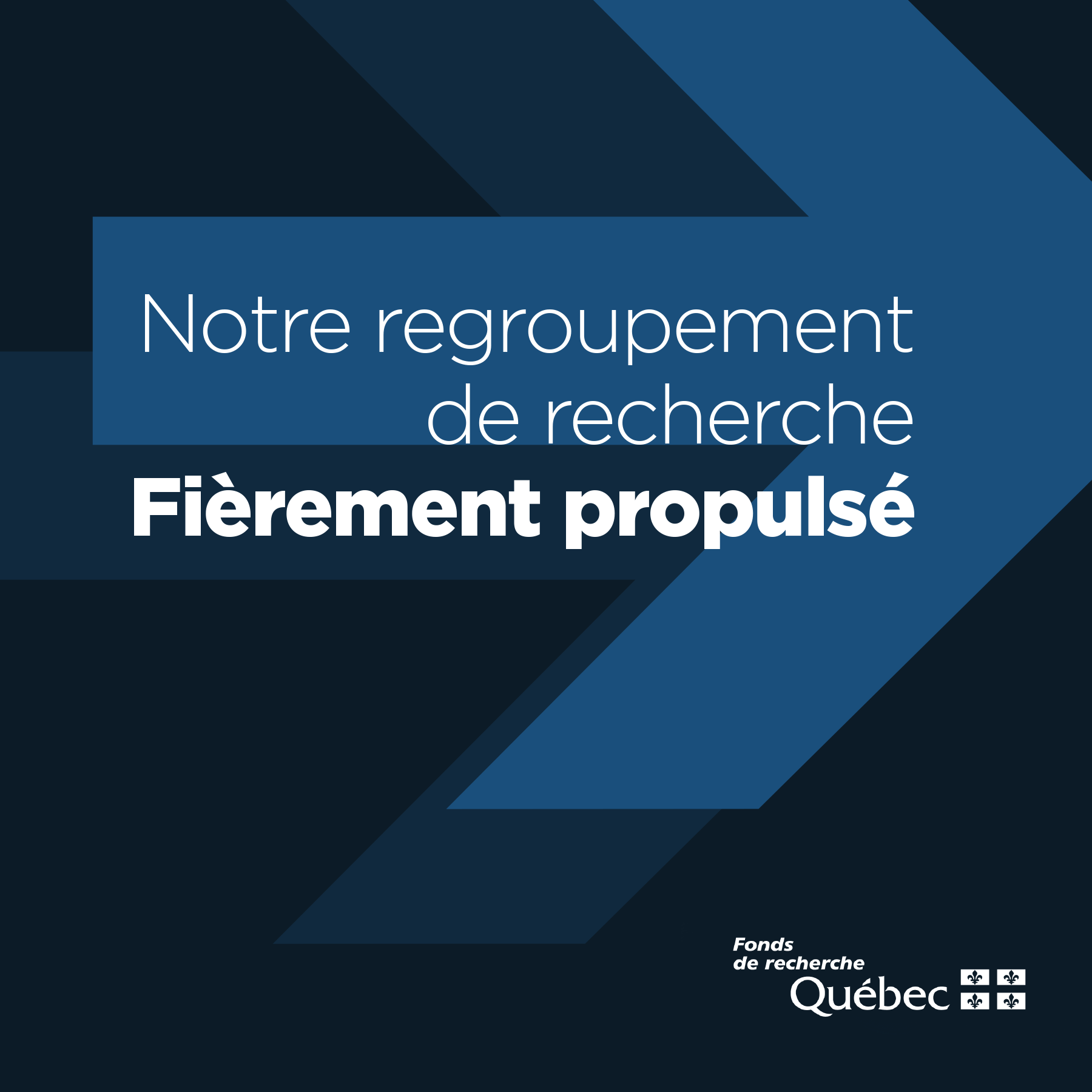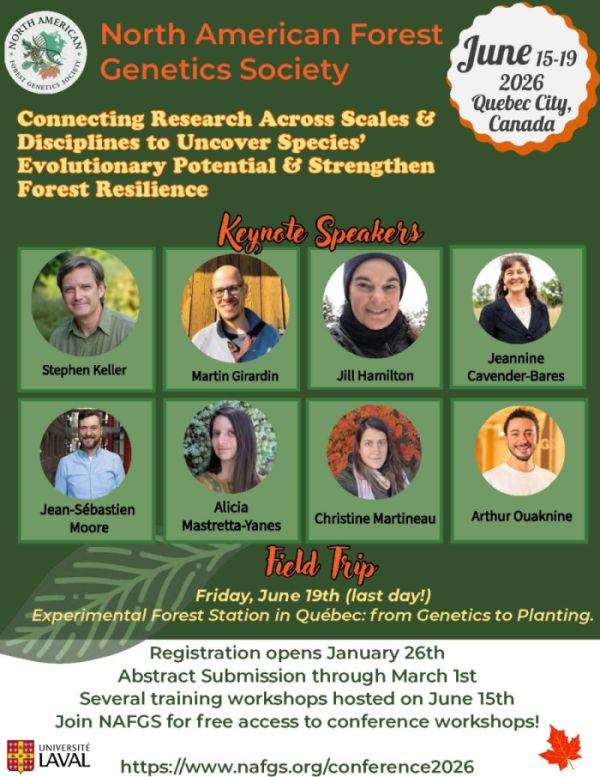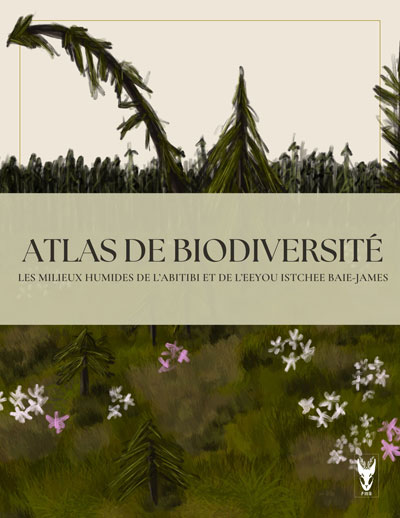Le blogue du CEF
Textes d’avis scientifique, d'opinion ou de vulgarisation par les membres du CEF. Notez que les avis, opinions et idées qui apparaissent sont ceux et celles des auteurs et autrices de ce blogue. Ces propos ne reflètent pas nécessairement la position de tous les membres du CEF.
24 mai 2019
Découvrir la biodiversité du sol forestier au CPE!
Texte et photos de Tanya Handa
La chercheure et membre du CEF Tanya Handa et son équipe de stagiaires ainsi que certains anciens étudiant.e.s gradué.e.s ont conçu et animé une série d'ateliers sur la faune du sol forestier ce printemps. Suite à l'atelier que le labo Handa a offert à l'école primaire Montarville le 8 mai 2019 à trois classes de 6e année en collaboration avec Virginie Bachand-Lavallée de la Fondation du Mont-Saint-Bruno, l'équipe a relevé le défi d'adapter et d'offrir les ateliers découvertes pour les enfants de 4-5 ans du CPE de l'UQAM le 23 mai 2019. Ce fut un franc succès où les enfants ont pu observer et manipuler les arthropodes, se familiariser avec les différents phénotypes ainsi que les différentes interactions qui existent dans le sol et lors du processus de décomposition de la matière morte! Les enfants ont même inventé et dessiné leurs propres invertébrés avec une imagination sans fin. Bravo à Justine Floret, Éléonore Dansereau Macias-Valadez, Essivi Gagnon Koudji, Laurent Rousseau et Laura Raymond-Léonard qui ont prêté main forte pour assurer ces activités de vulgarisation scientifique.






8 janvier 2019
Etude de la biodiversité des Lasiosphaeriaceae du sol et des excréments d’herbivores du Québec
Texte et photo de Philippe Silar ![]() , Professeur de l’Université Denis Diderot, Paris – France, membre du Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain, en CRCT à L’Université Laval, Québec
, Professeur de l’Université Denis Diderot, Paris – France, membre du Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain, en CRCT à L’Université Laval, Québec
Au cours de mon congé sabbatique de quatre mois, je me propose de mieux cerner la diversité des Lasiosphaeriaceae du Québec en isolant à partir d’échantillons de sols, de débris végétaux et d’excréments d’herbivores de nouvelles souches. Actuellement la diversité et les rôles écologiques des Lasiosphaeriaceae sont mal connus. Ces champignons inoffensifs sont pourtant très fréquents dans les sols. Par exemple, j’ai isolé de nombreuses souches, incluant probablement des espèces nouvelles pour la science, à partir de quasiment tous les échantillons que j’ai examinés!
Dans les écosystèmes terrestres, en particulier dans les écosystèmes forestiers, une large fraction de la biomasse végétale ligno-cellulosique est recyclée en CO2 par les champignons filamenteux. Même si elle est préalablement ingérée par des herbivores, la plus grande partie du carbone se retrouve dans leurs excréments. Ceux-ci vont être colonisés par un cortège spécifique de champignons qui va terminer de digérer la lignocellulose. Dans tous les cas, l’action de digestion de la biomasse végétale conduit à la production d’acides humiques qui participent à la rétention dans les sols des sels minéraux et de l’eau, assurant ainsi leur santé. La pousse des plantes n’est donc pas seulement favorisée par leurs symbiotes mycorhiziens mais aussi par les champignons de la litière et des excréments. Si les macromycètes saprotrophes sont bien connus et sujets de nombreuses études sur leur capacité à dégrader la biomasse, ce n’est pas le cas du cortège des micromycètes qui colonisent les sols et les excréments. C’est le cas par exemple des espèces appartenant à la famille des Lasiosphaeriaceae. Pourtant, certaines espèces se révèlent être de bons modèles pour analyser les modalités de dégradation de la biomasse, comme Podospora anserina, un champignon coprophile, facile d’utilisation au laboratoire et dont le génome contient de nombreux gènes codant des enzymes de dégradation de la cellulose et de la lignine.
Quelques espèces de Lasiosphaeriaceae:
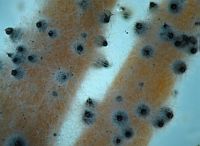
Podospora anserina sur cure-dent

Podospora fimiseda sur copeaux

Zopfiella tetraspora sur foin.jpg
Les Lasiosphaeriaceae ont longtemps été négligés en comparaison de leurs cousins proches appartenant aux familles des Sordariaceae (famille contenant les champignons modèles Neurospora et Sordaria) et des Chaetomiaceae (contenant de nombreux champignons d’intérêt industriels comme les Chaetomium, Myceliophthora ou Thielavia). Il est à noter que les Lasisophaeriaceae sont plus divers que les Sordariaceae et les Chaetomiaceae et qu’ils se répartissent en 4 clades dont le statut attend une révision taxonomique. Ces champignons commencent à voir un regain d’intérêt. En effet, des projets de séquences de leurs génomes ont été acceptés par le Joint Genome Institute (JGI) ![]() , dont les activités sont financées par le « US Department of Energy ». Le projet ambitieux
, dont les activités sont financées par le « US Department of Energy ». Le projet ambitieux ![]() , récemment accepté en juillet 2018 et auquel je participe directement en tant qu’investigateur principal auprès de P. Gladieux, responsable du projet, propose de séquencer les génomes des centaines de souches d’espèces différentes. Comme dans le cas de P. anserina, les génomes seront explorés pour la présence d’enzymes d’intérêt pour les industries forestières comme ceux impliqués dans la dégradation de la lignocellulose ou de molécules potentiellement toxiques (xénobiotiques polluants).
, récemment accepté en juillet 2018 et auquel je participe directement en tant qu’investigateur principal auprès de P. Gladieux, responsable du projet, propose de séquencer les génomes des centaines de souches d’espèces différentes. Comme dans le cas de P. anserina, les génomes seront explorés pour la présence d’enzymes d’intérêt pour les industries forestières comme ceux impliqués dans la dégradation de la lignocellulose ou de molécules potentiellement toxiques (xénobiotiques polluants).

Chambres humides
Des échantillons des sols et de débris végétaux provenant de diverses régions de Québec ont été incubés dans des chambres humides ou mis en culture sur boites de Petri. Des excréments d’herbivores ont été généreusement fourni par Steeve Côté, Julien Hénault Richard, Véronique Cloutier & André Desrochers. Ils ont aussi été incubés en chambres humides.
La découverte d’un caractère partagé par la grande majorité des espèces d’un des clades (le clade IV est caractérisé par la présence de structures micro-sclérotiques orangées facilement détectées à la loupe binoculaire) facilite leur isolement. Ce critère est utilisé pour les isoler à partir de sols et d’excréments. Pour les autres clades, l’identification se fait principalement à partir des fructifications (voir les photos d’espèces connues) qui sont détectées sur les excréments et les fragments végétaux en cours de dégradation. Plusieurs dizaines de souches candidates ont déjà été isolées après repiquage sur milieux appropriés. La campagne a donc été très fructueuse et mon congé sabbatique a atteint son but!

Quelques souches isolées à partir de sols de l’Université Laval
L’identification finale des souches ainsi isolées se fera à mon retour en France sur des critères morphologiques mais aussi via l’établissement de leur séquence code-barre (la région ITS située entre les gènes des ARN 18S et 28S).
Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des collègues du CEF qui ont rendu mon séjour agréable et productif, en particulier Louis Bernier pour son invitation à séjourner dans son laboratoire durant quatre mois.
5 octobre 2018
Goettingen award for Forest Ecosystem Research to Valentina Vitali
Texte et photos de Valentina Vitali

Dr. Valentina Vitali receives Goettingen award for Forest Ecosystem Research (Goettingen, Germany) at the FowiTa conference the 24th of September, in Göttingen. The environmental and forestry scientist Dr. Valentina Vitali receives the Goettingen Prize for Forest Ecosystem Research for her work on the potential of Douglas fir and silver fir as possible substitute tree species for spruce in the context of climate change in the Black Forest of Germany. The award for special achievements by junior researchers in forest ecosystem science includes prize money of 2.500€. Dr. Vitali completed her dissertation at the Chair of Silviculture of the University of Freiburg, where she was supervised by Prof. Dr. Jürgen Bauhus, in only three years. The results of her work were published in international scientific journals, such as Global Change Biology.

As part of her work, Dr. Vitali has investigated how three factors influence the growth of annual rings: drought stress, the composition of tree species and future climate changes, including changes in seasonal climates. For the Black Forest, she could show that not only Douglas fir, but also Silver fir is more resistant to drought stress and recovers faster than Norway spruce. Furthermore, Silver fir benefits from a mixture with the other two tree species in dry years, while mixed stands of Douglas fir and Norway spruce tend to have a negative impact on overall recovery. While Silver fir and Douglas fir benefit from milder winters and spring periods, Norway spruce does not. The scientist, who has recently taken up a postdoctoral position at the Université du Québec à Montréal in Canada, thus showed that, apart from the non-native Doughlas fir, which was originally imported from North America, Norway spruce exists as a native alternative for the coniferous woodland of the Black Forest in Germany, in order to counteract the loss of spruce during future climate changes."
Congratulations Valentina!
Valentina is currently doing a postdoc at UQAM under the direction of Christian Messier and Alain Paquette
8 mai 2018
Christian Messier invité d'honneur au 125e anniversaire de la Société Royale Forestière de Belgique en présence du Roi des Belges
Texte et photos Christian Messier

Le vendredi 4 mai dernier, j'ai été invité à titre de conférencier d'honneur dans le cadre du 125e anniversaire de la Société Royale Forestière de Belgique ![]() au Château de Lavaux-Sainte-Anne. Sa Majesté le Roi de Belgique a assisté aux festivités liées au 125e anniversaire. À cette occasion, le Roi et moi avons échangé, notamment lors de la visite guidée du domaine d'Ardenne de la Donation Royale
au Château de Lavaux-Sainte-Anne. Sa Majesté le Roi de Belgique a assisté aux festivités liées au 125e anniversaire. À cette occasion, le Roi et moi avons échangé, notamment lors de la visite guidée du domaine d'Ardenne de la Donation Royale ![]() et lors de la table ronde consacrée aux enjeux de la filière bois en Belgique. Sa Majesté le Roi a aussi été présent lors de ma conférence qui traitait sur la résilience des forêts face aux changements globaux: « La nouvelle foresterie face aux incertitudes et enjeux actuels et à venir. Exemples concrets venus du Canada ». C'était tout un honneur pour moi et je tiens à remercier les gens de la Société qui m'ont si bien reçus.
et lors de la table ronde consacrée aux enjeux de la filière bois en Belgique. Sa Majesté le Roi a aussi été présent lors de ma conférence qui traitait sur la résilience des forêts face aux changements globaux: « La nouvelle foresterie face aux incertitudes et enjeux actuels et à venir. Exemples concrets venus du Canada ». C'était tout un honneur pour moi et je tiens à remercier les gens de la Société qui m'ont si bien reçus.


31 mars 2017
Budget provincial 2017: Qu'en est-il pour les regroupements stratégiques?
Texte par Luc Lauzon
Dans cet extrait du budget Québec 2017, on nomme précisément les Regroupements stratégiques. Tout porte à croire que le FRQ ajustera à la baisse la réduction de 20% des budgets des centre imposées il y a trois ans. Serait-ce une bonne nouvelle?
180 M$ additionnels pour encourager la recherche et l’ innovation dans les établissements d’enseignement supérieur
Les Fonds de recherche du Québec jouent un rôle important dans l’écosystème québécois de la recherche, notamment en offrant un soutien financier aux étudiants et aux chercheurs. De par leur mission, ils favorisent également la synergie et les partenariats entre les différents domaines de recherche.
Ces fonds appuient un réseau universitaire dynamique grâce à des établissements offrant un enseignement de qualité et réalisant des projets de recherche qui répondent aux normes internationales les plus élevées. Par son appui aux universités, le gouvernement accorde une grande importance à la recherche fondamentale et appliquée, particulièrement dans les secteurs de pointe.
Afin de réaffirmer le caractère stratégique des Fonds de recherche du Québec pour le milieu de la recherche, le Plan économique du Québec prévoit une augmentation de leur financement de 180 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.
- Cette nouvelle enveloppe représente une hausse du financement des Fonds de recherche du Québec de plus de 20% par rapport à leur financement actuel.
- Ce sont donc plus de 1 milliard de dollars qui seront disponibles pour le financement des Fonds de recherche du Québec pour les cinq prochaines années.
La bonification permettra de soutenir la recherche chez les jeunes en offrant notamment davantage de bourses aux étudiants et aux chercheurs de la relève. Elle bénéficiera également aux universités en offrant plus de financement aux chercheurs et aux regroupements de chercheurs. C’est notamment par le développement de nouvelles connaissances et la proposition de solutions innovantes que le Québec répondra aux grands défis sociétaux.
De plus, cette bonification du financement permettra aux Fonds de recherche de soutenir plus de projets présentant un potentiel de commercialisation, notamment en ciblant ceux dont les applications industrielles sont les plus probables. Les projets impliquant des partenaires privés seront aussi favorisés.
Accroître la compétitivité des regroupements de chercheurs
Les regroupements de chercheurs permettent de rassembler des masses critiques de chercheurs ayant des expertises complémentaires autour de thèmes prioritaires. Ils constituent également des milieux de formation exceptionnels pour les nouveaux talents en recherche, y compris les jeunes chercheurs.
Afin d’accroître la compétitivité des regroupements et de favoriser l’obtention d’une plus grande part du financement aux concours du gouvernement fédéral, le Plan économique du Québec prévoit leur consacrer des sommes additionnelles par l’ intermédiaire des Fonds de recherche du Québec.
Ces sommes permettront notamment de bonifier l’écosystème d’innovation en stimulant:
- l’ établissement de collaborations et de partenariats internationaux;
- la découverte et la compétitivité scientifique du Québec sur les scènes nationale et internationale;
- les collaborations intermilieux, notamment entre les chercheurs universitaires et collégiaux;
- le transfert de connaissances et l’établissement de partenariats avec les milieux public et privé, constituant des utilisateurs potentiels des résultats de recherche.
13 septembre 2016
Les statistiques au moment de la rédaction
Texte par Jérémie Alluard
(Ce texte est aussi présent dans la section CEF-Référence / Statistique ![]() )
)

Jérémie Alluard, professionnel statisticien
Pour grand nombre d’entre vous, rédiger ou publier un rapport de recherche nécessite d’interpréter et rapporter des statistiques. Seulement, malgré quelques cours, plusieurs considèrent toujours les statistiques comme un mal nécessaire. De plus, les cours souvent théoriques abordent rarement les règles à suivre relativement aux aspects statistiques d’une publication scientifique. Pourtant, les chercheurs doivent se montrer prudents, et même pointilleux, tant dans la formulation de leurs hypothèses que dans l’analyse ou l’interprétation de leurs résultats. Ce texte vise à présenter certaines « normes » de publication qui devraient être considérées lorsqu’une analyse statistique est intégrée à votre rapport de recherche. Que ce soit dans la méthodologie, la communication des résultats ou la section discussion, il existe une certaine éthique scientifique à respecter afin d’assurer la qualité de vos recherches.
Les objectifs
Il est important de spécifier les objectifs et, lorsque pertinent, les hypothèses scientifiques. Cette section vient souvent à la fin de l’introduction. Des objectifs clairs permettent de bien orienter l’analyse statistique et de tester des hypothèses scientifiques.
La méthodologie
Cette section constitue le noyau central du rapport de recherche. C’est dans celle-ci que l’on explique en détail les principaux éléments de sa recherche, les étapes de sa réalisation, ainsi que l’approche utilisée pour valider ses hypothèses. La reproductibilité des expériences ou de l’échantillonnage est une des clés de voûte de la science. Elle assure l’objectivité de vos conclusions. La recherche scientifique est fondée sur la possibilité de vérifier, de valider ce qu’ont entrepris les chercheurs, de mettre à l’épreuve leurs hypothèses, leurs protocoles et leurs analyses. Les chercheurs doivent donc décrire avec transparence et rigueur leur approche méthodologique, d’autant plus si celle-ci diffère des approches communément reconnues.
Dispositif expérimental ou plan d’échantillonnage
Il est tout d’abord essentiel de fournir aux lecteurs une description complète et concise de son dispositif expérimental ou de son plan échantillonnage dans le cas d’une étude observationnelle. Vous devez identifier les limites de votre étude, sa portée, afin d’éviter que vos résultats soient généralisés à d’autres sujets. Le chercheur doit se mettre à la place des lecteurs de sorte qu'un autre chercheur, face aux mêmes conditions, prenne les mêmes décisions.
Onofri et al (2009) suggèrent de considérer les questions suivantes:
- Les unités expérimentales sont-elles clairement définies?
- Les situations de pseudoréplication (mesures prises dans une même unité expérimentale ou de sondage traitées comme si elles étaient indépendantes) sont-elles bien identifiées?
- Est-ce que l'expérience est répétée de façon indépendante dans l'espace ou le temps?
- La randomisation a-t-elle été appliquée correctement?
- Les témoins ont-ils été pris en compte de manière appropriée?
L’analyse statistique
Le dispositif expérimental et l’analyse statistique sont étroitement liés. C’est le dispositif expérimental qui oriente l’analyse. Les décisions prises lors de la phase de conception du dispositif expérimental doivent être prises en compte dans le choix des méthodes statistiques. Dans cette section, vous devrez décrire suffisamment les méthodes statistiques utilisées pour permettre à un lecteur averti ayant accès aux données d’origine de vérifier vos résultats. La reproductibilité des résultats est une garantie d’honnêteté scientifique. Si plusieurs méthodes ont été utilisées, il faut les divulguer pour que les lecteurs puissent établir leurs propres jugements. Si vous avez des références (manuel, article…) ayant un dispositif expérimental ou une analyse statistique similaire à la vôtre, citez-les. Cela donnera plus de crédibilité à votre analyse.
Encore ici, Onfri et al. (2009) amènent les points suivants:
- Est-ce que l’analyse reflète bien la structure des traitements et les relations entre les facteurs?
- Les facteurs de blocage sont-ils pris en compte par le modèle?
- Est-ce que les mesures répétées ont été prises sur des unités indépendantes? Si non, est-ce que le modèle prend en compte l’autocorrélation des mesures?
Il est également important de préciser le logiciel ainsi que la version qui a été utilisée pour réaliser cette analyse.
Présentation des résultats
Le but de cette section est d’orienter l’attention du lecteur vers les principaux résultats obtenus sans les interpréter. Ceux-ci seront discutés dans la section suivante de votre rapport (section « Discussion »). La présentation des résultats doit être brève, explicite et non redondante. Précision statistique ne rime pas nécessairement avec complexité. Soyez donc complet et concis. Avant de présenter les résultats des tests statistiques, il est impératif de rapporter des statistiques descriptives. En d’autres termes, il est important de donner de l’information sur les paramètres d’intérêt à l’aide de moyennes, de pourcentages, de coefficients de corrélation. Il est aussi important de préciser l’effectif. Pour des raisons de clarté et d’économie, il est recommandé d’intégrer à l’analyse des tableaux ou des graphiques. Attention toutefois à ne pas être redondant. On ne devrait pas répéter dans le texte, les valeurs qui sont déjà présentées dans les figures et tableaux. Chaque estimation (dans le texte, les tableaux et graphiques) doit être suivie d'une mesure de variabilité. Utilisez l’écart-type si vous souhaitez exprimer la variabilité d'une série d’observations par rapport à la moyenne. Utilisez l’erreur-type si vous souhaitez exprimer la précision d’une estimation.
Viennent ensuite les résultats des analyses principales. Pour chacune d’elle:
- Bien identifier l’hypothèse à laquelle réfère chaque analyse.
- Rapporter l’ensemble des résultats importants y compris ceux qui vont à l’encontre des hypothèses.
- Rapporter les valeurs p exactes en plus des statistiques (t, F, z, khi²). Laissez les lecteurs porter leur propre jugement sur le degré de signification de vos résultats.
- Ne pas présenter uniquement des valeurs p! En reportant uniquement celle-ci, vous perdez de l’information quantitative sur le niveau moyen de performance d’un traitement et sur la variabilité des résultats individuellement. Les lecteurs peuvent s’intéresser à l’impact d’un traitement en particulier plutôt que la comparaison avec un autre traitement.
- Quantifier et présenter les résultats avec des indicateurs statistiques appropriés comme les intervalles de confiance qui permettent de mesurer « l’incertitude de vos résultats ».
Discussion
On évite ici de répéter les résultats. C’est dans cette partie que l’on doit faire état de la fidélité et de la validité des instruments de mesure et du degré de validité des résultats qui en découlent. Les lecteurs doivent être informés, avec suffisamment de détails, des faiblesses et des points forts de l'étude pour former une impression claire et précise de la fiabilité des données, ainsi que les menaces qui pèsent sur la validité des résultats et interprétations. Si vous avez rencontré des difficultés durant la collecte ou l’analyse, il faut en rendre compte et expliquer comment on aurait pu modifier le plan de recherche ou les instruments pour obtenir des résultats plus fiables et éviter que l’on ne répète vos éventuelles erreurs. Dans cette section, on procède également à la comparaison des résultats de sa recherche avec ceux de la littérature. Il faut insister sur les convergences et les différences entre ces études et la vôtre. De manière générale, il faut faire ressortir la signification des résultats au sein de la problématique, c’est-à-dire montrer en quoi ces résultats modifient la manière de poser les problèmes ou de conceptualiser la question. Il faut analyser les implications théoriques ou pratiques de la recherche. N’oubliez surtout pas que le degré de signification statistique n’est pas un gage de l’importance écologique d’un phénomène.
Sommes toutes, les statistiques doivent être gérées et présentées de façon méthodique et professionnelle. N'hésitez pas à me contacter pour toute aide, je suis à votre service! - Jérémie Alluard
Références
A. Onofri et al. (2009). Currential statistical issues in Weed Research, (50), p.6
B. Murray K. Clayton (2007). Advances in Physiol Edu, (31): p.302-304
C. Douglas Curran-Everett and Dale J. Benos (2007). Advances in Physiol Edu, (31): p.295-298
D. Bailar JC et Mosteller F (1988). Annals of internal medicine (108), p.266-273
4 septembre 2015
CALBIOEN: une application pour estimer la biomasse d’une plantation
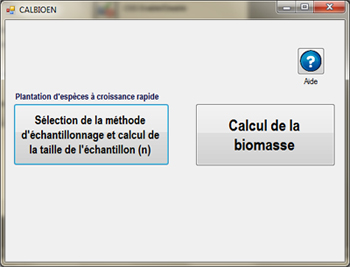
Une application a récemment été développée afin d’estimer la biomasse d’une plantation d’espèces à croissance rapide à des fins énergétiques. L’application CALBIOEN a été développée par Carlo Lupi, Mildred Deldago, Laurent Lemay et Guy R. Larocque, chercheur au Service canadien des forêts. Elle est facile d’utilisation et elle est disponible gratuitement. L’application peut également être utilisée pour calculer la biomasse d’un terrain en friche.
Avec l’application CALBIOEN, vous pouvez:
- calculer la taille de l’échantillon (n) requise pour une estimation précise de la biomasse dans une plantation selon le degré de précision désiré;
- calculer la biomasse dans une plantation;
- calculer la biomasse d’espèces ligneuses de petit diamètre dans un terrain en friche;
- calculer la surface d’un terrain, via GPS ou d’autres coordonnées.
Vous pouvez télécharger cette application à partir de cette page ![]() et l’installer sur votre ordinateur. Les fichiers nécessaires à son fonctionnement n’utilisent que 7 Mo d’espace. Le fichier « Lisez-moi.pdf » vous guidera sur la façon d’installer l’application sur votre ordinateur. Par la suite, le guide de l’usager vous présentera les explications sur le fonctionnement de l’application.
et l’installer sur votre ordinateur. Les fichiers nécessaires à son fonctionnement n’utilisent que 7 Mo d’espace. Le fichier « Lisez-moi.pdf » vous guidera sur la façon d’installer l’application sur votre ordinateur. Par la suite, le guide de l’usager vous présentera les explications sur le fonctionnement de l’application.
Pour toutes questions concernant cette application ou son utilisation, contactez:
Guy R. Larocque, ing.f., Ph.D.
Chercheur scientifique en modélisation et productivité forestière
Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts
Tél: 418-648-5791
Courriel: Guy.Larocque@nrcan.gc.ca
21 juillet 2015
Une forêt plus grande que nature
Texte par Louis-Philippe Bourdeau et images par Carbone boréal
Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir interviewé des membres du CEF. Voici le quatrième de cinq articles mettant en vedette un projet de Jean-François Boucher.

Depuis 2008, plus de 850 000 arbres ont été plantés sur des terrains dénudés boréaux du Québec par l’équipe de Carbone boréal. Ci-dessus, un planteur est à l’œuvre dans l’un des secteurs expérimentaux.
La forêt boréale canadienne émet plus de gaz carbonique qu’elle ne peut en absorber. Des chercheurs québécois veulent agrandir sa superficie pour l’aider à mieux respirer… un arbre à la fois.
Chaque année une équipe de chercheurs et d’étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) supervise l’un des plus grands laboratoires extérieurs au monde: la forêt boréale canadienne. En six ans, ils y ont planté environ 850 000 arbres dans quatre lieux d’expérimentations protégés de l’exploitation forestière. Leur objectif? Augmenter la superficie de la forêt pour l’aider à absorber davantage de gaz carbonique (CO2) et ainsi lutter contre les changements climatiques.
«Notre travail c’est de créer des forêts là où il n’y en a pas», résume Jean-François Boucher, membre régulier du Centre d’étude de la forêt et spécialiste de la gestion du carbone forestier à l’UQAC. Grâce au mécanisme de photosynthèse, le gaz à effet de serre (GES) est piégé dans la biomasse de ces nouvelles plantations ce qui l’empêche de retourner dans l’atmosphère.
Dans la dernière décennie, les ravages de l’épidémie de denctroctone du pin dans l’ouest du pays combinés à ceux de la tordeuse des bourgeons de l’épinette au Québec et aux feux de forêts plus fréquents ont ébranlé l’un des principaux poumons de la planète. La quantité de CO2 émise annuellement par la forêt est désormais plus importante que celle absorbée. Pour M. Boucher, ce débalancement est une raison de plus d’agir. «La forêt doit faire mieux que ce qu'elle pourrait faire d'elle-même naturellement», croit-il.
Pour y arriver, le chercheur de l’UQAC s’est intéressé à une étendue de 1,6 million d’hectares de terrains boréaux naturellement dénudés, environ trois fois la taille de l’Île-du-Prince-Édouard. Dispersées sur le territoire québécois jusqu’à la limite nordique du 51e parallèle, ces zones sont jugées improductives à l’exploitation forestière.
Couverts de lichen et de quelques arbres, ces espaces ont une allure inhospitalière. Leur boisement est pourtant une solution efficace et économique afin de créer de nouveaux puits de carbone, des réservoirs naturels de GES, assure le chercheur. «Il y a très peu de conflits entourant l’utilisation de ces terres. Ce ne sont pas des terres arables et elles sont souvent déjà accessibles par les chemins forestiers actuels», explique-t-il.
L’an dernier, une étude dirigée par son collègue François Hébert a confirmé que ces terrains étaient bel et bien viables à la plantation d’arbres. «Est-ce que ça pousse? ”Oui ça pousse!” Est-ce que ça survit? ”Oui, ça survit!” Le taux de survie est comparable à n’importe quelle autre plantation, mais la croissance est moins rapide», note M. Boucher. Pour en arriver à ce constat, les chercheurs ont analysé pendant une décennie la croissance de 18 lots d’épinettes noires dans six secteurs de terrains dénudés boréaux situés au centre de la province.
En 2007, le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) avait d’ailleurs conseillé d’augmenter les superficies forestières pour lutter contre les changements climatiques. Cinq ans plus tard, l’équipe de l’UQAC a donc modélisé par ordinateur un scénario dans lequel le quart des terrains dénudés boréaux du Québec seraient boisés sur une période de 20 ou 50 ans.
Sur papier, les résultats sont prometteurs, mais exigeront beaucoup de patience. Dans le meilleur des cas, après 45 ans, ces nouvelles forêts permettraient d’absorber 8% des émissions de CO2 de l’industrie québécoise si celles-ci demeurent stables.
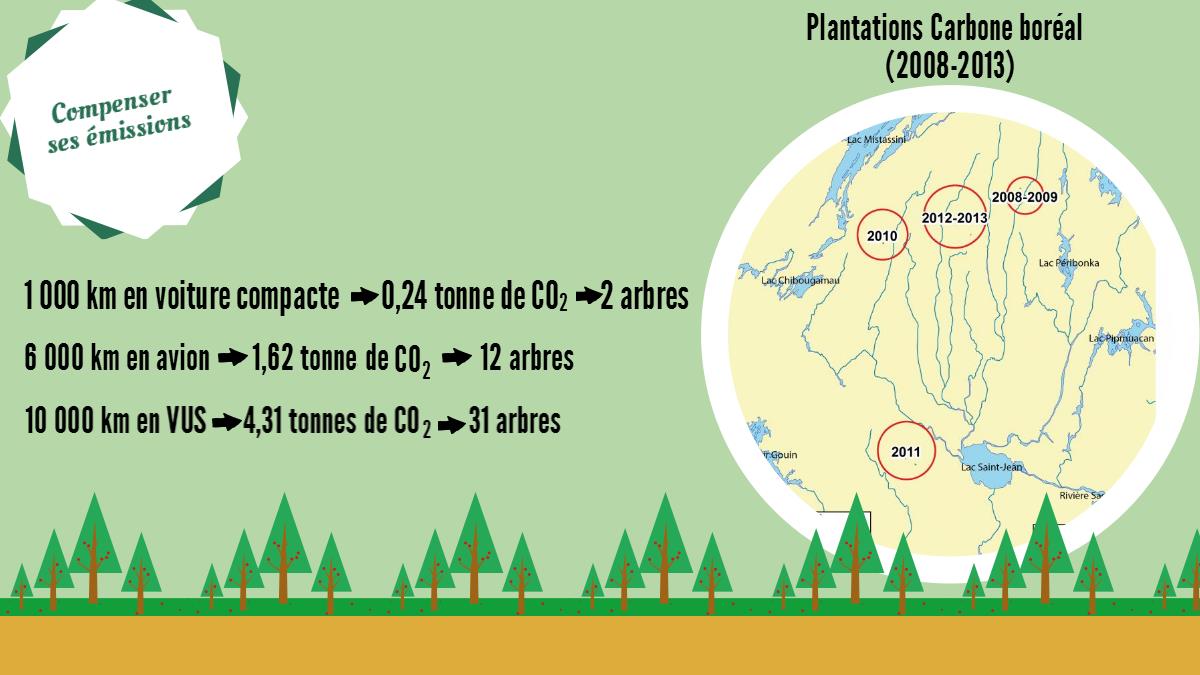
Carte et données fournies par Carbone boréal
Faire d’une pierre, trois coups
Pour financer ces recherches, Jean-François Boucher et son collègue Claude Villeneuve, directeur de la Chaire en éco-conseil de l’UQAC ![]() , ont uni leurs forces pour mettre sur pied le projet Carbone boréal
, ont uni leurs forces pour mettre sur pied le projet Carbone boréal ![]() . «On s’est dit qu’il fallait faire contribuer le public. En établissant ce projet original, ça donnait aussi un laboratoire naturel extraordinaire pour nous et les générations futures», raconte M. Boucher.
. «On s’est dit qu’il fallait faire contribuer le public. En établissant ce projet original, ça donnait aussi un laboratoire naturel extraordinaire pour nous et les générations futures», raconte M. Boucher.
Le concept est simple. Depuis 2008, le public ou les entreprises peuvent calculer la quantité de CO2 émise par leurs activités. L’achat de «crédits de carbone» permet ensuite de compenser ces émissions par la plantation d’arbres, principalement en terrain dénudé. L’argent recueilli, près de 1.5 million de dollars jusqu’à présent, sert au financement des recherches et à la création de nouveaux puits de carbone.
Avec le succès populaire du projet, les recherches de l’équipe de l’UQAC ont pris une nouvelle orientation. L’objectif est maintenant d’évaluer si le boisement peut devenir une solution économique durable pour des investisseurs potentiels. Les premières études sont déjà entamées. «On veut améliorer et optimiser les rendements de ces terres afin qu’un investisseur puisse avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible », explique-t-il.
En variant les essences d’arbres, la période de plantation et la zone de production, une entreprise pourra idéalement compenser ses émissions de GES en dix ans, espère M. Boucher. Celle-ci pourra ensuite vendre les crédits qu’elle génère à d’autres entreprises plus polluantes. Qui a dit que l’argent ne poussait pas dans les arbres?
16 juin 2015
Valoriser la biodiversité en plein cœur de la ville
Texte et images par Anouk Jaccarini
Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir interviewé des membres du CEF. Voici le troisième de cinq articles mettant en vedette un projet d'Alain Paquette.

Fig. 1 Services écosystémiques de l’arbre
Depuis 2008, plus de la moitié des humains vivent dans les villes, et celles-ci empiètent de plus en plus sur les milieux naturels. Bien sûr, il faut protéger et restaurer ces milieux, mais on peut aussi intégrer la biodiversité dans le développement urbain en mettant en valeur les écosystèmes modifiés par l’homme.
La ville: un réseau d’habitats
Le promeneur qui arpente les rues de Montréal, s’il ouvre l’œil, se rendra compte que sa ville est parsemée de nombreux habitats qui accueillent des espèces animales et végétales: boisés, cours d’eau, milieux humides, terrains vagues, parcs et jardins privés, sans oublier les cimetières, les terrains de jeux et les toits verts. Si on a longtemps vu l’urbanisation comme un facteur de destruction des milieux naturels, nombreux sont les experts qui choisissent aujourd’hui de s’intéresser plutôt aux espaces hybrides ainsi créés, à la fois urbains et naturels – la forêt urbaine, par exemple, qui fournit aux êtres humains de nombreux services (voir la figure 1).
Protéger et valoriser la biodiversité urbaine
Pour protéger, enrichir et mettre en valeur les écosystèmes modifiés par l’homme, il faut sensibiliser les citadins à l’importance de la biodiversité. C’est dans ce but qu’Alain Paquette, chercheur à la Chaire CRSNG/Hydro-Québec sur la croissance de l’arbre de l’UQAM (dirigée par Christian Messier), a conçu le projet IDENT-Cité, un « parcours de la biodiversité » en double spirale grâce auquel notre promeneur, dès le printemps 2015, expérimentera directement l’importance de la diversité des espèces. Il y trouvera en proportions à peu près égales des feuillus et des conifères, qui formeront un arboretum où s’ajouteront aux essences qu’il connaît déjà (comme l’érable rouge ou l’amélanchier) d’autres espèces moins répandues en ville (voir la figure 2).
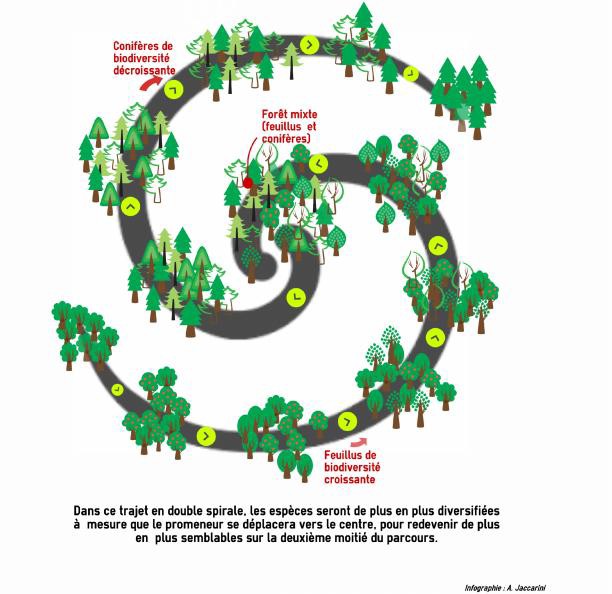
Fig. 2 Parcours en spirale
Disposées de façon à présenter ce qu’Alain Paquette appelle un « gradient de biodiversité », les espèces seront de plus en plus diversifiées à mesure que le promeneur se déplacera vers le centre de la spirale, pour redevenir de plus en plus semblables sur la deuxième moitié du parcours. Toutes les espèces plantées auront bien sûr en commun une bonne tolérance aux conditions urbaines, mais elles devront aussi présenter un large éventail de caractéristiques.
La diversité des espèces ne suffit pas toujours
En effet, ce n’est pas tout de diversifier les espèces; si elles se ressemblent trop, même dans les caractéristiques qui leur permettent de bien s’adapter en ville, elles risquent aussi d’avoir les mêmes vulnérabilités: « Les espèces qui ont les mêmes forces ont peut-être aussi les mêmes faiblesses, explique Alain Paquette. Si c’est le cas, elles pourraient toutes être vulnérables face aux mêmes facteurs de stress. » Or, si l’on souhaite améliorer la biodiversité urbaine, c’est parce qu’on pose l’hypothèse que plus une forêt est diversifiée, plus elle sera résiliente face aux changements globaux (tempêtes violentes, infestations d’insectes exotiques, chaleur, sécheresse, pollution).

Agrile adulte
(photo: Ville de Montréal)
Agrile du frêne: L’agrile du frêne est un parasite qui touche toutes les espèces de frênes et entraîne la perte de centaines d’arbres chaque année dans la métropole.
Érable de Norvège: On trouve sur les terrains publics de Montréal plus de 55 000 érables de Norvège. Cette espèce originaire d’Europe a été très populaire dans les villes pour remplacer les arbres touchés par la maladie hollandaise de l’orme; très résistante à la pollution, elle s’établit et pousse rapidement, même si l’espace est restreint et le sol, pauvre. Cependant, elle prend la place des espèces indigènes; la Ville doit donc prendre des mesures pour en stopper la plantation, au moins dans les parcs naturels.
C’est d’ailleurs en partie pour vérifier cette hypothèse qu’Alain Paquette a créé le projet IDENT-Cité, le dernier-né du réseau IDENT (International Diversity Experiment Network with Trees) qui mène déjà dans plusieurs régions du monde des expériences où l’on mesure les effets de la biodiversité sur différentes fonctions des écosystèmes, comme la productivité et la résilience. Ce nouveau parcours – le tout premier en milieu urbain – permettra aux chercheurs de vérifier l’importance de la biodiversité en ville et de préciser les caractéristiques à privilégier chez les arbres qu’on veut planter en milieu urbain (on sait déjà, par exemple, qu’ils doivent idéalement résister au vent, à la compaction des sols et aux sels de déglaçage, être capables de pousser à l’ombre et de faire leurs racines en surface).
Il faut dire que pour l’instant, la liste d’espèces tolérantes aux conditions urbaines n’est pas très longue et s’amenuise d’année en année, entre autres parce que certaines essences sont touchées par des parasites comme l’agrile du frêne. Par ailleurs, certaines espèces exotiques, bien adaptées au milieu urbain, ont tendance à prendre la place de leurs cousines indigènes; on souhaite donc en réduire le nombre, notamment près des milieux naturels.
Le projet IDENT-Cité résulte d’une collaboration entre l’UQAM et l’Arrondissement Ahuntsic- Cartierville; au cours des 5 prochaines années, grâce à une subvention de l’arrondissement, des étudiants animeront le parcours et créeront du matériel d’interprétation.
5 juin 2015
Nouvelle plantation IDENT - ComplexCité
Texte et photos par Daniel Lesieur

Mise en terre protocolaire. De gauche à droite, Messieurs Stéphane Bock, Xavier Francoeur et Daniel Bock, Maire de Notre-Dame-de-la-Paix
C'est le 2 juin dernier qu'a débuté la mise en terre des plants d'une nouvelle plantation ComplexCité - IDENT en Outaouais.
Contrairement aux plantations traditionnelles, ce dispositif s’inspire des aménagements que l’on retrouve en milieu urbain. Thuya, physocarpe, amélanchier, paturin (gazon), fleurs des champs sont quelques-unes des plantes qui ont été mise en terre près de Notre-Dame-de-la-Paix dans la Petite-Nation et que l’on retrouve fréquemment dans les parterres en ville. En disposition régulière ou regroupée, en combinaison simple ou multiple, ce dispositif devrait permettre à Xavier Francoeur, étudiant au doctorat dans le laboratoire de Christian Messier à l’UQAM et l’UQO, de mieux comprendre les relations s’établissant entre les espèces présentes et les gains écosystémiques. « Les études démontrent depuis plusieurs années que les systèmes simples, peu diversifiés, sont plus sensibles aux perturbations et qu’ils sont moins résilients mais très peu d’études en milieu urbain à ce jour n’ont démontré à quel point les systèmes complexes pouvaient être bénéfiques pour la nature et les humains » de dire Xavier. Une fois en place, Xavier suivra l’évolution des plantes mais également des communautés d’insectes et de microbes qui viendront coloniser ce nouvel environnement. « On parle beaucoup de la perte des insectes pollinisateurs ces derniers temps. Est-ce que l’on peut trouver une manière d’aménager qui pourrait les favoriser»? Cet exemple n’est qu’une des nombreuses questions que cet étudiant se pose! Ce dispositif s'inscrit dans son projet de doctorat qui cherche à savoir où et comment planter pour restaurer la connectivité et et augmenter la biodiversité et la résilience (et les autres services écosystèmiques). Malgré la [courte] durée de son doctorat, Xavier est confiant de pouvoir démontrer l’importance d’aménager de façon complexe … même en milieu urbain!

L’équipe de terrain en compagnie du Dr. Christian Messier
28 mai 2015
La CEFoshère en bref




Depuis la dernière parution de la CEFOspère en bref, Eliot McIntire a lancé un nouveau blogue, Predictive Ecology ![]() , dans lequel il vous explique comment on peut faire de la prédiction en écologie au moyen de la simulation avec le language R et le package SpaDES développé par son équipe. Dans une série de billets, il teste la rapidité du logiciel R pour les modèles de simulations dans plusieurs situations: pour la moyenne
, dans lequel il vous explique comment on peut faire de la prédiction en écologie au moyen de la simulation avec le language R et le package SpaDES développé par son équipe. Dans une série de billets, il teste la rapidité du logiciel R pour les modèles de simulations dans plusieurs situations: pour la moyenne ![]() , le triage des données
, le triage des données ![]() et la suite de Fibonacci
et la suite de Fibonacci ![]() . Vous pourrez également apprendre comment installer les packages d’analyse spatiale
. Vous pourrez également apprendre comment installer les packages d’analyse spatiale ![]() et comment faire une comparaison fiable de nombres réels dans R
et comment faire une comparaison fiable de nombres réels dans R ![]() .
.
Vous avez manqué le colloque du Réseau Ligniculture Québec en mars dernier? Lisez le très bon résumé ![]() d’Eric Alvarez. Il synthétise les points essentiels des présentations tout en vous invitant à consulter les conférences du colloque
d’Eric Alvarez. Il synthétise les points essentiels des présentations tout en vous invitant à consulter les conférences du colloque ![]() si vous voulez en savoir plus. Eric a également produit un graphique
si vous voulez en savoir plus. Eric a également produit un graphique ![]() qui illustre les statistiques de récolte dans les forêts publiques québécoises mises à jour avec les plus récentes données du rapport annuel « Ressources et industries forestières — Portrait statistique, Édition 2015 ». Vous pourrez également lire un résumé du troisième rapport de Chantier
qui illustre les statistiques de récolte dans les forêts publiques québécoises mises à jour avec les plus récentes données du rapport annuel « Ressources et industries forestières — Portrait statistique, Édition 2015 ». Vous pourrez également lire un résumé du troisième rapport de Chantier ![]() faisant suite au Rendez-vous national de la forêt de l’automne 2013, soit le Chantier sur la production de bois. Un rapport qui constituera le volet économique de la future Stratégie d’Aménagement Durable des Forêts du gouvernement. Enfin, il présente un extrait d’un compte-rendu
faisant suite au Rendez-vous national de la forêt de l’automne 2013, soit le Chantier sur la production de bois. Un rapport qui constituera le volet économique de la future Stratégie d’Aménagement Durable des Forêts du gouvernement. Enfin, il présente un extrait d’un compte-rendu ![]() d’un symposium sur « Le calcul de la possibilité en aménagement forestier » qui s’était tenu dans le cadre de la Semaine des sciences forestières de 1969. L’extrait consiste en un débat qui eut lieu concernant la justesse de calculer la possibilité forestière sur la base de la forêt « réelle » ou la forêt du futur, un débat oublié aujourd’hui, mais qui selon Eric aurait intérêt à refaire surface.
d’un symposium sur « Le calcul de la possibilité en aménagement forestier » qui s’était tenu dans le cadre de la Semaine des sciences forestières de 1969. L’extrait consiste en un débat qui eut lieu concernant la justesse de calculer la possibilité forestière sur la base de la forêt « réelle » ou la forêt du futur, un débat oublié aujourd’hui, mais qui selon Eric aurait intérêt à refaire surface.
André Desrochers poursuit sa réflexion sur les coupes à blanc ![]() en proposant de les déclarer «aire protégée». Dans le même billet, il critique l’idée que la perte d’habitat est la principale cause des extinctions massives. Il change de registre dans son billet suivant et livre une réflexion philosophique sur la vie extraterrestre
en proposant de les déclarer «aire protégée». Dans le même billet, il critique l’idée que la perte d’habitat est la principale cause des extinctions massives. Il change de registre dans son billet suivant et livre une réflexion philosophique sur la vie extraterrestre ![]() . Vous pourrez aussi lire sur son blogue un résumé de Ecomodernist Manifesto
. Vous pourrez aussi lire sur son blogue un résumé de Ecomodernist Manifesto ![]() , un manifeste publié par le Breakthrough Institute, un groupe de réflexion qui propose une vision originale et pleine d’optimisme par rapport à l’environnement.
, un manifeste publié par le Breakthrough Institute, un groupe de réflexion qui propose une vision originale et pleine d’optimisme par rapport à l’environnement.
Si vous connaissez quelqu’un qui rêve de devenir arachnologiste ![]() , Christopher Buddle a rédigé un guide pour y parvenir. Il poursuit ses réflexions sur l’éducation sous plusieurs angles que ce soit sa participation à un événement sur l’Université du futur,
, Christopher Buddle a rédigé un guide pour y parvenir. Il poursuit ses réflexions sur l’éducation sous plusieurs angles que ce soit sa participation à un événement sur l’Université du futur, ![]() sa présence en classe
sa présence en classe ![]() en tant qu’étudiant de premier cycle, l’utilisation de twitter en classe
en tant qu’étudiant de premier cycle, l’utilisation de twitter en classe ![]() , le lien entre la rapidité à un examen et les résultats des étudiants
, le lien entre la rapidité à un examen et les résultats des étudiants ![]() ou le résumé d’un article sur l’utilisation des technologies en enseignement
ou le résumé d’un article sur l’utilisation des technologies en enseignement ![]() . Si vous vous demandez quoi faire si vous trouvez une araignée sur vos fruits, voici le mode d’emploi
. Si vous vous demandez quoi faire si vous trouvez une araignée sur vos fruits, voici le mode d’emploi ![]() . Depuis le début mai, Christopher a commencé une nouvelle rubrique intitulée Spiderday
. Depuis le début mai, Christopher a commencé une nouvelle rubrique intitulée Spiderday ![]() qu’il publie tous les samedis, ce billet est une suite de liens vers des sites qui ont publié à propos des arachnides durant la semaine. Vous trouverez aussi sur son blogue le résumé du dernier article publié par un membre de son laboratoire: Beetles from the North
qu’il publie tous les samedis, ce billet est une suite de liens vers des sites qui ont publié à propos des arachnides durant la semaine. Vous trouverez aussi sur son blogue le résumé du dernier article publié par un membre de son laboratoire: Beetles from the North ![]() .
.
26 mai 2015
L’or brun du Québec
Texte par Camille Martel et image par Jean-François Bourdon
Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir interviewé des membres du CEF. Voici le deuxième de cinq articles mettant en vedette une recherche de Jean-François Bourdon.

Morille de feu
Après un feu, la forêt semble dévastée. Sombre et inanimée, elle a été dépouillée de ces attraits. Mais le passage des flammes pourrait-il révéler un joyau qui autrement ne serait découvert?
Les cheveux ébouriffés et quelques cartes sous le bras, Jean-François Bourdon transporte deux sacs remplis de morilles. Aussi bien dire qu’il a des centaines de dollars au bout des doigts. Depuis 2011, la vie de ce candidat à la maîtrise en sciences forestières tourne autour de ces mystérieux champignons.
Son ancien colocataire, Frank Tuot, d’origine française, l’a initié aux morilles. « En France, la récolte du champignon est beaucoup plus développée qu’au Québec », affirme Jean-François Bourdon. Ici, on commence tout juste à s’y intéresser.
Un champignon prisé
Goûteuse à souhait, la morille est prisée par les chefs cuisiniers. Au Québec, on compte environ 400 $-750 $ pour 1 kg de morilles séchées.
Dans l’Ouest canadien, on cueille la morille depuis 30 ans. Au Québec, les cueilleurs de morilles sont rarissimes. On retrouve surtout ces champignons en forêt boréale. Des récoltes commerciales ont seulement été tentées à trois reprises au Québec, soit en 2006, 2011 et 2014.
La morille de feu se retrouve, comme son nom l’indique, sur des sols qui ont brûlé. La couche supérieure du sol, l’humus, est consumée lors des feux de forêt. Le sol minéral, en- dessous, se retrouve alors exposé. L’été suivant le feu, les morilles produisent un ascocarpe, le chapeau brun et flétri que l’on mange.
Le hic est qu’il n’y a toujours pas de moyen efficace pour les repérer afin d’en faire la récolte. C’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin! C’est ici que le jeune chercheur entre en jeu.
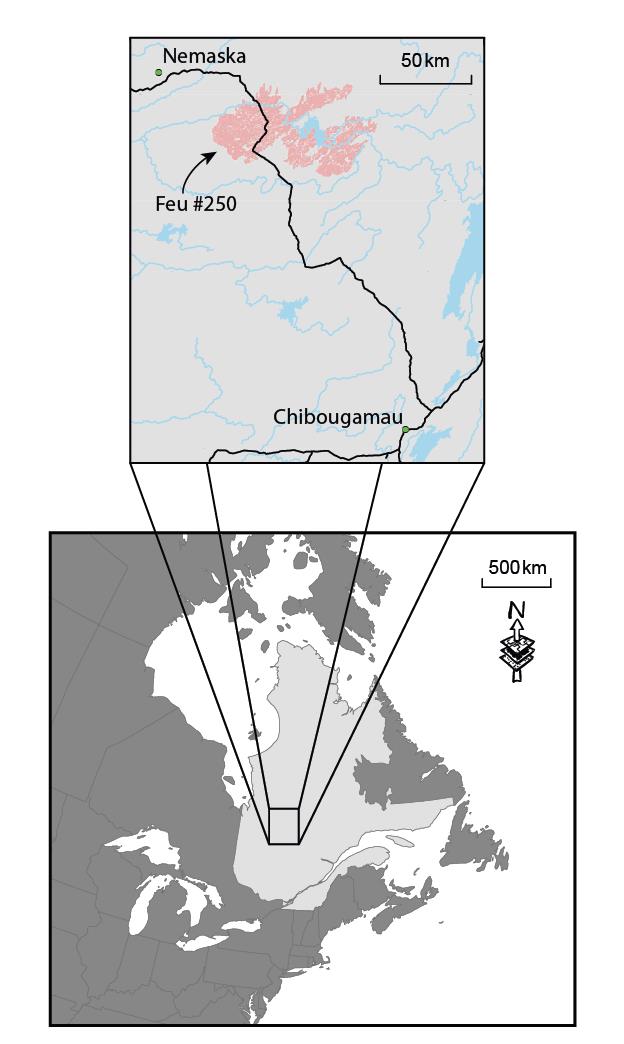
Localisation du site d’étude
Un allié précieux, à des milliers de kilomètres En utilisant l’imagerie satellite, Jean-François Bourdon a pu avoir une vue d’ensemble des feux qui ont fait rage au Québec chaque année. Il s’est concentré sur un territoire situé à environ 250 km au nord de Chibougamau, où un feu de 185 000 hectares a fait rage en 2013.
Sur les images du satellite Landsat-7, il a évalué la sévérité de ce feu en le comparant au même territoire, trois ans plus tôt. Tel qu’illustré sur l’image ci-dessous, il a superposé les images de 2010 et 2013. L’image du haut est celle qui calcule la différence de végétation entre les deux. Ce qui a brûlé et ce qui est resté intact. L’indice dNBR (delta Normalized Burned Ratio) lui a permis d’attribuer une valeur numérique à la sévérité du feu qui a eu lieu. Le dNBR est un algorithme qui se calcule à partir d’un logiciel informatique.
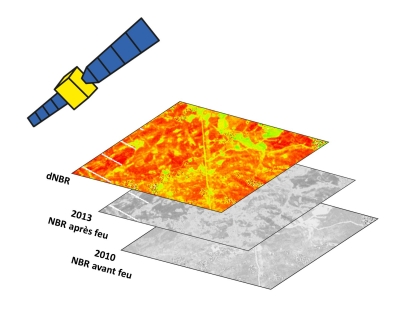
Imagerie satellite et utilisation du dNBR
Il a ainsi pu repérer là où le feu a été le plus sévère, soit les zones figurant en rouge sur la carte. L’étudiant entreprend ses recherches sur le terrain à l’été suivant, en 2014.
Il localise les morilles selon la sévérité du feu et prédit les sites potentiels pour la cueillette. Sur les lieux, il géolocalise plus de 5000 morilles! Ses résultats montrent qu’il y a plus de morilles là où la végétation avait été le plus touchée. Pour Jean-François, c’est une première.
Des obstacles sur la route
Ce projet n’a pas été de tout repos pour Jean-François Bourdon. « Ça m’a rendu un peu fou », dit-il. « Lorsqu’on commence à chercher des morilles, c’est un peu comme une chasse au trésor. » N’ayant pas reçu de financement pour son projet, il a dû payer ses coûteuses recherches sur le terrain de sa poche. Néanmoins, quelques entreprises locales lui sont venues en aide en lui fournissant un peu de nourriture et d’essence.

Cartographie des sites d’étude et morilles séchées
Son projet suscite la curiosité des cueilleurs et marchands de champignons ainsi que celle des entreprises forestières. Le potentiel de commercialisation des morilles est attirant. Jean-François Bourdon explique que la cueillette de la morille pourrait être une nouvelle activité économique en région. « Les coupes forestières pourraient se synchroniser avec la cueillette de morilles », dit-il. Ainsi, deux ressources naturelles pourraient être exploitées de concert.
Pour l’avenir, le jeune ingénieur veut consolider ses recherches et mettre au point une manière efficace de récolter la morille de feu. Il aimerait intégrer une entreprise qui lui permettrait de poursuivre ses recherches sur la détection de ces précieux champignons.
Il validera ses recherches sur le terrain, en juin prochain.
Un joyau, enfin dévoilé!
29 avril 2015
L’hiver à tire-d’aile
Texte par Jessica Finders et photo par André Desrochers
Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir interviewé des membres du CEF. Voici le premier de cinq articles mettant en vedette une recherche d'André Desrochers.

Les ailes du Mésangeai du Canada, Perisoreus canadensis,
une espèce commune des forêts boréales, sont devenues
beaucoup plus allongées sur les 100 dernières années,
favorisant des déplacements sur de plus longues distances.
Pour un oiseau, survivre à la saison froide est un grand défi. Alors quand la forêt change de paysage, il faut s’adapter, et vite.
Lorsque le thermostat frôle les -30°C et que le vent balaye les mètres de neige au-dehors, il est l’heure de s’installer confortablement dans son salon, un bon chocolat chaud à la main et d’attendre le retour du printemps. Pas pour André Desrochers, chercheur au département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval. Armé de ses jumelles et de ses raquettes, il affronte les températures extrêmes de la Forêt de Montmorency pour comprendre un phénomène encore peu étudié à ce jour: qu’arrive-t-il donc aux oiseaux résidents (non-migrateurs), bravant l’hiver québécois, lorsqu’on leur coupe les arbres sous les pieds?
La récolte de bois, à ne pas confondre avec la déforestation, présente des avantages écologiques, comme la création de nouveaux habitats, et socio-économiques, tel que la construction ou la production de papier. Revers de la médaille, elle fragmente les forêts, ce qui perturbe le mouvement et la dispersion des animaux vivant dans ce milieu. Ils sont notamment obligés de voyager plus loin pour trouver des partenaires, de l’habitat et le plus important en hiver: de la nourriture.
Dans le cas de la mésange à tête brune par exemple, se nourrir est d’une importance capitale pour survivre au grand froid. Du haut de ses 12 g, elle peut perdre jusqu’à 20% de son poids en une seule nuit, en brûlant ses réserves de graisse pour en faire de la chaleur corporelle. « Entre le nuit et le jour, son poids est un vrai yoyo, illustre André Desrochers. Chez un homme adulte comme moi par exemple, cela correspondrait à 10-15 kg! » La mésange doit travailler dur à regagner ses grammes perdus, d’autant plus si elle se trouve dans une forêt fragmentée, dans laquelle ses voyages lui demandent plus de temps et plus d’énergie.
Des habitats fragmentés en petits territoires impliquent plus de déplacements. Au cours de l’évolution, les individus les plus athlétiques devaient être favorisés. Pour étudier cette hypothèse, André Desrochers a analysé 851 spécimens du Musée de l’Université Cornell et du Musée Canadien de la Nature, regroupant 21 espèces d’oiseaux chanteurs des forêts nord-américaines entre 1900 et 2008. Le chercheur a eu l’idée de mesurer la longueur des ailes, un caractère très héréditaire, et de comparer ses mesures sur les dizaines de générations d’oiseaux à sa disposition.
Les résultats de sa recherche ne l’ont pas déçu: les ailes des oiseaux de forêts boréales fragmentés, comme le Mésangeai du Canada et la Mésange à tête brune, se sont allongées durant ces 100 dernières années. « Il est préférable pour les oiseaux d’avoir des ailes allongées, parce que c’est plus efficace pour un vol soutenu », explique le chercheur.
En Nouvelle-Angleterre, les forêts ont moins subi les effets de la fragmentation. De ce fait, les espèces d’oiseaux chanteurs de cette région, tels que la Sittelle à poitrine blanche et la Paruline des pins, n’ont pas besoin de se déplacer autant que leurs cousins des forêts fragmentées. En conséquence, leurs ailes ont évolué vers une forme plus courte et plus ronde. « Si un oiseau se nourrit dans de la végétation plus dense, il ne voudra pas s’encombrer de longues ailes », ajoute André Desrochers.
Bonne nouvelle! Malgré le changement apparent de leurs habitats, ces oiseaux ont donc su s’adapter en quelques générations et continuent à bien vivre dans les forêts enneigées du Québec. « La capacité des oiseaux à s’adapter rapidement à la perte et la fragmentation des forêts peut atténuer, sans nécessairement faire obstacle, le risque de disparition ou d'extinction régionale », suggère André Desrochers dans son article publié en 2010 dans la revue Ecology.
Son projet ne s’arrête pas là. Tandis que l’expert suggère davantage de recherche sur la rapidité d’adaptation des oiseaux face à la perte d’habitat dans d’autres parts du monde, cette étude se poursuit à l’Université Laval avec un nouveau membre de l’équipe, Flavie Noreau, qui a entamé sa maîtrise sur la relation entre l’écologie et la morphologie des oiseaux forestiers durant l’été 2014.
De son côté, André Desrochers continue à braver le froid de la Forêt de Montmorency. Dans ses recherches sur le comportement des mésanges, il titille les petits oiseaux avec des enregistrements de chants pour observer leur volonté à traverser différentes tailles des fragments dans la couverture forestière. Après tout, avoir les longues ailes ne suffit pas, il faut aussi vouloir les utiliser!
24 mars 2015
La CEFoshère en bref



Cette semaine, André Desrochers fait l’éloge des coupes à blanc ![]() et critique Boreal Birds Need Half, une initiative basée sur un rapport auquel ont participés plusieurs scientifiques, notamment Marcel Darveau. Selon André, plusieurs espèces d’oiseaux abondent dans les jeunes peuplements qui poussent après les coupes à blanc. Dans son billet précédent, « Tirer sur le messager
et critique Boreal Birds Need Half, une initiative basée sur un rapport auquel ont participés plusieurs scientifiques, notamment Marcel Darveau. Selon André, plusieurs espèces d’oiseaux abondent dans les jeunes peuplements qui poussent après les coupes à blanc. Dans son billet précédent, « Tirer sur le messager ![]() », André déplore que l’on discrédite les conclusions de certains chercheurs en s’attaquant à leurs sources de financement plutôt qu’à leurs arguments et à l’intégrité du processus scientifique qui a mené à ces arguments. Son billet du 10 février, quant à lui, concerne le relativisme écosystémique
», André déplore que l’on discrédite les conclusions de certains chercheurs en s’attaquant à leurs sources de financement plutôt qu’à leurs arguments et à l’intégrité du processus scientifique qui a mené à ces arguments. Son billet du 10 février, quant à lui, concerne le relativisme écosystémique ![]() , c’est-à-dire l’idée que tous les écosystèmes se valent à l’intérieur de certaines limites. Ce relativiste écologique s’oppose à la croyance selon laquelle la forêt préindustrielle est un idéal à atteindre. André propose un mariage des deux visions pour trouver un équilibre dans la gestion des écosystèmes.
, c’est-à-dire l’idée que tous les écosystèmes se valent à l’intérieur de certaines limites. Ce relativiste écologique s’oppose à la croyance selon laquelle la forêt préindustrielle est un idéal à atteindre. André propose un mariage des deux visions pour trouver un équilibre dans la gestion des écosystèmes.
Eric Alvarez, de son côté, fait une analogie entre l’industrie forestière et les essences pionnières ![]() qui s’installent tous deux en premier dans les nouveaux territoires en se basant sur l’histoire de l’aménagement forestier du parc Forêt nationale Tongass en Alaska. Il se demande si l’industrie forestière serait vouée à disparaitre comme ces espèces pionnière lorsque la forêt vieillit? Eric propose également deux références incontournables
qui s’installent tous deux en premier dans les nouveaux territoires en se basant sur l’histoire de l’aménagement forestier du parc Forêt nationale Tongass en Alaska. Il se demande si l’industrie forestière serait vouée à disparaitre comme ces espèces pionnière lorsque la forêt vieillit? Eric propose également deux références incontournables ![]() pour l’histoire forestière: la première présente 16 cartes numérisées datées de 1884 concernant la distribution spatiale de plusieurs « genres » d’essences forestières en Amérique du Nord. La deuxième montre de minces coupes transversales du bois de 350 essences forestières que l’on pouvait rencontrer en Amérique du Nord vers la fin du 19e siècle. Eric vous présente aussi un compte-rendu écrit par Chris Bolgiano d’un voyage forestier en Allemagne
pour l’histoire forestière: la première présente 16 cartes numérisées datées de 1884 concernant la distribution spatiale de plusieurs « genres » d’essences forestières en Amérique du Nord. La deuxième montre de minces coupes transversales du bois de 350 essences forestières que l’on pouvait rencontrer en Amérique du Nord vers la fin du 19e siècle. Eric vous présente aussi un compte-rendu écrit par Chris Bolgiano d’un voyage forestier en Allemagne ![]() publié dans le Forestry Source d’octobre 2014 intitulé « Life, Love and Forestry: Travels in Germany as a tribute to Carl Alwin Schenck ». Il propose ensuite un récapitulatif historique de l’évolution des limites des territoires d’aménagement forestier au Québec dans les trente dernières années. Ceux-ci ne cessent de changer et détruisent du même coup la mémoire de la forêt québécoise.
publié dans le Forestry Source d’octobre 2014 intitulé « Life, Love and Forestry: Travels in Germany as a tribute to Carl Alwin Schenck ». Il propose ensuite un récapitulatif historique de l’évolution des limites des territoires d’aménagement forestier au Québec dans les trente dernières années. Ceux-ci ne cessent de changer et détruisent du même coup la mémoire de la forêt québécoise.
Christopher Buddle souligne la journée des taxonomistes ![]() (19 mars) en rappelant l’importance de leur travail. Deux membres de son laboratoire se présentent dans la série de billets « Meet the Lab »: Chris Cloutier
(19 mars) en rappelant l’importance de leur travail. Deux membres de son laboratoire se présentent dans la série de billets « Meet the Lab »: Chris Cloutier ![]() et Shaun Turney
et Shaun Turney ![]() . Un autre étudiant de son laboratoire, Raphaël Royauté, présente le résumé d’un article
. Un autre étudiant de son laboratoire, Raphaël Royauté, présente le résumé d’un article ![]() qu’il a publié: « Under the influence: sublethal exposure to an insecticide affects personality expression in a jumping spider ». Sur une note plutôt légère, Christopher fait une ode à ses étudiants gradués
qu’il a publié: « Under the influence: sublethal exposure to an insecticide affects personality expression in a jumping spider ». Sur une note plutôt légère, Christopher fait une ode à ses étudiants gradués ![]() et anticipe l’arrivée du printemps
et anticipe l’arrivée du printemps ![]() qui devrait arriver bientôt. Courage! Enfin, Christopher annonce son projet de livre sur les araignées
qui devrait arriver bientôt. Courage! Enfin, Christopher annonce son projet de livre sur les araignées ![]() et invite les auteurs intéressés à se joindre à lui et Eleanor Spicer Rice.
et invite les auteurs intéressés à se joindre à lui et Eleanor Spicer Rice.
5 février 2014
La CEFoshère en bref



Vous souhaitez améliorer votre sens de la répartie? Lisez les deux derniers billets d’André Desrochers. Vous saurez comment éviter de faire des Anne Dorval de vous lors d’un débat ![]() , en plus de découvrir une nouvelle loi des débats inspirée de la Loi de Godwin: la Loi du Pépé ou l’appel prévisible au principe de précaution
, en plus de découvrir une nouvelle loi des débats inspirée de la Loi de Godwin: la Loi du Pépé ou l’appel prévisible au principe de précaution ![]() .
.
Comme promis, Eric Alvarez nous livre ses appréciations du Chantier sur l’efficacité des mesures en forêt privée ![]() et du Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier
et du Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier ![]() , deux rapports qui ont été rendus public à l’automne durant la même période que le Rapport du Comité scientifique sur la limite nordique des forêts attribuables et qui n’ont pas été mis en valeur. Eric vous propose aussi un compte-rendu rafraichissant du 2e Séminaire sur le calcul des possibilités forestières
, deux rapports qui ont été rendus public à l’automne durant la même période que le Rapport du Comité scientifique sur la limite nordique des forêts attribuables et qui n’ont pas été mis en valeur. Eric vous propose aussi un compte-rendu rafraichissant du 2e Séminaire sur le calcul des possibilités forestières ![]() sous forme d’abécédaire. Comme à chaque début d’année vous pourrez également lire le bilan de 2014 et perspective pour 2015
sous forme d’abécédaire. Comme à chaque début d’année vous pourrez également lire le bilan de 2014 et perspective pour 2015 ![]() de son blogue Forêt à Cœur que vous êtes nombreux à consulter puisqu’il y a eu 5 016 utilisateurs en 2014. Dans son dernier billet, il répond de façon percutante à une question délicate de l’actualité: la mise à mort d’une ou plusieurs usines de transformation (et leurs emplois) est-elle justifiée au nom de la certification FSC?
de son blogue Forêt à Cœur que vous êtes nombreux à consulter puisqu’il y a eu 5 016 utilisateurs en 2014. Dans son dernier billet, il répond de façon percutante à une question délicate de l’actualité: la mise à mort d’une ou plusieurs usines de transformation (et leurs emplois) est-elle justifiée au nom de la certification FSC? ![]()
Christopher Buddle s’interroge sur les concepts clés de l’écologie ![]() que tout le monde apprend dès l’école primaire. Il discute entre autres du concept de la chaine alimentaire. Ce thème est de nouveau abordé sur le blogue arthropodecology
que tout le monde apprend dès l’école primaire. Il discute entre autres du concept de la chaine alimentaire. Ce thème est de nouveau abordé sur le blogue arthropodecology ![]() où il présente un article publié par une de ces étudiantes: Effect of fragmentation on predation pressure of insect herbivores in a north temperate deciduous forest ecosystem
où il présente un article publié par une de ces étudiantes: Effect of fragmentation on predation pressure of insect herbivores in a north temperate deciduous forest ecosystem ![]() . Vous pourrez égalent vous divertir en lisant un hommage aux moustiques écrasés
. Vous pourrez égalent vous divertir en lisant un hommage aux moustiques écrasés ![]() écrit par un des étudiants de Christopher. Un troisième membre de son laboratoire, Elyssa Cameron
écrit par un des étudiants de Christopher. Un troisième membre de son laboratoire, Elyssa Cameron ![]() , se présente dans la série de billets Meet the lab. Christopher vous donne aussi des conseils pédagogiques pour animer une discussion sur un article scientifique
, se présente dans la série de billets Meet the lab. Christopher vous donne aussi des conseils pédagogiques pour animer une discussion sur un article scientifique ![]() et pour inclure les étudiants dans les activités d’apprentissage
et pour inclure les étudiants dans les activités d’apprentissage ![]() . Si vous êtes curieux de nature et que vous êtes intéressé par la recherche en histoire naturelle, lisez le billet
. Si vous êtes curieux de nature et que vous êtes intéressé par la recherche en histoire naturelle, lisez le billet ![]() de Christopher qui vous donne des trucs pour pratiquer ce type de recherche en catimini dans le contexte actuel d’austérité.
de Christopher qui vous donne des trucs pour pratiquer ce type de recherche en catimini dans le contexte actuel d’austérité.
20 novembre 2014
La CEFoshère en bref
Vous vous cherchez de la lecture pour le temps des fêtes? Eric Alvarez fait la revue d’un livre d’histoire sur les feux de forêt au Québec ![]() , un livre essentiel pour quiconque s’intéresse non seulement à l’histoire forestière québécoise, mais aussi aux passionnés de l’histoire du Québec en général. Dans un autre billet, il présente le cas unique d’aménagement que présente le parc Algonquin
, un livre essentiel pour quiconque s’intéresse non seulement à l’histoire forestière québécoise, mais aussi aux passionnés de l’histoire du Québec en général. Dans un autre billet, il présente le cas unique d’aménagement que présente le parc Algonquin ![]() situé en Ontario, un modèle pour le Québec. Eric se fait également un devoir de vous faire découvrir les trois rapports
situé en Ontario, un modèle pour le Québec. Eric se fait également un devoir de vous faire découvrir les trois rapports ![]() que le MFFP a rendus publics de façon très discrète le 16 octobre dernier. Il commence avec rapport du Comité scientifique sur la limite nordique des forêts attribuables
que le MFFP a rendus publics de façon très discrète le 16 octobre dernier. Il commence avec rapport du Comité scientifique sur la limite nordique des forêts attribuables ![]() . Restez à l’affût pour en apprendre plus prochainement sur les deux autres rapports des Chantiers découlant du Rendez-vous national de la forêt québécoise de l’automne 2013.
. Restez à l’affût pour en apprendre plus prochainement sur les deux autres rapports des Chantiers découlant du Rendez-vous national de la forêt québécoise de l’automne 2013.
Christopher Buddle a été moins actif que d’habitude sur ses blogues, vous pourrez tout de même y lire trois billets. Sur le blogue Expiscor ![]() , vous pourrez découvrir les champignons nid d’oiseau
, vous pourrez découvrir les champignons nid d’oiseau ![]() . Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez fait des études aux cycles supérieurs, sachez que vous n’êtes pas seul. Sur le blogue Arthropod Ecology
. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez fait des études aux cycles supérieurs, sachez que vous n’êtes pas seul. Sur le blogue Arthropod Ecology ![]() vous pourrez découvrir les motivations d’autres étudiants et de Christopher lui-même.
vous pourrez découvrir les motivations d’autres étudiants et de Christopher lui-même. ![]() Vous pourrez également faire la connaissance d'un deuxième membre de son laboratoire, Sarah Loboda
Vous pourrez également faire la connaissance d'un deuxième membre de son laboratoire, Sarah Loboda ![]() .
.
Vous serez poussé à revisiter votre point de vue sur certains sujets si vous lisez les quatre nouveaux billets d’André Desrochers, que ce soit sur la fonte des glaces de l’Arctique ![]() , l’aménagement de la baie de Beauport
, l’aménagement de la baie de Beauport ![]() , le musellement des scientifiques au gouvernement
, le musellement des scientifiques au gouvernement ![]() ou la censure des scientifiques qui vont à l’encontre du consensus
ou la censure des scientifiques qui vont à l’encontre du consensus ![]() par les scientifiques eux-mêmes. André attaque ces sujets sous un angle parfois surprenant et toujours rafraîchissant, de la bonne matière pour aiguiser votre sens critique!
par les scientifiques eux-mêmes. André attaque ces sujets sous un angle parfois surprenant et toujours rafraîchissant, de la bonne matière pour aiguiser votre sens critique!
2 octobre 2014
La CEFoshère en bref
Après une longue pause, la CEFoshère est de retour. Les blogueurs du CEF sont toujours aussi actifs. En espérant que cette revue de leurs dernières publications vous donnera le goût de les suivre.
La belle saison a inspiré André Desrochers qui a publié trois billets depuis son retour en septembre. Le premier est dédié aux espèces qui dépendent des mesures de conservation ![]() parfois drastiques et souvent onéreuses pour leur survie. Exaspéré par le rapport de la société Audubon sur l’avenir prochain des oiseaux d’Amérique du Nord, André a écrit un billet hors-série
parfois drastiques et souvent onéreuses pour leur survie. Exaspéré par le rapport de la société Audubon sur l’avenir prochain des oiseaux d’Amérique du Nord, André a écrit un billet hors-série ![]() sur celui-ci pour canaliser ses frustrations. Dans son dernier billet, André aborde un thème qui tranche avec ses sujets habituels: le gaspillage alimentaire et le déchétarisme
sur celui-ci pour canaliser ses frustrations. Dans son dernier billet, André aborde un thème qui tranche avec ses sujets habituels: le gaspillage alimentaire et le déchétarisme ![]() .
.
Si vous vous intéressez à l’histoire de la foresterie québécoise, lisez les trois billets qu’Eric Alvarez a écrits sur l’histoire de l’aménagement forestier au Québec ![]() . Dans un autre billet, il vous recommande fortement la lecture du livre Empire of the beetle: how human folly and a tiny bug are killing North America’s great forests
. Dans un autre billet, il vous recommande fortement la lecture du livre Empire of the beetle: how human folly and a tiny bug are killing North America’s great forests ![]() d’Andrew Nikiforuk. Eric consacre son dernier billet aux tenures forestières et aux nations autochtones en Colombie-Britannique
d’Andrew Nikiforuk. Eric consacre son dernier billet aux tenures forestières et aux nations autochtones en Colombie-Britannique ![]() .
.
Sur le blogue Arthropod Ecology ![]() de Christopher Buddle vous pourrez lire le premier billet
de Christopher Buddle vous pourrez lire le premier billet ![]() d’une série dédiée à la présentation des membres de son laboratoire. Sur son blogue Expiscor
d’une série dédiée à la présentation des membres de son laboratoire. Sur son blogue Expiscor ![]() , vous apprendrez de quoi ont peur les araignées
, vous apprendrez de quoi ont peur les araignées ![]() et la vérité sur les morsures d’araignées
et la vérité sur les morsures d’araignées ![]() . De plus, vous pourrez voir de merveilleux sacs à œufs d’araignées
. De plus, vous pourrez voir de merveilleux sacs à œufs d’araignées ![]() dans une gallerie photos qui leur est consacrée. Christopher a aussi posé des questions à un chercheur australien pour savoir comment il étudie les effet de l’urbanisation sur les araignées
dans une gallerie photos qui leur est consacrée. Christopher a aussi posé des questions à un chercheur australien pour savoir comment il étudie les effet de l’urbanisation sur les araignées ![]() . Vous pourrez aussi lire sur son blogue dix faits intéressants sur le pic à tête rouge
. Vous pourrez aussi lire sur son blogue dix faits intéressants sur le pic à tête rouge ![]() et sur les staphylinidés
et sur les staphylinidés ![]() .
.
19 juin 2014
Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir assister aux séminaires d'étudiants en sciences forestières et en agroforesterie. Voici donc le dernier de six articles.
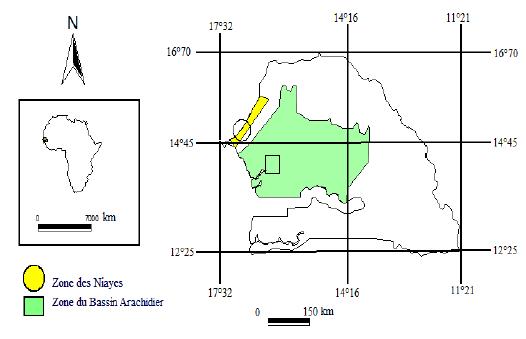
La zone des Niayes au Sénégal
Des arbres et des cultures: pour des sols plus riches au Sénégal
Texte par Thomas Duchaine et photos par Diatta Marone
En Afrique, l’agroforesterie est pratiquée depuis des millénaires. Mais de nouveaux défis commandent aujourd’hui l’optimisation des pratiques afin de préserver et d’améliorer la fertilité des sols.
Dans la zone des Niayes, au Sénégal, comme dans bien d’autres régions africaines densément peuplées, les besoins alimentaires croissants pressurisent les cultures. Associée aux changements climatiques, cette pression dégrade les sols. Or, les activités agroforestières sont au cœur de la subsistance des populations de la région et ces activités ont besoin de sols suffisamment riches en éléments nutritifs pour perdurer.
« L’agroforesterie est intéressante, parce qu’elle permet d’intégrer les arbres et les cultures annuelles, ce qui produit des avantages réciproques », affirme Diatta Marone, chercheur au doctorat en sciences forestières à l’Université Laval. En plus de leur litière qui enrichit le sol en matière organique, les arbres font remonter des éléments nutritifs et de l’humidité des profondeurs de la terre pour les cultures annuelles en surface. « Il s’agit donc d’éviter la concurrence entre les arbres et les cultures, ou de la contrôler, pour que les nutriments des profondeurs profitent aux couches superficielles », souligne M. Marone.

Un parc arboré dans les Niayes
L’intérêt du carbone
Dans les Niayes, comme dans toute l’Afrique sahélienne, le potentiel de stockage de carbone des différentes pratiques agroforestières est mal connu. « Mon travail c’est de voir, parmi les espèces d’arbres communément sélectionnées par les exploitants, quelles sont celles qui stockent le plus de carbone selon la pratique et le sol », explique le chercheur.
Pourquoi le carbone? « Parce qu’il rime avec matière organique », répond Diatta Marone. La matière organique emmagasine des éléments nutritifs en plus de structurer les sols, permettant ainsi aux plantes de se nourrir, de puiser de l’eau et d’assurer leur photosynthèse.
En plus de cinq essences d’arbres, il a retenu trois pratiques agroforestières et trois types de sol pour identifier les combinaisons les plus aptes à relever la fertilité des sols.
C’est par l’étude des traits fonctionnels que Diatta Marone a mesuré la performance des espèces retenues. « Les traits fonctionnels, comme la distribution en profondeur des racines ou le contenu en matière sèche des feuilles par exemple, peuvent aussi renseigner sur le comportement des espèces face aux changements environnementaux », ajoute-t-il.
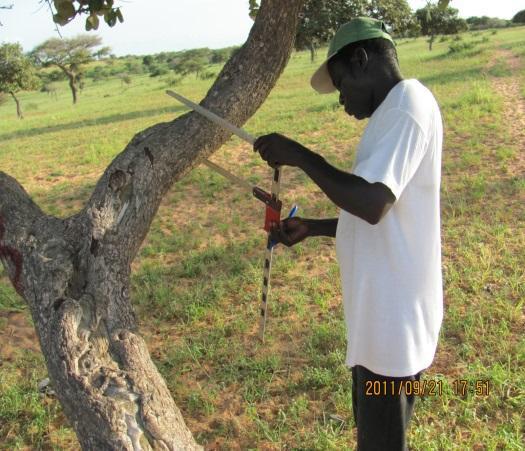
Le chercheur à l'oeuvre
Trois volets; des premières tendances
Diatta Marone a d’abord évalué la capacité de stockage de carbone de chaque espèce selon la pratique agroforestière, et les sols, ainsi que le stockage de carbone des pratiques selon les sols. Le chercheur a découvert que les espèces Acacia raddiana et Faidherbia albida ainsi que la pratique de la jachère accumulaient plus de carbone, et ce, peu importe le type de sol.
En observant les traits fonctionnels des espèces, il a ensuite dégagé une tendance. « En saison sèche, la longueur spécifique des racines était beaucoup plus importante qu’en saison des pluies », raconte M. Marone. Les nutriments du sol deviennent plus rares, et les racines ont tendance à aller prospecter plus loin pour trouver des nutriments.

Une jachère dans les Niayes
Finalement, le chercheur a étudié la distribution en profondeur des racines (RDD) pour chaque espèce, toujours selon la pratique agroforestière et le type de sol. « Ce sont Acacia radionna et Neocarya macrophylla, qui ne perdent pas leurs feuilles, qui développent le plus de biomasse racinaire et ce, entre 40 et 60 cm de profondeur », explique-t-il. « Le stockage de carbone doit être plus important à cette profondeur. Cependant, j’ai fait une nouvelle découverte concernant Faidherbia (albida) », s’enthousiasme le chercheur. Il a observé que la RDD augmente avec la profondeur chez cet arbre. Pourquoi? « En faisant des recherches dans la documentation, j’ai réalisé que cette espèce cherche à atteindre les nappes phréatiques, et ce, peu importe leur profondeur », explique M. Marone. Il admet qu’il devra faire plus de recherche pour mieux comprendre ce comportement.
Vers une optimisation de l’agroforesterie dans les Niayes?
Selon Diatta Marone, ses travaux pourront éventuellement servir aux populations locales de son pays. « Comme la jachère stocke le plus de carbone et que Acacia raddiana et Faidherbia albida aussi, leur combinaison pourrait permettre de mieux contrer la dégradation des sols », souligne-t-il. « Dans mon schéma, on pourrait envisager des jachères de 5 ans. D’habitude, une jachère c’est au moins 15 ans », conclut Diatta Marone.
11 juin 2014
Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir assister aux séminaires d'étudiants en sciences forestières et en agroforesterie. Voici donc le cinquième de six articles.

Haie brise-vent protégeant un animal en pâturage à La Pocatière
Haies brise-vent: une amère prime verte?
Texte par Myriam Laplante El Haili et photo par Prince Willaire Kanga
La solution qu’a trouvée le gouvernement pour réparer les désastres environnementaux causés par l’agriculture intensive depuis les 50 dernières années au Québec risque de fonctionner, mais aux dépens des agriculteurs.
Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), l’agriculture émet 8% des gaz à effet de serre du Québec. Le gouvernement a mis en place en 2009 des programmes dits agroenvironnementaux pour diffuser et promouvoir auprès des agriculteurs des pratiques de production respectueuses de l’environnement. Avec le programme Prime-Vert, le MAPAQ offre gratuitement des arbres aux agriculteurs et finance à 70% les coûts liés à la plantation de haies brise-vent et bandes riveraines. En théorie le programme aide bel et bien les agriculteurs, mais concrètement, que donnent ces nouveaux aménagements?
C’est ce qu’est allé évaluer l’étudiant chercheur en agroforesterie, Prince Willaire Kanga de l’Université Laval, dans la région de La Pocatière dans le Bas-St-Laurent. En trois mois de stage chez Biopterre, un OBNL spécialisé dans le développement de produits issus de l’agriculture et de l’agroforesterie, M. Kanga a interviewé 23 agriculteurs. Il a ainsi pu amasser des données socio-économiques, telles que le niveau de scolarité des agriculteurs ou le nombre d’enfants qu’ils ont, afin d’évaluer si ces facteurs influencent la décision d’adopter ou non des haies brise-vent et des bandes riveraines sur leurs terres.
Haies brise-vent et bandes riveraines: à quoi servent-elles?
On a tous déjà vu des haies brise-vent et bandes riveraines en ville comme à la campagne. Elles sont constituées d’arbres alignés qui entourent un champ, qui bordent une route ou qui cernent les pâturages afin de les protéger du vent, du sable et de la poussière. Les bandes riveraines, ceintures de végétation qui bordent un plan d’eau, retiennent et dégradent les pesticides et engrais qui polluent l’eau et l’atmosphère. Ces deux systèmes agroforestiers offrent de nombreux avantages: protéger la biodiversité, améliorer la qualité de l’eau et stabiliser les berges. Mais ce n’est pas tout.
Avantages pour l’environnement
Au terme de son stage, M. Kanga a pu constater la popularité de ces systèmes dans le Bas-St-Laurent. Les agriculteurs adoptent effectivement les haies brise-vent et les bandes riveraines quand ils reçoivent du financement parce qu’elles permettent l’augmentation de la production végétale et animale.
En effet, les arbres des haies et des bandes participent au maintien d’un écosystème. Par exemple, comme l’explique M. Kanga, « certains agriculteurs plantent des arbres qui attireront les abeilles pour avoir une meilleure pollinisation».
Les haies servent également aux animaux d’élevage, car elles peuvent être source de nourriture et créer un microclimat: elles procurent de l’ombre quand il fait trop chaud ou un refuge lorsqu’il vente beaucoup. Indirectement, les haies augmentent les rendements de production de viande et de lait.
Prince Willaire Kanga explique que les haies sont mêmes utiles à l’Homme puisqu’une ligne d’arbres devant sa maison permet de protéger non seulement la toiture de vents violents, mais également d’isoler la maison contre le froid et d’économiser sur les coûts de chauffage. Elles ont également un impact sur le bien-être psychologique des habitants de la région. M. Kanga rajoute que « les agriculteurs interviewés de La Pocatière sont d’ailleurs satisfaits de ces installations ».
Les difficultés des producteurs
M. Kanga a également pu se rendre compte des difficultés que pose le programme. D’abord, pour pouvoir accéder aux subventions, les producteurs doivent remplir ce qu’on appelle des écoconditionnalités. Par exemple, ils doivent souscrire au Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA), qui les aide à poursuivre leurs avancées « vertes » et à les mettre en action. Néanmoins, ils se plaignent de la quantité de paperasse et du temps perdu à la remplir. D’ailleurs, le manque de temps, mais également d’argent, sont les deux contraintes qui semblent revenir le plus souvent.
Dépendamment du nombre d'arbres sur sa parcelle de terre, un producteur dépensera en moyenne 200 à 300$ par deux ans pour entretenir les arbres de la haie, en plus de devenir une charge supplémentaire dans le calendrier des agriculteurs déjà bien rempli. Il faut prévoir l’élagage des arbres, le désherbage, la protection contre les ravageurs et le remplacement de plants que l’agriculteur devra payer de sa poche. Les mieux nantis engageront une équipe d’entretien pour ne pas avoir à s’en occuper, mais le temps à y consacrer est long pour ceux qui ne peuvent se permettre un tel luxe.
Pour M. Kanga, il faudra terminer le traitement des données amassées à La Pocatière, afin de dresser un portrait exhaustif de la situation. Il pourra ainsi confirmer la tendance que le programme de subvention gouvernemental est efficace puisque les agriculteurs l’adoptent. Les haies brise-vent et les bandes riveraines feront parties intégrantes du paysage québécois dans les prochaines années.
5 juin 2014
Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir assister aux séminaires d'étudiants en sciences forestières et en agroforesterie. Voici donc le quatrième de six articles.
La génétique contre la tordeuse du bourgeon de l’épinette
Texte par Maxime Giroux
Entre 2011 et 2012, la superficie des forêts québécoises affectée par la tordeuse du bourgeon de l’épinette a augmenté de plus de 35 %. La solution à ce fléau pourrait se trouver dans les gènes des arbres attaqués.
Lorsqu’ils font face à une maladie qui fait des ravages, la priorité des chercheurs est de l’étudier pour développer un traitement ou un médicament. Et si la solution existait déjà dans la nature et qu’il suffisait de l’exploiter? Gaby Germanos, étudiant-chercheur à la maîtrise en foresterie à l’Université Laval, a suivi cette approche dans ses recherches sur un gène qui permettrait à l’épinette blanche de résister à la tordeuse, un insecte qui ravage les forêts nord-américaines.
Dans les plantations d’épinettes victimes de la tordeuse, les chercheurs ont observé des arbres ayant perdu très peu d’aiguilles comparativement aux autres, un signe qu’ils ont résisté à l’insecte. L’équipe d’Éric Bauce du Département des Sciences du Bois et de la Forêt à Université Laval a étudié cette résistance. Elle est provoquée par deux composés phénoliques, des molécules organiques présentes dans les aiguilles et qui permettent à l’arbre de se défendre. « Ces composés attaquent et endommagent le système digestif des tordeuses lorsque celles-ci les ingèrent », précise M. Germanos.
Un autre groupe mené par John MacKay de l’Université Laval a produit une puce à ADN qui a permis de détailler l’expression de 23 853 gènes de l’épinette blanche. Grâce à elle, les chercheurs ont identifié un gène de la famille β-glucosidase 40, qui s’exprime 773 fois plus dans les arbres résistants que les autres.
Dans son projet intitulé «Caractérisation d’un gène de résistance contre la tordeuse du bourgeon de l’épinette chez l’épinette blanche», Gaby Germanos s’est penché sur la séquence d’ADN de ce gène, les changements de son expression (voir encadré) durant l’année et la transmissibilité du gène aux jeunes arbres.
Pour étudier la structure du gène, M. Germanos a récolté des aiguilles sur 16 épinettes blanches âgées de 43 ans dans la plantation de Sainte-Cyrille-de-Wendover, près de Drummondville. Ces arbres ont subi une épidémie de la tordeuse entre 2000 et 2006, et la moitié des spécimens échantillonnés a résisté à cette attaque. Après avoir broyé les aiguilles pour extraire l’ARN (voir encadré), il a fait une transcription inverse pour obtenir de l’ADN complémentaire. Cet ADN complémentaire lui a ensuite permis d’obtenir par un processus subséquent de l’ADN génomique, c’est-à-dire celui que l’on retrouve dans les cellules. Sachant que le gène est présent dans toutes les épinettes blanches, l’objectif était de chercher une différence dans sa structure chez les arbres résistants.
ADN complémentaire: molécule synthétisée artificiellement à partir de l’ARN et représentant l’ADN duquel l’ARN est issu
ARN: molécule synthétisée dans les cellules à partir de l’ADN et permettant entre autres de produire des protéines
Expression d’un gène: l’ensemble des processus par lesquels l’information contenue dans le gène est utilisée pour produire des molécules comme l’ARN ou les protéines
Séquence promotrice: région de l’ADN située à proximité d’un gène et servant à la transcription de l’ADN en ARN
Transcription: processus biologique durant lequel les diverses régions de l’ADN sont copiées en molécules d’ARN
« Il n’a pas été possible de différencier les arbres résistants des autres en se basant sur la séquence codante », explique M. Germanos. La séquence codante est la partie du gène mobilisée pour synthétiser des protéines. Le gène β-glucosidase 40 donne la protéine impliquée dans la production de composés phénoliques. « On peut chercher ailleurs dans le gène », propose M. Germanos. « La différence se situe peut-être dans la séquence promotrice, en amont du gène. »
M. Germanos s’est aussi intéressé aux fluctuations saisonnières de l’expression du gène. Il a effectué sept prélèvements d’aiguilles tout au long de l’année sur 10 arbres de la plantation de Drummondville, dont cinq résistants. L’étude des transcrits des aiguilles, qui sont un indicateur du niveau d’expression des gènes, a permis d’établir une corrélation entre ce niveau d’expression et le cycle de vie de la tordeuse.
Pour étudier la transmissibilité du gène, M. Germanos a travaillé avec des graines (120 à 200 par arbre) récoltées en 2011 sur 8 arbres de la plantation, dont quatre résistants. Il a ensuite planté ces graines en juin 2012. Vers la mi-décembre de la même année, il a récolté une branche par semis afin d’en extraire l’ARN, comme il l’avait fait pour les arbres matures. Pour trois arbres-mères résistants sur quatre, le gène était plus exprimé chez leurs semis que chez les semis des arbres-mères non-résistants. « Le gène était en moyenne 18 fois plus exprimé, ce qui est moins que chez les arbres adultes », précise M. Germanos. « La tordeuse s’attaque principalement aux arbres matures », soumet-il comme explication. La régulation de l’expression du gène se transmet donc au moins en partie à la progéniture. « Il serait intéressant de connaître les caractéristiques des arbres-pères afin de mieux comprendre la transmissibilité du gène », explique M. Germanos.
Le chercheur a bon espoir que le gène pourra être utilisé pour lutter contre la tordeuse. Par contre, ses applications commerciales ne sont pas pour demain. « Il s’agit davantage de recherche exploratoire », explique l’étudiant-chercheur. D’autres gènes de l’épinette pourraient aussi jouer un rôle dans la résistance à la tordeuse.
29 mai 2014
Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir assister aux séminaires d'étudiants en sciences forestières et en agroforesterie. Voici donc le troisième de six articles.

Paysage de la mine Sigma Lamaque
Une «technologie verte» pour restaurer les sites miniers?
Texte par Lou Sauvajon et photos par Martin Beaudoin Nadeau et Lou Sauvajon
Pour extraire l’or, l’industrie minière laisse des traces souvent problématiques pour l’environnement. Un étudiant en agroforesterie à l’Université Laval écrit son mémoire sur une technique pour restaurer les sites miniers dégradés.
Pour fabriquer une bague en or, on estime que 20 tonnes de déchets sont rejetées. Dans le passé, une partie des résidus a souvent été laissée à l’abandon sur les sites miniers. Depuis 2009 au Québec, les entreprises minières sont obligées de restaurer les sites dégradés. Nettoyer et replanter de la végétation, c’est justement ce qu’étudie Martin Beaudoin Nadeau dans sa maîtrise en agroforesterie à l’Université Laval. Selon lui, faire interagir les plantes et les champignons dans ces milieux hostiles permettrait de favoriser la végétalisation des sites miniers.

Petit plant d’épinette blanche poussant sur des résidus miniers
Un milieu peu propice à la vie
La mine Sigma Lamaque à Val d’ Or est devenue le terrain de recherche de Martin Beaudoin Nadeau depuis que la compagnie White Tiger Gold a fermé le site en 2012. L’entreprise doit restaurer 150 hectares de terres quasi désertiques. Dans cette mine, la roche extraite du sol était traitée au cyanure pour séparer l’or. Les résidus obtenus transitaient par des bassins en attendant leur décontamination; ils étaient ensuite entassés sur le terrain. Aujourd’hui, la mine présente des collines de roches à perte de vue où la végétation peine à pousser.
C’est sur ce paysage lunaire que Martin Beaudoin Nadeau fait des recherches pour son mémoire de maitrise. Dans des sols appauvris comme celui-ci, les plantes peinent à trouver les éléments nutritifs nécessaires à leur survie. Une des rares plantes persistantes est l’épinette blanche. Pourquoi? Martin Beaudoin Nadeau pense que cette espèce réussit à pousser et à survivre en coopérant avec certains champignons.

Vue microscopique d’une ectomycorhize: symbiose de l’épinette blanche avec un champignon
Coopérer pour que la vie prenne racine
D’où l’idée, pour le chercheur, de se servir de ce processus naturel de symbiose pour faciliter la végétalisation du site. La symbiose c’est une association intime et durable de deux organismes qui en retirent chacun des bénéfices explique Martin Beaudoin Nadeau.
«Les champignons pénètrent les racines et entourent les cellules végétales», précise Yves Piché, professeur en mycologie à l’Université Laval. Cette proximité permet aux organismes de faire des échanges. L’association est appelée ectomycorhize: «myco» qui veut dire champignon, «rhize» pour racine. Le champignon devient en quelque sorte le prolongement du réseau de racines. Il puise des éléments nutritifs présents dans le sol, mais peu accessibles à la plante. «Les filaments des champignons vont chercher les minéraux dans la roche et l’eau du sol, puis les transfèrent aux racines. L’arbre de son côté tire l’énergie du soleil et la transforme en sucres, par photosynthèse», explique Martin Beaudoin Nadeau. Ces sucres sont une source d’énergie pour la plante et profitent également aux champignons. Les deux espèces s’entretiennent et se nourrissent.

Expériences sous serre
Un modèle avantageux pour l’environnement
Dans le but de développer une nouvelle «technologie verte», Martin Beaudoin Nadeau a prélevé des champignons sur place et fait des expériences sous serre. Il cherche à sélectionner les champignons qui seraient les plus bénéfiques à la croissance de l’épinette blanche. Actuellement en train d’analyser les résultats obtenus, il espère trouver une association qui aiderait les arbres à pousser et pourrait accélérer la recolonisation du site.
La technique la plus couramment utilisée pour la revégétalisation des sols miniers (aujourd’hui au Canada) consiste à recouvrir les résidus avec un sol riche en minéraux, puis de réintroduire des plantes. Martin Beaudoin Nadeau propose de replanter des épinettes blanches en symbiose directement sur les résidus.
Cette technique permettrait de reconstituer le sol de manière plus naturelle. Par exemple, lorsque les aiguilles tombent, cela apporte de la matière organique au sol. Cette matière organique est ensuite recyclée par les organismes du sol pour former des minéraux. Le sol s’enrichit ainsi progressivement sans apports extérieurs. D’autres espèces végétales pourront pousser par la suite, reconstituant ainsi l’ensemble de l’écosystème.
«C’est une technologie verte qui imite les procédés naturels pour essayer de ramener un écosystème comme il était auparavant», explique Martin Beaudoin Nadeau. D’après lui cette technologie, non seulement plus rapide et plus respectueuse de l’environnement, pourrait également diminuer les coûts de restauration des sites miniers. Ces avantages sont susceptibles d’intéresser les compagnies minières, mais également le gouvernement québécois. Ce dernier est responsable d’une soixantaine de sites orphelins abandonnés par l’industrie avant les réformes minières de 2009 et de 2013. Le coût de leur restauration est estimé à 1,2 milliard de dollars, aux frais des contribuables.
21 mai 2014
Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir assister aux séminaires d'étudiants en sciences forestières et en agroforesterie. Voici donc le deuxième de six articles.
Épinettes à déménager
Texte par Dominique Brunet-Vaudrin
Les chercheurs prévoient que d’ici 2100, les épinettes blanches dépériront dans 20 % du territoire où on les retrouve aujourd’hui. La hausse de température annoncée, de 2 à 5 degrés Celsius, en serait la cause. Les épinettes auront littéralement trop chaud.
Les épinettes blanches migrent pour fuir des conditions défavorables à leur survie depuis des millénaires. Même s’il est difficile d’imaginer ces grands conifères aux aiguilles odorantes se déplacer, le procédé ne relève pas de la science-fiction! L’espèce disperse les graines contenues dans ses cocottes un peu plus au nord chaque année pour se rapprocher d’un climat propice à sa croissance. Mais ce déplacement est lent. « Les changements climatiques surviennent trop rapidement pour que les épinettes blanches s’adaptent », explique Isabelle Villeneuve, étudiante à la maîtrise en foresterie à l’Université Laval.
« L’épinette blanche a une grande importance dans le domaine de la foresterie au Québec », souligne la chercheuse. Elle compte pour 21 % des arbres utilisés pour reboiser les zones d’exploitation forestière. Considérée comme une essence de qualité, elle est très prisée pour la fabrication de pâte à papier et de bois d’œuvre. L’adaptation de l’épinette blanche aux changements climatiques, en plus d’être un problème écologique, représente donc un enjeu économique de taille. La migration assistée de l’espèce semble une stratégie potentielle pour pallier cette situation.
Cette technique consiste à déplacer les populations d’arbres vers un endroit où le climat deviendra probablement plus favorable à leur productivité. Des semences d’une région précise sont plantées en pépinières et entretenues dans des conditions optimales pendant au moins deux ans afin de produire des plants en santé. Les conifères sont ensuite transférés en forêt dans un environnement possiblement plus adapté à leur survie que celui dont ils proviennent.

25 000 plants d’épinettes ont été produits pour l’étude d’Isabelle Villeneuve sur la migration assistée. Elle en a analysés des centaines sur une période de deux ans.
Pour augmenter les chances de réussite, il faut s’assurer de choisir les meilleures semences. Selon la chercheuse, celles qui proviennent du sud du Québec semblent un choix judicieux. Elle a analysé des centaines de plants provenant de huit sources génétiques différentes pour conclure que les semences méridionales affichaient une croissance d’au moins 6 % supérieure à celle des autres régions après deux ans de croissance. « Utiliser les semences du sud pour reboiser les zones au nord de la province pourrait permettre un bon taux de survie et une bonne performance des plants déplacés », soutient la chercheuse. « Les conditions futures des régions nordiques risquent de correspondre à celles du sud. Ainsi, les plants déplacés croîtront dans des conditions idéales », ajoute-t-elle.
Pour vérifier cette hypothèse, la chercheuse a suivi l’évolution des plants pendant deux ans. Toutes les deux semaines, elle a mesuré des plants en prenant notamment leur hauteur, leur masse et leur diamètre pour établir des courbes de croissance et repérer les semences les plus performantes. Son projet est la première étape d’une expérience sur le terrain qui durera plusieurs années.
La migration assistée soulève bon nombre de débats. Les individus qui s’opposent au procédé, surtout des écologistes, soulignent l’importance de respecter l’état actuel des écosystèmes. Ils craignent des croisements néfastes entre les espèces migrées et celles déjà établies, ce qui augmenterait le risque de maladies. Au contraire, la plupart des chercheurs en foresterie perçoivent la migration assistée comme une solution potentielle pour contrer les impacts des changements climatiques. « Elle permet de maintenir, voire d’augmenter, la productivité de certaines essences. Il s’agit d’un processus contesté, mais bénéfique pour l’industrie forestière et pour l’environnement », croit la chercheuse. « Effectuer des essais maintenant est nécessaire pour évaluer le potentiel à long terme de cette approche », ajoute-t-elle.
Des chercheurs font actuellement des tests de migration assistée sur d’autres essences comme celles de l’épinette noire et du pin gris, respectivement les première et deuxième espèces les plus exploitées au Québec. Pour le moment, les essais préliminaires semblent concluants, mais des analyses sont toujours en cours afin d’évaluer le rendement des plants à long terme.
« Comme notre objectif est de déplacer des populations d’épinettes blanches vers une région où cette espèce existe déjà, un processus propre à la migration assistée, le risque de conséquences est relativement faible », conclut Isabelle Villeneuve. Cette technique diffère de la migration assistée sur de longues distances qui introduit une espèce dans un milieu où elle était absente à l’origine. Le déplacement des essences à l’extérieur de leur milieu naturel de vie comporte des risques plus élevés.
8 mai 2014
Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir assister aux séminaires d'étudiants en sciences forestières et en agroforesterie. Voici donc le premier de six articles.
Protéger l'agriculture avec des arbres, une pratique d'avenir pour le Québec?
Texte par Cécile Vivant
Associer l'arbre aux cultures vivrières pour préserver l'environnement , voilà ce que les agriculteurs québécois feront demain. À condition que le gouvernement de la province suive les recommandations des chercheurs.
Définition de l'agroforesterie
Selon le MAPAQ, l'agroforesterie se définit comme « un système intégré de gestion des ressources du territoire rural qui repose sur l’association intentionnelle d’arbres ou d’arbustes à des cultures ou à des élevages, et dont l’interaction permet de générer des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux »
En Gaspésie, l'agriculture est en perte de vitesse. Le climat est rude, le vent souffle fort, et l'équipement de production coûte cher! Planter des haies brise-vent pour augmenter le rendement des cultures vivrières ![]() , c'est ce que l'agroforesterie tente d'appliquer dans cette région du Québec. Écologique, durable et maîtresse du maintien de la sécurité alimentaire, les méthodes agroforestières se développent petit à petit au Québec. Les politiques québécoises sont-elles appropriées à cette pratique prometteuse? Pas assez, à en croire les recherches de Geneviève Laroche, doctorante en agroforesterie à l'Université Laval. D'autant plus que l'on a longtemps séparé les cultures forestières des cultures agricoles.
, c'est ce que l'agroforesterie tente d'appliquer dans cette région du Québec. Écologique, durable et maîtresse du maintien de la sécurité alimentaire, les méthodes agroforestières se développent petit à petit au Québec. Les politiques québécoises sont-elles appropriées à cette pratique prometteuse? Pas assez, à en croire les recherches de Geneviève Laroche, doctorante en agroforesterie à l'Université Laval. D'autant plus que l'on a longtemps séparé les cultures forestières des cultures agricoles.

Types de haies brise-vent implantées au Québec.
(Ménard, 2012)
L'agroforesterie au Québec
Depuis plus de 30 ans en Amérique du Nord, les bienfaits de l'agroforesterie sont prouvés. « Au Québec, certains systèmes agroforestiers sont très développés, d'autres très peu ». Le constat de Geneviève Laroche sur le développement de l'agroforesterie au Québec reste mitigé. Pour la chercheuse, la plantation d'arbres dans les milieux agricoles est perçue par les Québécois comme un « choc culturel ». Selon elle, les politiques de la province influencent aussi les pratiques des agriculteurs.
Au Québec, les haies brise-vent - des bandes d'arbres plantés en bordure des champs- ou encore les bandes riveraines, restent les techniques agroforestières les plus développées. Ces techniques permettent de limiter les impacts de l'agriculture sur l'environnement. Par exemple, les haies brise-vent plantées à côté de cultures légumières protègent les plantations des vents forts. Leur feuillage peut servir d'ombrage pour les animaux. Grâce à leurs racines, les haies captent l'azote, le principal engrais utilisé par les agriculteurs, et remplacent ainsi certains intrants chimiques comme les fertilisants.
Les premières recherches en agroforesterie
C'est au Canada que des chercheurs ont fait les premières expérimentations pour connaître les bienfaits de l'agroforesterie sur l'agriculture. En 1971, le chercheur Joseph H. Hulse, du Centre de recherche pour le développement international canadien, formule pour la première fois, le terme agroforesterie, mais il s'agit d'une pratique culturale ancestrale très développée dans les milieux tropicaux et subtropicaux comme en Afrique.
« Ces systèmes efficaces sont abondamment financés par le ministère de l'Agriculture », explique Geneviève Laroche. Par exemple, le programme Prime-vert est en vigueur depuis 2009. Ce programme lancé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), encourage les agriculteurs québécois à planter et entretenir des haies brise-vent dans leurs champs agricoles. Le MAPAQ finance 70 % de l'implantation de ces haies. La hauteur de ce financement est exceptionnelle. Pour la plupart des autres pratiques agroforestières, la réalité est bien différente.
Par exemple, les cultures intercalaires n'existent presque pas au Québec. Pourtant, cette pratique qui consiste à planter des arbres au milieu des cultures agricoles a prouvé son efficacité. Le Laboratoire rural d'agroforesterie et paysages -financé par ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec- a permis d'expérimenter la valeur ajoutée de cette technique. Dans le cadre de cette expérience, Sara Savoie, chercheuse au département d'agroforesterie de l'Université Laval, a observé que les cultures intercalaires permettaient d'améliorer les sols, les rendements et plus largement, tout l'écosystème gaspésien. Ce n'est pas négligeable sur le rude territoire de la Gaspésie. Si ces pratiques sont bénéfiques pour l'environnement, pourquoi sont-elles peu exploitées à l'échelle provinciale?

Exemple de bandes riveraines en bord de rivière au Québec. (OBV Yamaska, 2012)
Des projets politiques en contradiction « Les agriculteurs québécois ont vu leurs ancêtres lutter contre la forêt pour être capables de cultiver les terres », rappelle Geneviève Laroche. Selon la chercheuse, même si ces pratiques sont productives, viables et pourraient être rentables, elles ne correspondent pas aux conceptions traditionnelles de l'agriculture.
Longtemps séparée de la forêt, l'agriculture est encore considérée comme une pratique à part. « La plupart des lois et politiques freinent le développement de l'agroforesterie », selon Geneviève Laroche. Historiquement, « la foresterie s'est surtout développée en zone boréale – où les arbres résistaient au froid- avec des entreprises privées qui ont pris à peu près possession de la forêt publique. Puis l'agriculture s'est développée dans les villages pour subvenir aux besoins de la population ». Ces deux contextes ont mené à deux structures différentes: le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le MAPAQ. L'agriculture était faite pour se nourrir et la forêt pour le bois, « ce qui fait en sorte qu'on a des programmes en agriculture qui pourraient permettre la diversification, mais qui empêchent en même temps la plantation d'arbres sur les parcelles », ajoute la chercheuse.
Les difficultés du gouvernement québécois pour légiférer sont aussi une question de temps! Financer des produits chimiques efficaces à court terme reste une solution de facilité pour les ministères impliqués selon Geneviève Laroche. L'agroforesterie ne prouve, quant à elle, qu'une efficacité à long terme. Les résultats positifs de cette pratique sont donc difficilement mesurables. « C'est tout un changement de mentalités qui est en train de s'opérer petit à petit », ajoute-t-elle.
3 avril 2014
La CEFoshère en bref
Les terres du séminaire, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eric Alvarez vous dresse un portrait du type d’aménagement ![]() qui se pratique sur ce territoire géré par le « Séminaire de Québec » depuis 350 ans.
qui se pratique sur ce territoire géré par le « Séminaire de Québec » depuis 350 ans.
Si vous voulez en savoir plus sur les araignées, lisez le billet de Christopher Buddle qui dresse une bibliographie des références essentielles ![]() les concernant. Dans un autre billet
les concernant. Dans un autre billet ![]() , vous apprendrez comment deux araignées néotropicales utilisent des glandes situées sur leurs pattes pour répandre des sécrétions dans l’environnement. Vous pourrez aussi lire sur son blogue dix faits intéressants sur les caracaras à gorge rouge
, vous apprendrez comment deux araignées néotropicales utilisent des glandes situées sur leurs pattes pour répandre des sécrétions dans l’environnement. Vous pourrez aussi lire sur son blogue dix faits intéressants sur les caracaras à gorge rouge ![]() et sur les pseudoscorpions
et sur les pseudoscorpions ![]() .
.
André Desrochers fait un éloge du doute ![]() en revenant sur les changements climatiques, un sujet où le consensus scientifique semble être établi. Son billet vous fera-t-il réagir?
en revenant sur les changements climatiques, un sujet où le consensus scientifique semble être établi. Son billet vous fera-t-il réagir?
24 mars 2014
Publication du GIEC: guide pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre des terres humides
2013 Supplement to the 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands (Wetlands Supplement)
Texte et photo par David Paré

À quelques semaines de la finalisation du Rapport (AR5-groupe III) du GIEC sur l’atténuation des changements climatiques (prévue du 7-11 avril 2014), le rapport spécial du GIEC sur les terres humides (WETLANDS) ![]() est maintenant disponible.
est maintenant disponible.
Ce rapport vient combler des lacunes identifiées par le GIEC et le besoin d’une mise à jour pour l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de l’aménagement des terres humides et des sols organiques. Les résultats produits seront utilisés dans les inventaires nationaux de GES de même que par le AR5. Entre autre, les facteurs de niveau I (facteurs à utiliser par défaut lors des inventaires nationaux de GES) des émissions de GES lors du drainage ont été révisés. Des estimés ont aussi été produits pour les émissions lors d’incendies des sols organiques drainés et non drainé ainsi que pour les émissions de méthane et de carbone organique dissous dans les eaux de drainage.
Les facteurs qui auront sans doute le plus d’impact sont ceux qui concernent les émissions en provenance du drainage de tourbières tropicales. Le drainage, suivi de plantations de palmiers à huile et de plantations à courte rotation comme l’acacia donne des facteurs d’émissions de CO2 de 11 et 20 tonnes CO2-C ha-1 a-1. Ces facteurs permettent de mieux quantifier l’impact environnemental de ces productions qui font l’objet d’un important commerce mondial. À titre de comparaison, le drainage en milieu boréal donne des facteurs qui vont de 0,25 à 0,93 tonnes CO2-C ha-1 a-1. Les incertitudes demeurent élevées dans presque tous les cas. Il est intéressant de noter que l’intervalle de confiance à 95% pour le drainage des tourbières forestières boréales pauvres (oligotrophes) comprend des valeurs négatives. Ceci indique que sur certains de ces sols, le drainage peut augmenter les stocks de carbone du sol, le drainage stimulant la productivité qui vient plus que compenser l’augmentation des pertes par décomposition.
David Paré (CEF) a participé comme éditeur du chapitre 2 portant sur le drainage et comme Lead Author d’un groupe spécial sur les tourbières tropicales. À gauche sur la photo avec un groupe de spécialistes des sols lors d’une rencontre du GIEC à Manaus, Brésil. Terra Preta: un sol d’une fertilité exceptionnelle (couche foncée) fabriqué par l’homme en période précolombienne, il y a près de 2000 ans et qui a donné l’inspiration pour les travaux sur le Bio Char. Les mécanismes de formation de ces sols sont encore mal compris.
20 mars 2014
La CEFoshère en bref
Saviez-vous qu’hier était la journée de reconnaissance des taxonomistes? Christopher Buddle en profite pour vous inciter à devenir taxonomiste amateur ![]() . Dans un autre billet, il vous partage sa vision de ce qu’est un naturaliste
. Dans un autre billet, il vous partage sa vision de ce qu’est un naturaliste ![]() . Vous pourrez aussi découvrir sur son blogue dix faits intéressants sur les triops
. Vous pourrez aussi découvrir sur son blogue dix faits intéressants sur les triops ![]() et sur les collemboles
et sur les collemboles ![]() . Enfin, sur le site Arthropod Ecology, il félicite Raphaël Royauté
. Enfin, sur le site Arthropod Ecology, il félicite Raphaël Royauté ![]() qui a défendu sa thèse avec succès. La thèse de Raphaël s’intitule: Factors influencing behavioural variation in apple orchard populations of the jumping spider Eris militaris (Araneae: Salticidae).
qui a défendu sa thèse avec succès. La thèse de Raphaël s’intitule: Factors influencing behavioural variation in apple orchard populations of the jumping spider Eris militaris (Araneae: Salticidae).
Eric Alvarez nous présente une synthèse d’un colloque sur tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) ![]() qui a eu lieu en février. Il en profite pour souligner à quel point le monde forestier souffre d’amnésie générationnelle. Les anciens gestionnaires forestiers, qui ont vécu l’épidémie de tordeuse des années 50, pourraient transférer leurs connaissances, mais les structures en place ne leur permettent pas.
qui a eu lieu en février. Il en profite pour souligner à quel point le monde forestier souffre d’amnésie générationnelle. Les anciens gestionnaires forestiers, qui ont vécu l’épidémie de tordeuse des années 50, pourraient transférer leurs connaissances, mais les structures en place ne leur permettent pas.
6 mars 2014
La CEFoshère en bref
Pourquoi devriez-vous vous réjouir de produire du pétrole dans votre cour? ![]() André Desrochers répond à cette question controversée sur son blogue. Comme si les chevreuils de l’île d’Anticosti l’avaient inspiré, le billet suivant concerne la possibilité de servir du gibier sauvage dans les restaurants du Québec.
André Desrochers répond à cette question controversée sur son blogue. Comme si les chevreuils de l’île d’Anticosti l’avaient inspiré, le billet suivant concerne la possibilité de servir du gibier sauvage dans les restaurants du Québec. ![]()
Véronique Yelle poursuit sa chronique sur l’acceptabilité sociale dans le blogue la forêt à cœur. Elle discute cette fois des groupes à prendre en considération dans l’acceptabilité sociale. ![]() Eric Alvarez aborde justement un cas où l’acceptabilité sociale n’a pas été bien prise en compte: le dossier du mont Kaaikop.
Eric Alvarez aborde justement un cas où l’acceptabilité sociale n’a pas été bien prise en compte: le dossier du mont Kaaikop. ![]()
Vous avez du mal à gérer vos courriels? Lisez les trucs de Christopher Buddle qui réussit à la fin de chaque journée à avoir une boîte de réception vide. ![]() Christopher présente aussi une interview avec une Emma Sayer qui a eu l’idée originale d’intégrer la science aux festivals de musique.
Christopher présente aussi une interview avec une Emma Sayer qui a eu l’idée originale d’intégrer la science aux festivals de musique. ![]() À quand un kiosque du CEF au Festival de Jazz de Montréal ou au Festival d’été de Québec? Dans un autre billet, il vous encourage à regarder une vidéo qui explique les services écologiques rendus par les insectes.
À quand un kiosque du CEF au Festival de Jazz de Montréal ou au Festival d’été de Québec? Dans un autre billet, il vous encourage à regarder une vidéo qui explique les services écologiques rendus par les insectes. ![]() Êtes-vous en train de préparer une demande de subvention?
Êtes-vous en train de préparer une demande de subvention? ![]() Peut-être ressentez-vous les mêmes émotions que Christopher qui les décrit d’une belle façon. En lisant son blogue, vous apprendrez également comment les araignées sauteuses sélectionnent leurs aliments
Peut-être ressentez-vous les mêmes émotions que Christopher qui les décrit d’une belle façon. En lisant son blogue, vous apprendrez également comment les araignées sauteuses sélectionnent leurs aliments ![]() en se basant sur la couleur. Christopher vous a livré son dernier segment
en se basant sur la couleur. Christopher vous a livré son dernier segment ![]() sur l’actualité artropodologique. Cette chronique est désormais remplacée par la chronique Ten facts. Vous pouvez lire dix informations intéressantes sur la guêpe parasitoïde
sur l’actualité artropodologique. Cette chronique est désormais remplacée par la chronique Ten facts. Vous pouvez lire dix informations intéressantes sur la guêpe parasitoïde ![]() et des papillons de la famille des Hesperiinae
et des papillons de la famille des Hesperiinae ![]() .
.
11 février 2014
La CEFoshère en bref
Si vous êtes de ceux qui pensent encore que l’industrie forestière règne en maître sur la forêt québécoise, détrompez-vous. Eric Alvarez montre comment la FSC est maintenant le parrain de l’aménagement des forêts du Québec ![]() . Il cède ensuite la parole à Véronique Yelle qui vous explique le concept d’acceptabilité sociale
. Il cède ensuite la parole à Véronique Yelle qui vous explique le concept d’acceptabilité sociale ![]() dans la première partie de deux chroniques.
dans la première partie de deux chroniques.
Hésitez-vous à débuter un blogue? Lisez le billet de Christopher Buddle qui vous explique comment bloguer pourrait améliorer votre productivité en recherches ![]() . Il amorce également une nouvelle série de billets intitulés Ten facts qui présentera 10 informations intéressantes à propos d’une espèce ou d'un groupe d’espèces. Pour commencer la série: les araignées-loups
. Il amorce également une nouvelle série de billets intitulés Ten facts qui présentera 10 informations intéressantes à propos d’une espèce ou d'un groupe d’espèces. Pour commencer la série: les araignées-loups ![]() . Comme toujours, vous trouverez les dernières actualités arthropodologique dans les segments 10
. Comme toujours, vous trouverez les dernières actualités arthropodologique dans les segments 10 ![]() et 11
et 11 ![]() . Sur son autre plateforme, Christopher vous explique pourquoi les courriels devraient être exempts d'erreurs
. Sur son autre plateforme, Christopher vous explique pourquoi les courriels devraient être exempts d'erreurs ![]() .
.
André Desrochers démystifie pour vous le fameux seuil de 12% d’aires protégées ![]() souvent évoqué comme objectif minimal à atteindre pour un territoire. Il termine son billet avec un vœu noble: une saine gestion du territoire à 100%.
souvent évoqué comme objectif minimal à atteindre pour un territoire. Il termine son billet avec un vœu noble: une saine gestion du territoire à 100%.
28 janvier 2014
La CEFoshère en bref
Catherine Potvin vous offre une dernière vidéo ![]() en lien avec son pari de produire deux vidéos par semaine pendant un an sur les changements climatiques. Elle espère maintenant que vous répondrez à l'appel et que vous lui enverrez photos ou vidéos pour faire connaitre vos projets ou initiatives vertes. Pour vous inspirer, vous pouvez écouter la vidéo sur le projet de la chaufferie de St-Ludger-de-Milot
en lien avec son pari de produire deux vidéos par semaine pendant un an sur les changements climatiques. Elle espère maintenant que vous répondrez à l'appel et que vous lui enverrez photos ou vidéos pour faire connaitre vos projets ou initiatives vertes. Pour vous inspirer, vous pouvez écouter la vidéo sur le projet de la chaufferie de St-Ludger-de-Milot ![]() . Vous découvrirez comment la biomasse forestière peut être revalorisée pour diminuer l'empreinte écologique et créer de l'emploi localement.
. Vous découvrirez comment la biomasse forestière peut être revalorisée pour diminuer l'empreinte écologique et créer de l'emploi localement.
Eric Alvarez dresse un bilan pour son blogue ![]() , la forêt à cœur, qui a attiré 2 605 visiteurs en 2013. Un bilan très positif qui offre de belles perspectives pour l’année 2014.
, la forêt à cœur, qui a attiré 2 605 visiteurs en 2013. Un bilan très positif qui offre de belles perspectives pour l’année 2014.
Se voulant moins controversé qu’à son habitude, André Desrochers discute du métier de pisteur ![]() . Après la lecture de ce billet, vous aurez peut-être le goût, vous aussi, d’aller faire une promenade en forêt pour observer des pistes d’animaux.
. Après la lecture de ce billet, vous aurez peut-être le goût, vous aussi, d’aller faire une promenade en forêt pour observer des pistes d’animaux.
Christopher Buddle vous informe de l’actualité arthropodologique dans son segment 9 ![]() . Comme il était au Kenya, le segment 8
. Comme il était au Kenya, le segment 8 ![]() est consacré aux photos qu’il a prises lors de son voyage au parc national d’Amboseli au Kenya. Si vous voulez découvrir un insecte ayant un cycle de vie digne d’un film de science-fiction, lisez le billet qu’il a écrit avec Wayne Knee sur les mites du genre Pyemotes
est consacré aux photos qu’il a prises lors de son voyage au parc national d’Amboseli au Kenya. Si vous voulez découvrir un insecte ayant un cycle de vie digne d’un film de science-fiction, lisez le billet qu’il a écrit avec Wayne Knee sur les mites du genre Pyemotes ![]() .
.
15 janvier 2014
La CEFoshère en bref
À l’instar de David Suzuki et d’Harvey Mead, André Desrochers constate que les environnementalistes ont échoué ![]() . Cependant, au lieu d’accuser seulement les acteurs sociaux pour cet échec, André l’attribue également au mouvement vert lui-même. Selon lui, l’autoflagellation, la calamythologie, l’amalgame de la gauche et du vert ainsi que le manque d’humanisme ont aussi contribué à la crise des verts. À vous de décider si vous partagerez son point de vue cette fois-ci.
. Cependant, au lieu d’accuser seulement les acteurs sociaux pour cet échec, André l’attribue également au mouvement vert lui-même. Selon lui, l’autoflagellation, la calamythologie, l’amalgame de la gauche et du vert ainsi que le manque d’humanisme ont aussi contribué à la crise des verts. À vous de décider si vous partagerez son point de vue cette fois-ci.
Si vous vous demandez si ça vaut la peine de se convertir à la géothermie, écouter la vidéo, de Catherine Potvin qui nous présente un couple qui a choisi la géothermie ![]() pour remplacer leur fournaise à l’huile. Dans une autre vidéo parue avant les fêtes, deux étudiants de l’université Thompson à Kamloops en Colombie Britannique explorent les facteurs qui permettent aux sols des pâturages d’emmagasiner du carbone
pour remplacer leur fournaise à l’huile. Dans une autre vidéo parue avant les fêtes, deux étudiants de l’université Thompson à Kamloops en Colombie Britannique explorent les facteurs qui permettent aux sols des pâturages d’emmagasiner du carbone ![]() .
.
Toujours aussi prolifique, Christopher Buddle a écrit plusieurs billets depuis la dernière parution de la CEfoshère. Il nous annonce qu’il se joindra au Teaching and Learning Services (TLS) de McGill pour développer des méthodes afin d’utiliser les médias sociaux en enseignement ![]() . D’ailleurs, il vous demande de lui écrire si vous les utilisez dans vos classes. En plus des médias sociaux, Christopher utilise les carnets de terrain comme méthode d’évaluation dans ses cours. Découvrez comment dans son billet
. D’ailleurs, il vous demande de lui écrire si vous les utilisez dans vos classes. En plus des médias sociaux, Christopher utilise les carnets de terrain comme méthode d’évaluation dans ses cours. Découvrez comment dans son billet ![]() . En plus de sa revue de l’actualité arthropodologique dans les segments 6
. En plus de sa revue de l’actualité arthropodologique dans les segments 6 ![]() et 7
et 7 ![]() , Christopher vous transmet sa liste de souhaits entomologiques pour 2014
, Christopher vous transmet sa liste de souhaits entomologiques pour 2014 ![]() . Étant donné qu’il est à un congrès au Kenya cette semaine, il s’est donné le droit de réutiliser un ancien billet que vous pourrez lire ou relire si vous voulez savoir pourquoi il étudie les arthropodes
. Étant donné qu’il est à un congrès au Kenya cette semaine, il s’est donné le droit de réutiliser un ancien billet que vous pourrez lire ou relire si vous voulez savoir pourquoi il étudie les arthropodes ![]() .
.
17 décembre 2013
La CEFoshère en bref
Vous voulez devenir professeur d’université? Pour prendre une décision éclairée, lisez le billet de Christopher Buddle: Three things you should know before deciding to become a Professor ![]() . Selon son habitude, Christopher résume l’actualité arthropodologique dans les segments 4
. Selon son habitude, Christopher résume l’actualité arthropodologique dans les segments 4 ![]() et 5
et 5 ![]() .
.
En lisant les premiers mots du billet d’André Desrochers, vous pourriez penser qu’il veut vous donner un cours de latin, mais son texte concerne plutôt la confusion entre corrélation et causalité ![]() . Après avoir donné des exemples de ce sophisme, il termine avec un conseil: remettez TOUT en question, surtout l’autorité apparente des sources, et construisez VOTRE pensée!
. Après avoir donné des exemples de ce sophisme, il termine avec un conseil: remettez TOUT en question, surtout l’autorité apparente des sources, et construisez VOTRE pensée!
Vous n’avez qu’à lire le titre du billet d’Eric Alvarez pour déduire qu’il n’a pas trop apprécié le Rendez-vous national de la forêt québécoise qu’il qualifie de continuité dans l’infantilisation de ce monde forestier ![]() . Disons que les exemples ne lui manquent pas pour appuyer son point et que la lecture de ce texte ne vous remontera pas le moral si vous avez une image idyllique de la foresterie au Québec.
. Disons que les exemples ne lui manquent pas pour appuyer son point et que la lecture de ce texte ne vous remontera pas le moral si vous avez une image idyllique de la foresterie au Québec.
5 décembre 2013
La CEFoshère en bref
Christopher Buddle vous offre 2 nouveaux segments pour vous permettre de suivre l’actualité arthropodologique, le plus récent étant dédié entièrement aux araignées. Que voulez-vous, le Spider Monday ![]() oblige! Devinez ce qui précédait ce Spider Monday? Eh oui, c’était le Black fly day
oblige! Devinez ce qui précédait ce Spider Monday? Eh oui, c’était le Black fly day ![]() ! Ici, il n’est pas question de magasinage, mais bien des charmantes mouches noires que nous aimons tant haïr. Et puis pour souligner l’Action de grâce américaine, Christopher se fait un petit cadeau en consacrant un billet à la diète des araignées
! Ici, il n’est pas question de magasinage, mais bien des charmantes mouches noires que nous aimons tant haïr. Et puis pour souligner l’Action de grâce américaine, Christopher se fait un petit cadeau en consacrant un billet à la diète des araignées ![]() . Celles-ci sont également à l’honneur sur Arthropod Ecology
. Celles-ci sont également à l’honneur sur Arthropod Ecology ![]() , Christopher et son étudiant Raphaël Royauté y résument un article qui a été récemment publié dans leur labo. Son billet d'aujourd'hui concerne la veuve noire
, Christopher et son étudiant Raphaël Royauté y résument un article qui a été récemment publié dans leur labo. Son billet d'aujourd'hui concerne la veuve noire ![]() qui, selon Catherine Scott
qui, selon Catherine Scott ![]() , serait amicale!
, serait amicale!
Comme promis, André Desrochers vous revient avec une plume plus positive dans Le déclin de la revue scientifique ![]() . Après un bref retour en arrière et une description sarcastique du processus de revision par les pairs, il prédit que le modèle de publication scientifique actuel ne résistera pas au Web 2.0. Qu’est qu’il vous propose à la place? Une transition du traditionnel article scientifique vers un format apparenté à un billet de blogue libre d’évoluer, se distinguant par la rigueur scientifique. Autre nouvelle, vous pouvez maintenant suivre André sur Facebook
. Après un bref retour en arrière et une description sarcastique du processus de revision par les pairs, il prédit que le modèle de publication scientifique actuel ne résistera pas au Web 2.0. Qu’est qu’il vous propose à la place? Une transition du traditionnel article scientifique vers un format apparenté à un billet de blogue libre d’évoluer, se distinguant par la rigueur scientifique. Autre nouvelle, vous pouvez maintenant suivre André sur Facebook ![]() .
.
Décidément, Catherine Potvin ne s’ennuie pas! En plus d’avoir participé à une discussion sur l’échec de la conférence de Varsovie sur le Climat ![]() à l’émission Les années lumières, d’avoir écrit un billet
à l’émission Les années lumières, d’avoir écrit un billet ![]() sur le site d’Équiterre et d’avoir donné une conférence
sur le site d’Équiterre et d’avoir donné une conférence ![]() à Cape Breton University, elle a mis en ligne 2 nouvelles vidéos sur Facebook
à Cape Breton University, elle a mis en ligne 2 nouvelles vidéos sur Facebook ![]() . La première vidéo concerne les moyens de transport alternatifs, dans le but de réduire les gaz à effet de serre. Dans la deuxième vidéo, Marshall Zuern explique comment en mangeant biologique et local vous combattez les changements climatiques une bouchée à la fois.
. La première vidéo concerne les moyens de transport alternatifs, dans le but de réduire les gaz à effet de serre. Dans la deuxième vidéo, Marshall Zuern explique comment en mangeant biologique et local vous combattez les changements climatiques une bouchée à la fois.
Vous trouverez deux nouveaux « Carnets de voyage » sur le blogue D'Eric Alvarez. Le Carnet de voyage n°5 ![]() aborde la question du déclin des membres de la Society of American Foresters. Le saviez-vous? Les forestiers américains font face à une dure réalité: s’adapter ou disparaitre. Dans la dernière chronique
aborde la question du déclin des membres de la Society of American Foresters. Le saviez-vous? Les forestiers américains font face à une dure réalité: s’adapter ou disparaitre. Dans la dernière chronique ![]() de ses Carnets de voyage 2013, Eric vous propose une synthèse de deux conférences du Chef du USDA Forest Service, M. Tom Tidwell. Eric est tellement enjoué par ses talents d’orateur qu’il vous propose de l’inviter à donner une conférence lors de vos congrès et colloques.
de ses Carnets de voyage 2013, Eric vous propose une synthèse de deux conférences du Chef du USDA Forest Service, M. Tom Tidwell. Eric est tellement enjoué par ses talents d’orateur qu’il vous propose de l’inviter à donner une conférence lors de vos congrès et colloques.
21 novembre 2013
La CEFoshère en bref
Christopher Buddle déménage son Expiscor ![]() hebdomadaire sur SciLogs.com
hebdomadaire sur SciLogs.com ![]() . En plus des faits saillants publiés le lundi, il y a publiera des chroniques sur les arthropodes. Ne vous inquiétez pas, son blogue ArthropodEcology.com
. En plus des faits saillants publiés le lundi, il y a publiera des chroniques sur les arthropodes. Ne vous inquiétez pas, son blogue ArthropodEcology.com ![]() restera actif. Vous pouvez d’ailleurs y lire un article traitant de l’utilisation d’appareils sans fil comme les tablettes dans des cours gradués
restera actif. Vous pouvez d’ailleurs y lire un article traitant de l’utilisation d’appareils sans fil comme les tablettes dans des cours gradués ![]() . Sur Scilogs vous pouvez découvrir des histoires abracadabrantes sur 3 espèces d’arthropodes
. Sur Scilogs vous pouvez découvrir des histoires abracadabrantes sur 3 espèces d’arthropodes ![]() , apprendre à connaître les strepsiptères
, apprendre à connaître les strepsiptères ![]() et savoir s’il existe une relation entre la diversité d’un taxon et le nombre de publications qui y sont consacrés
et savoir s’il existe une relation entre la diversité d’un taxon et le nombre de publications qui y sont consacrés ![]() .
.
Dans un texte intitulé Science, apparence et substance ![]() , André Desrochers aborde les ratés de la science des dernières décennies. Les critères de sélection des organismes subventionnaires et des revues scientifiques font en sorte que les protocoles de recherche sont rarement reproduits par des paires et les résultats dits «négatifs» sont rarement publiés dans les revues scientifiques. Les nouveaux savoirs ne sont donc peut-être pas aussi fiables que vous pourriez le croire? Si, vous vous sentez déprimé après votre lecture, lisez le prochain billet d’André, il nous promet d’y être plus positif!
, André Desrochers aborde les ratés de la science des dernières décennies. Les critères de sélection des organismes subventionnaires et des revues scientifiques font en sorte que les protocoles de recherche sont rarement reproduits par des paires et les résultats dits «négatifs» sont rarement publiés dans les revues scientifiques. Les nouveaux savoirs ne sont donc peut-être pas aussi fiables que vous pourriez le croire? Si, vous vous sentez déprimé après votre lecture, lisez le prochain billet d’André, il nous promet d’y être plus positif!
Catherine Potvin nous parle de la politique canadienne sur les changements climatiques ![]() dans une vidée tournée à Ottawa. Elle nous rappelle qu’avec les États-Unis, le Canada est le pays qui émet le plus de CO2 par habitant. Paradoxalement, nous sommes les deux pays qui présentent les cibles de réduction les moins ambitieuses. Dans une autre vidéo, Anthony Sardain
dans une vidée tournée à Ottawa. Elle nous rappelle qu’avec les États-Unis, le Canada est le pays qui émet le plus de CO2 par habitant. Paradoxalement, nous sommes les deux pays qui présentent les cibles de réduction les moins ambitieuses. Dans une autre vidéo, Anthony Sardain ![]() et Malie Lessard-Therrien
et Malie Lessard-Therrien ![]() vous emmènent à Singapour et à Stockholm pour vous faire découvrir des solutions innovantes aux problèmes d'eau, de déchets, et plus encore!
vous emmènent à Singapour et à Stockholm pour vous faire découvrir des solutions innovantes aux problèmes d'eau, de déchets, et plus encore! ![]() Catherine lance également un appel à l’aide pour identifier des initiatives contribuant à réduire les gaz à effet de serre. Vous pouvez faire part de vos suggestions sur sa page Facebook
Catherine lance également un appel à l’aide pour identifier des initiatives contribuant à réduire les gaz à effet de serre. Vous pouvez faire part de vos suggestions sur sa page Facebook ![]() .
.
Eric Alvarez a écrit trois nouveaux « Carnets de voyage ». Vous voulez savoir si Georges Washington était un massacreur ou un planteur d’arbres? Lisez le Carnet de voyage n°2: La réhabilitation (forestière) de George Washington ![]() . Selon vous quel est le lien entre l’aménagement forestier et l’esclavage? La réponse se trouve dans le Carnet de voyage n°3: L’héritage de l’esclavage comme enjeu d’aménagement forestier
. Selon vous quel est le lien entre l’aménagement forestier et l’esclavage? La réponse se trouve dans le Carnet de voyage n°3: L’héritage de l’esclavage comme enjeu d’aménagement forestier ![]() . Finalement, le Carnet de voyage n°4
. Finalement, le Carnet de voyage n°4 ![]() traite de l’état de la foresterie autochtone aux États-Unis.
traite de l’état de la foresterie autochtone aux États-Unis.
Un petit nouveau s’ajoute à cette chronique! Pierre Racine a publié un texte sur une nouvelle extension qu’il vient de lancer sur PostGIS: PostGIS Add-ons ![]() . Celle-ci inclut 15 nouvelles fonctions qui pourraient vous être très utiles. Vous pouvez télécharger cette extension directement sur son compte GitHub
. Celle-ci inclut 15 nouvelles fonctions qui pourraient vous être très utiles. Vous pouvez télécharger cette extension directement sur son compte GitHub ![]() .
.
4 novembre 2013
La CEFoshère en bref
Cette semaine, Christopher Buddle relève un défi proposé par un ami Twitter en dirigeant ses lecteurs vers des sites peu connus dans L’Expiscor ![]() qu’il nomme «the obscure edition» pour l’occasion. Il nous explique aussi pourquoi ses étudiants de premier cycle enseignent eux-même son cours d’entomologie
qu’il nomme «the obscure edition» pour l’occasion. Il nous explique aussi pourquoi ses étudiants de premier cycle enseignent eux-même son cours d’entomologie ![]() . Dans un autre texte, Christopher félicite les étudiants de son labo
. Dans un autre texte, Christopher félicite les étudiants de son labo ![]() qui ont présenté au Entomological Society of Canada’s annual meeting. Trois d’entre eux se sont distingués lors de ce congrès.
qui ont présenté au Entomological Society of Canada’s annual meeting. Trois d’entre eux se sont distingués lors de ce congrès.
André Desrochers profite de l’espace médiatique qu’a occupé le béluga dernièrement pour débattre de l’utilité ou de l’inutilité des espèces. Il nous explique Un béluga, ça sert à quoi? ![]()
Catherine Potvin nous propose une nouvelle série de vidéos sur l'avenir présentant plusieurs initiatives positives où le développement a été pensé autrement. Le premier film de la série intitulé La ville autrement ![]() raconte l’initiative d’un groupe d’intervenants pour préserver un terrain vague, le Champ des Possibles
raconte l’initiative d’un groupe d’intervenants pour préserver un terrain vague, le Champ des Possibles ![]() . Dans une autre vidéo intitulée Réduire tout en économisant
. Dans une autre vidéo intitulée Réduire tout en économisant ![]() , Catherine interview Kanta Kamary Rigaud de la Banque Mondiale et nous présente le rapport, Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience
, Catherine interview Kanta Kamary Rigaud de la Banque Mondiale et nous présente le rapport, Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience ![]() . Selon la Banque Mondiale, il serait plus économique de diminuer les gaz à effets de serre que de faire face aux catastrophes liées aux changements climatiques.
. Selon la Banque Mondiale, il serait plus économique de diminuer les gaz à effets de serre que de faire face aux catastrophes liées aux changements climatiques.
Eric Alvarez nous propose un nouvel épisode de ses «Carnets de voyage» ![]() . Le premier carnet concerne l’industrie forestière du sud des États-Unis
. Le premier carnet concerne l’industrie forestière du sud des États-Unis ![]() dont la stratégie de gestion de la forêt ressemble à s’y méprendre à l’approche de la Triade qui est présentement expérimentée au Québec.
dont la stratégie de gestion de la forêt ressemble à s’y méprendre à l’approche de la Triade qui est présentement expérimentée au Québec.
21 octobre 2013
La CEFoshère en bref
Voici un petit tour d’horizon des blogues des membres du CEF.
André Desrochers nous entretient sur les risques d’utiliser de façon abusive le principe de précaution dans son texte: Le principe de précaution: un couteau à double tranchant ![]() .
.
Catherine Potvin nous présente des entrevues avec deux spécialistes du climat sur la page Facebook de McGill at work ![]() . Dans le premier film, Dr Dominique Paquin, spécialiste en simulations climatiques, nous familiarise avec l'univers de la modélisation du climat. Dans le deuxième film, Travis Logan, spécialiste en scénarios hydroclimatiques, présente les scénarios climatiques futurs qu'il développe pour informer différents niveaux de gouvernements.
. Dans le premier film, Dr Dominique Paquin, spécialiste en simulations climatiques, nous familiarise avec l'univers de la modélisation du climat. Dans le deuxième film, Travis Logan, spécialiste en scénarios hydroclimatiques, présente les scénarios climatiques futurs qu'il développe pour informer différents niveaux de gouvernements.
Eric Alvarez fait un compte-rendu de l’Atelier de travail du MRN ![]() intitulé La possibilité forestière: du rendement soutenu au rendement durable. Je vous laisse le plaisir de découvrir le lien entre Isaac Asimov et cet atelier...
intitulé La possibilité forestière: du rendement soutenu au rendement durable. Je vous laisse le plaisir de découvrir le lien entre Isaac Asimov et cet atelier...
30 septembre 2013
La CEFoshère en bref
Les blogueurs du CEF ont été très actifs au cours des deux dernières semaines. Voici un aperçu pour vous donner le goût de vous rendre sur leurs blogues.
Christopher Buddle nous dresse un portrait des actualités concernant les arthropodes, la biologie et bien plus encore dans son Expiscor ![]() hebdomadaire. Il nous propose également un texte que tout le monde devrait lire sur l’art de la délégation
hebdomadaire. Il nous propose également un texte que tout le monde devrait lire sur l’art de la délégation ![]() . On peut aussi y lire un résumé vulgarisé du dernier article publié par son labo: Lunch in the tree-tops for the birds and the bugs
. On peut aussi y lire un résumé vulgarisé du dernier article publié par son labo: Lunch in the tree-tops for the birds and the bugs ![]() .
.
Le texte d’André Desrochers, Les bureaucrates du climat frappent encore ![]() , a été inspiré par le dernier rapport du GIEC. Il profite de la sortie de cette publication pour critiquer le GIEC et sa quête du consensus scientifique. Il nous suggère même une alternative à la Bible du climat pour aiguiser notre esprit critique: le Nongovernmental International Panel on Climate Change
, a été inspiré par le dernier rapport du GIEC. Il profite de la sortie de cette publication pour critiquer le GIEC et sa quête du consensus scientifique. Il nous suggère même une alternative à la Bible du climat pour aiguiser notre esprit critique: le Nongovernmental International Panel on Climate Change ![]() (NIPCC).
(NIPCC).
Catherine Potvin nous propose deux nouveaux vidéos en ligne sur la page Facebook de McGill at work ![]() . Dans le premier vidéo, Guillaume Peterson St-Laurent, Javier Mateo-Vega ainsi que deux paysans de l’est du Panama nous renseignent sur le mode de vie des «paysans colons», sur les impacts de l'invasion des territoires autochtones et sur l'importance de travailler avec les autochtones dans le cadre de l'aménagement du territoire. Le deuxième vidéo nous apprend comment la frontière de développement fonctionne dans le Nord-du-Québec et comment son développement affecte les communautés autochtones. Benoît Croteau, directeur du développement social et économique de la culture, du patrimoine et du territoire Abitibiwinnik de Pikogan et Hugo Asselin, titulaire de Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone, y sont interviewés.
. Dans le premier vidéo, Guillaume Peterson St-Laurent, Javier Mateo-Vega ainsi que deux paysans de l’est du Panama nous renseignent sur le mode de vie des «paysans colons», sur les impacts de l'invasion des territoires autochtones et sur l'importance de travailler avec les autochtones dans le cadre de l'aménagement du territoire. Le deuxième vidéo nous apprend comment la frontière de développement fonctionne dans le Nord-du-Québec et comment son développement affecte les communautés autochtones. Benoît Croteau, directeur du développement social et économique de la culture, du patrimoine et du territoire Abitibiwinnik de Pikogan et Hugo Asselin, titulaire de Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone, y sont interviewés.
Eric Alvarez fait un compte-rendu du Guide sylvicole du Québec ![]() . Malgré quelques critiques, il nous recommande les deux premiers tomes, le troisième sortira en 2015. Dans son texte précédant, Étude de cas: quand aménagement forestier et conservation cohabitent
. Malgré quelques critiques, il nous recommande les deux premiers tomes, le troisième sortira en 2015. Dans son texte précédant, Étude de cas: quand aménagement forestier et conservation cohabitent ![]() , Eric présente l’aménagement forestier d’un bassin versant, le Cedar River Municipal Watershed (367 km2), qui est la principale source d’eau potable de la ville de Seattle.
, Eric présente l’aménagement forestier d’un bassin versant, le Cedar River Municipal Watershed (367 km2), qui est la principale source d’eau potable de la ville de Seattle.
17 septembre 2013
La CEFoshère en bref
Cette nouvelle chronique sera publiée régulièrement sur le site du CEF afin de vous informer des dernières parutions mises en ligne par les blogueurs du CEF. Pour l’instant, il y a trois membres et un ancien membre du CEF qui sont actifs dans la blogosphère: Christopher Buddle, André Desrochers, Catherine Potvin et Eric Alvarez.
Christopher Buddle nous dresse un portrait des actualités concernant les arthropodes dans son Expiscor ![]() hebdomadaire. Il nous propose également un texte faisant l’éloge de l’utilisation de Twitter sur une base académique: Tweet tweet, twitter twitter: linking natural history and social media in a field biology class
hebdomadaire. Il nous propose également un texte faisant l’éloge de l’utilisation de Twitter sur une base académique: Tweet tweet, twitter twitter: linking natural history and social media in a field biology class ![]() . Vous pouvez suivre les étudiants inscrits à son cours sur Twitter #ENVB222
. Vous pouvez suivre les étudiants inscrits à son cours sur Twitter #ENVB222 ![]() .
.
Inspiré par le dernier roman de Dan Brown, Inferno, André Desrocher lance une réflexion sur l’accroissement de la population humaine et sur le niveau de vie matériel minimalement acceptable pour un humain dans son texte publié cette semaine, Population humaine: jusqu’où aller? ![]()
Catherine Potvin nous propose deux nouveaux vidéos en ligne ![]() . D'abord, Johanne Pelletier
. D'abord, Johanne Pelletier ![]() qui a complété son doctorat avec Catherine, nous raconte pourquoi elle en est venue à dresser un diagnostic des sources d’erreurs et d’incertitudes qui peuvent nuire à la précision du calcul de la biomasse des forêts. Ensuite, Ignacia Holmes
qui a complété son doctorat avec Catherine, nous raconte pourquoi elle en est venue à dresser un diagnostic des sources d’erreurs et d’incertitudes qui peuvent nuire à la précision du calcul de la biomasse des forêts. Ensuite, Ignacia Holmes ![]() et Divya Sharma
et Divya Sharma ![]() , deux étudiantes graduées de Catherine, nous parlent des peuples indigènes du Panama et de leurs forêts. Ignacia nous entretient sur les moyens de rapprocher deux services rendus par la forêt au Panama soit, la séquestration de carbone et son utilisation en tant que moyens de subsistance par l’agroforesterie. Puis, Divya nous parle des changements culturels et des changements d’utilisation du sol dans la communauté indigène de Piriatí-Embera au Panama.
, deux étudiantes graduées de Catherine, nous parlent des peuples indigènes du Panama et de leurs forêts. Ignacia nous entretient sur les moyens de rapprocher deux services rendus par la forêt au Panama soit, la séquestration de carbone et son utilisation en tant que moyens de subsistance par l’agroforesterie. Puis, Divya nous parle des changements culturels et des changements d’utilisation du sol dans la communauté indigène de Piriatí-Embera au Panama.
Eric Alvarez, qui a déménagé son blogue ![]() durant l’été, nous recommande chaudement de lire Wood: a history
durant l’été, nous recommande chaudement de lire Wood: a history ![]() . Ce livre traite de l’histoire de la foresterie allemande qui, en particulier par le biais de la notion de rendement soutenu, a eu une influence bien au-delà de ses frontières. Selon Eric, l’auteur insiste sur la relation intime et continue entre l’humain et le bois (plus largement la forêt) au fil des millénaires.
. Ce livre traite de l’histoire de la foresterie allemande qui, en particulier par le biais de la notion de rendement soutenu, a eu une influence bien au-delà de ses frontières. Selon Eric, l’auteur insiste sur la relation intime et continue entre l’humain et le bois (plus largement la forêt) au fil des millénaires.
19 avril 2013
«Être plus web» pour un chercheur universitaire, qu’est-ce que ça signifie?
Texte par Pierre Racine
Je disais récemment à mon collègue Alexis Achim que les chercheurs du CEF « n’étaient pas très web ». Ce que je voulais dire, c’est qu’outre la mise à jour de leurs publications les chercheurs réguliers du CEF, à quelques exceptions près, ne se préoccupent pas trop de savoir si leurs activités sont visibles et à jour sur le web. Les chercheurs du CEF se contentent généralement des manières traditionnelles d’assurer leur visibilité: présences ou présentations dans des colloques, entrevues ou articles dans les journaux ou réceptions de prix lors d’évènements.
En 2013, avec la monté du web comme premier média d’information, il devient de plus en plus facile et important d’être présent et visible dans « la sphère ![]() ». Mais pourquoi « faut-il » être visible sur le web après tout? La raison tient sous deux angles: le plaisir de communiquer et la nécessité d’être compétitif. Le plaisir de communiquer, c’est le même plaisir que celui d’enseigner en général, de communiquer ses résultats ou de transmettre la culture scientifique. Le web offre mille et un moyens de renouveler ses façons de communiquer ce plaisir. Mais communiquer son plaisir n’est certainement pas une obligation. La nécessité d’être compétitif, par contre, surtout pour les jeunes chercheurs, tient de la même obligation qu’ils ont de communiquer leurs travaux dans des colloques ou dans des journaux scientifiques. C’est se promouvoir; c’est concrétiser ses efforts sous la forme d’un produit final; c’est diffuser ses travaux au plus grand nombre afin d’être bien visible, mieux reconnu et donc... ...plus compétitif. La différence, c’est qu’aujourd’hui, avec la démocratisation des outils de communications, il existe beaucoup plus de moyens de communiquer ses résultats et ses activités qu’il en existait avant. Il est important de maîtriser au moins un de ces moyens de communication si on veut rester dans le coup et ne pas devenir, progressivement, «invisible». Voici donc quelques façons de devenir « plus web » et de maintenir sa visibilité dans le cyberespace pour un chercheur scientifique:
». Mais pourquoi « faut-il » être visible sur le web après tout? La raison tient sous deux angles: le plaisir de communiquer et la nécessité d’être compétitif. Le plaisir de communiquer, c’est le même plaisir que celui d’enseigner en général, de communiquer ses résultats ou de transmettre la culture scientifique. Le web offre mille et un moyens de renouveler ses façons de communiquer ce plaisir. Mais communiquer son plaisir n’est certainement pas une obligation. La nécessité d’être compétitif, par contre, surtout pour les jeunes chercheurs, tient de la même obligation qu’ils ont de communiquer leurs travaux dans des colloques ou dans des journaux scientifiques. C’est se promouvoir; c’est concrétiser ses efforts sous la forme d’un produit final; c’est diffuser ses travaux au plus grand nombre afin d’être bien visible, mieux reconnu et donc... ...plus compétitif. La différence, c’est qu’aujourd’hui, avec la démocratisation des outils de communications, il existe beaucoup plus de moyens de communiquer ses résultats et ses activités qu’il en existait avant. Il est important de maîtriser au moins un de ces moyens de communication si on veut rester dans le coup et ne pas devenir, progressivement, «invisible». Voici donc quelques façons de devenir « plus web » et de maintenir sa visibilité dans le cyberespace pour un chercheur scientifique:
- Maintenir sa page web personnelle à jour parlant de ses activités – Rien ne parait pire qu’une page web personnelle qui n’est plus à jour. C’est comme porter de vieux vêtements tachés dans un cocktail. Pas besoin de mettre sa page à jour tous les jours. Il est bien de vérifier que les informations qui s’y trouvent sont exacts et d’ajouter un petit quelque chose de temps en temps lorsqu’un évènement se produit: l’obtention d’une subvention, la participation à un colloque important, l’arrivé de nouveaux étudiants, l’exploration d’un nouveau thème de recherche, une nouvelle école d’été, un appel à participer à du travail de terrain, une offre d’emploi, des photos du terrain de l’été passé, etc... Bref, montrer que nous sommes vivants et actifs. Si vous êtes chercheur régulier au CEF, les professionnels de recherche du CEF peuvent mettre votre page à jour pour vous. Mais vous pouvez aussi le faire vous-même en obtenant un accès au site. N’est-on jamais mieux servi que par soi-même? Le systême à la base du site web du CEF est un wiki
 , comme Wikipedia. Il est donc très facile de modifier les pages. Il faut savoir aussi que les chercheurs réguliers, une fois authentifiés dans leur page personnelle sur le site web du CEF, peuvent eux-mêmes créer les pages personnelles de leurs étudiants et leur donner accès en édition simplement en cliquant sur un lien et en entrant le mot passe favoris de ceux-ci. Un couuriel est automatiquement envoyé à l'étudiant pour l'informer qu'il peut maintenant modifier lui-même sa page. Trois exemples de membres qui mettent à jour leur page régulièrement: Christian Messier, André Desrochers et Alain Paquette qui n’est pas membre régulier, mais sa page est tellement belle!
, comme Wikipedia. Il est donc très facile de modifier les pages. Il faut savoir aussi que les chercheurs réguliers, une fois authentifiés dans leur page personnelle sur le site web du CEF, peuvent eux-mêmes créer les pages personnelles de leurs étudiants et leur donner accès en édition simplement en cliquant sur un lien et en entrant le mot passe favoris de ceux-ci. Un couuriel est automatiquement envoyé à l'étudiant pour l'informer qu'il peut maintenant modifier lui-même sa page. Trois exemples de membres qui mettent à jour leur page régulièrement: Christian Messier, André Desrochers et Alain Paquette qui n’est pas membre régulier, mais sa page est tellement belle!
- Avoir une page de labo – Trop frileux (pardon «occupé»
 ) pour mettre votre page à jour vous-même? Il y a surement un membre de votre labo qui l’est moins que vous ou qui est simplement plus intéressé par la dimension web de la communication de la recherche. Avoir une page de labo est une manière de distribuer le travail de mise à jour en laissant plusieurs personnes collaborer au contenu. (C’est sur ce principe que le site web du CEF est construit en laissant les membres faire eux-mêmes leurs pages et ainsi contribuer au contenu du site. (Moi aussi je suis paresseux (pardon «occupé»);-) Évidemment, si on confie le travail à ses étudiants, il faut prévoir la continuation de la mise à jour en s’assurant qu’un autre (ou mieux, plusieurs autres) étudiant prenne la relève après le départ de celui qui s’est le premier jeté à l’eau. Que mettre dans une page de labo? Beaucoup des mêmes choses que dans sa page personnelle mais d’une manière plus large et moins... ...personnelle!
) pour mettre votre page à jour vous-même? Il y a surement un membre de votre labo qui l’est moins que vous ou qui est simplement plus intéressé par la dimension web de la communication de la recherche. Avoir une page de labo est une manière de distribuer le travail de mise à jour en laissant plusieurs personnes collaborer au contenu. (C’est sur ce principe que le site web du CEF est construit en laissant les membres faire eux-mêmes leurs pages et ainsi contribuer au contenu du site. (Moi aussi je suis paresseux (pardon «occupé»);-) Évidemment, si on confie le travail à ses étudiants, il faut prévoir la continuation de la mise à jour en s’assurant qu’un autre (ou mieux, plusieurs autres) étudiant prenne la relève après le départ de celui qui s’est le premier jeté à l’eau. Que mettre dans une page de labo? Beaucoup des mêmes choses que dans sa page personnelle mais d’une manière plus large et moins... ...personnelle!
Quelques pages de labo de membres du CEF: Marie-Josée Fortin , Steven Kembel
, Steven Kembel  , Bill Shipley
, Bill Shipley  , Patrick James
, Patrick James  , Mark Vellend
, Mark Vellend  , Lluis Brotons
, Lluis Brotons  , chercheur invité au CEF. Une page de labo peut aussi prendre la forme du programme d’une activité régulière. Par exemple Les midis Beavers du laboratoire de Louis Bélanger, ou le groupe Plein-R à l’université Laval
, chercheur invité au CEF. Une page de labo peut aussi prendre la forme du programme d’une activité régulière. Par exemple Les midis Beavers du laboratoire de Louis Bélanger, ou le groupe Plein-R à l’université Laval  . Il va sans dire que le site web du CEF permet de créer très facilement une ou plusieurs pages pour votre labo et ce en quelques minutes. Dommage que certains membres, plein de volonté au départ, ont plutôt délaissé leur page
. Il va sans dire que le site web du CEF permet de créer très facilement une ou plusieurs pages pour votre labo et ce en quelques minutes. Dommage que certains membres, plein de volonté au départ, ont plutôt délaissé leur page  de labo
de labo  ...
...
- Créer une page pour un projet en particulier – Rien de plus facile que de créer une nouvelle page sur le site web du CEF pour un projet particulier. Que ce soit une chaire, un projet de recherche, une école d’été, des notes de cours, un projet de vulgarisation. Quelques exemples de page de projets hébergés sur le site web du CEF (et ailleurs): les notes du cours Écosystèmes, biodiversité et populations de Nicolas Bélanger, l'école d'été sur les traits fonctionnels des plantes de Alison Munson et Bill Shipley, plusieurs Chaires et autres projets de recherche, le projet Triade
 , FOGRN-BC
, FOGRN-BC  .
.
- Tenir un blog – Une page web à jour c’est bien. Avoir un blog en plus c’est mieux! Le contenu d’une page web est général. Il s’améliore graduellement mais demeure constant et pratique. Un blog est un autre média qui permet de s’exprimer régulièrement, d’une manière renouvelée, sur des sujets précis avec de plus ou moins longs textes. On peut bloguer sur le dernier article qu'on vient de publier (en s'adressant à monsieur tout le monde), sur notre dernière saison de terrain, sur une avancé faite dans notre domaine par une autre équipe, pour faire de la vulgarisation, pour promouvoir un projet, etc... Bloguer sur notre dernière découverte est une excellente façon de la faire rayonner à l'extérieur du cercle restraint des quelques collègues qui sont en mesure de comprendre notre jargon scientifique et, qui sait, de la voir sortir dans les médias traditionnels. C'est aussi une excellente façon d'obtenir des commentaire d'une manière informelle. Le site web du CEF ne permet pas d'héberger son propre blog, mais il existe de nombreuses plateformes comme Blogger
 ou WordPress
ou WordPress  qui vous permettent de créer un blog simplement, rapidement et gratuitement. Une page dédiée dans Facebook peut aussi être utilisée comme un blog. Quelques membres (ou anciens membres) du CEF tiennent un blog à jour: Arthropod Ecology
qui vous permettent de créer un blog simplement, rapidement et gratuitement. Une page dédiée dans Facebook peut aussi être utilisée comme un blog. Quelques membres (ou anciens membres) du CEF tiennent un blog à jour: Arthropod Ecology  , La forêt à coeur
, La forêt à coeur  , Geospatial Elucubrations
, Geospatial Elucubrations  . Un blog peut aussi être tenu par un groupe de personne intéressé par un même sujet. Un blog pour tous les chercheurs du CEF avait été créé en 2007
. Un blog peut aussi être tenu par un groupe de personne intéressé par un même sujet. Un blog pour tous les chercheurs du CEF avait été créé en 2007  afin de leur permettre de commenter l’actualité forestière, mais malgré l’importance médiatique du projet, aucun chercheur n’a jamais fait le grand saut… J'aurais pourtant cru que 400 chercheurs, tous intéressés par un domaine commun, ce serait suffisant pour publier au moins deux petits articles de quelques paragraphes par mois. Dans les conversations de tous les jours les scientifiques ont toujours une opinion sur tout. Lorsque vient le temps de la publier dans un format adéquat, rien, niet, nada. Y aurait-il des intéressés?
afin de leur permettre de commenter l’actualité forestière, mais malgré l’importance médiatique du projet, aucun chercheur n’a jamais fait le grand saut… J'aurais pourtant cru que 400 chercheurs, tous intéressés par un domaine commun, ce serait suffisant pour publier au moins deux petits articles de quelques paragraphes par mois. Dans les conversations de tous les jours les scientifiques ont toujours une opinion sur tout. Lorsque vient le temps de la publier dans un format adéquat, rien, niet, nada. Y aurait-il des intéressés?
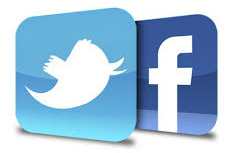
- Facebook, Linkedin, Twitter – Être présent à titre de chercheur sur les réseaux sociaux permet de diffuser de l’information, selon différents modes, à un grand nombre de personnes sans beaucoup d’efforts et d’attirer des gens vers sa page web ou son blog. Facebook est plutôt un espace personnel mais rien n’empêche d’y créer, comme l'a fait Catherine Potvin, sa page de laboratoire
 . Linkedin
. Linkedin  c’est comme une version professionnelle de Facebook. On ne peut y créer que des pages d’organisation très simples mais on peut surtout s’en servir pour diffuser efficacement de l’information dans son réseau professionnel si on a un bon réseau
c’est comme une version professionnelle de Facebook. On ne peut y créer que des pages d’organisation très simples mais on peut surtout s’en servir pour diffuser efficacement de l’information dans son réseau professionnel si on a un bon réseau  . Twitter c’est pour les vrai geeks de l’info mais aussi une plateforme fantastique pour communiquer rapidement et efficacement. 140 caractères c’est peu, mais c’est suffisant si on a le sens du clip et qu’on utilise les hashtag (mot clé débutant avec le caractère « # ») correctement. On peut facilement rediriger des dizaines de personnes vers son blog ou sa page web avec Twitter.
. Twitter c’est pour les vrai geeks de l’info mais aussi une plateforme fantastique pour communiquer rapidement et efficacement. 140 caractères c’est peu, mais c’est suffisant si on a le sens du clip et qu’on utilise les hashtag (mot clé débutant avec le caractère « # ») correctement. On peut facilement rediriger des dizaines de personnes vers son blog ou sa page web avec Twitter.
Le CEF a maintenant sa page Facebook (aimez-nous!) et son compte Twitter
(aimez-nous!) et son compte Twitter  et plusieurs membres du CEF sont actifs sur Twitter d’une manière professionnelle: @CMBuddle
et plusieurs membres du CEF sont actifs sur Twitter d’une manière professionnelle: @CMBuddle  , @LamberTJB
, @LamberTJB  , @stevenkembel
, @stevenkembel  , @AlamMahb
, @AlamMahb  , @nthiffault
, @nthiffault  , @LaForetACoeur
, @LaForetACoeur  , @Briforet
, @Briforet  , @GeoElucubration
, @GeoElucubration  et bien sûr, @dedelafortune
et bien sûr, @dedelafortune  (pas vraiment professionnel ce dernier, mais certainement hyperactif!)
(pas vraiment professionnel ce dernier, mais certainement hyperactif!)
- Mais encore! – Partager vos présentations sur SlideShare
 , avoir votre page dans ResearchGate
, avoir votre page dans ResearchGate  , Mendeley
, Mendeley  ou Google Scholar
ou Google Scholar  , contribuer à des projets open access
, contribuer à des projets open access  , open research
, open research  , open data
, open data  ou open source
ou open source  sont d’autres façons d’être présent sur le web.
sont d’autres façons d’être présent sur le web.
Pas nécessaire de faire tout ça, on y passerait tout notre temps. L’important c’est d’être actif sur au moins une plateforme et d’utiliser les autres pour rabattre les intéressés vers la plateforme de notre choix. Pensez Open! Je tiendrai un kiosque « Créer sa page sur le site web du CEF » la semaine prochaine au Colloque du CEF. Passez me voir si vous avez encore des angoisses web 2.0. On en discutera! J'ai aussi préparé une recette à suivre pour vous guider dans les étapes visant à améliorer votre visibilité sur le web ![]() .
.
Pour finir et aller plus loin, quelques articles qui traitent du sujet: «Social Media for Scientists Part 1: It’s Our Job» ![]() , «How scientists use social media to communicate their research»
, «How scientists use social media to communicate their research» ![]() , «Marketing For Scientists - Thinking Beyond Self-Promotion»
, «Marketing For Scientists - Thinking Beyond Self-Promotion» ![]() , «Using Social Media Increases Fundraising by 40%»
, «Using Social Media Increases Fundraising by 40%» ![]() .
.
4 octobre 2012
Épluchette tardive au CEF-UQAM
Texte et photos par Mélanie Desrochers
Suite aux aléas de la grève et aux remaniements des calendriers scolaires, c'est une rentrée tardive qui s'est déroulée cette semaine au CEF-UQAM. Pour souligner cette nouvelle année qui débute, les membres du CEF étaient invités à participer à une épluchette de blé d'Inde extérieure le 3 octobre dernier. Pas facile de trouver du maïs rendu en octobre! Mais Daniel Lesieur a su braver les campagnes lavaloises pour en trouver, et du bon en plus! Près de 40 membres du CEF sont venus déguster et échanger avec leurs nouveaux collègues chercheurs. Lors de son mot de bienvenue, le codirecteur du CEF, Pierre Drapeau, a souligné l'importance, surtout en cette ère numérique et virtuelle, d'être présent physiquement dans les labos et dans les murs du CEF. Il a aussi souhaité la bienvenue au nouveau chercheur membre, Steven Kembel, professeur à l'UQAM en écologie, biologie évolutive et bioinformatique. Finalement, il a souhaité bon succès à tous dans cette nouvelle session qui commence!


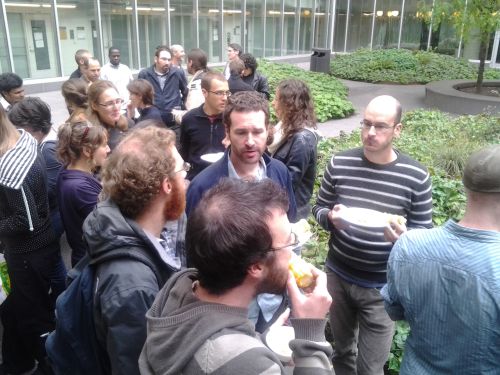
28 novembre 2011
Séjour inoubliable offert par la SÉPAQ
Texte et photos par les étudiants de Cornelia Krause
La présente est pour vous remercier pour le magnifique séjour de pêche offert au Colloque du CEF par la SÉPAQ, que nous avons passé à la réserve faunique Ashuapmushuan. Les quatre heureux élus ont profité au maximum de ce moment de détente (bien mérité, disons-le!) en nature. Le chalet était très tranquille, propre et confortable, de même que toutes les autres installations. La pêche a occupé la majeure partie de notre temps et nous avons même eu la chance de pêcher quelques beaux spécimens. Les soirées étaient elles aussi splendides; rassasiés de poissons, nous pouvions nous détendre près d’un bon feu de camp. Tous sont d'accord pour dire que nous avons été privilégiés d’avoir vécu ce moment inoubliable et aucune ombre au tableau n’est venue ternir cette magnifique expérience.
Merci infiniment pour ce moment extraordinaire! Merci également à notre directrice, madame Cornelia Krause, de nous avoir gâtés à ce point en nous faisant cadeau de ce merveilleux séjour!
Le CEF tient à souligner la générosité de la SÉPAQ qui a offert ce prix de présence d'une valeur de $ 1500 lors du 5e Colloque annuel du CEF, en avril 2011.


30 septembre 2011
Annonce importante du RLQ dans le cadre du Carrefour Forêt Innovations
Texte par Pierre Gagné, ing. f.

Le Réseau Ligniculture Québec vous invite à assister au colloque « Le reboisement, perspectives d’avenir ![]() » qui sera présenté jeudi prochain (6 octobre) au Carrefour Forêt Innovations, au Centre des congrès de Québec (salle 301-B) dès 9h00. Vous pouvez maintenant consulter le cahier du participant qui est disponible sur notre page Web
» qui sera présenté jeudi prochain (6 octobre) au Carrefour Forêt Innovations, au Centre des congrès de Québec (salle 301-B) dès 9h00. Vous pouvez maintenant consulter le cahier du participant qui est disponible sur notre page Web ![]() dans la section « Événements et revue de presse ». Ce recueil présente les résumés des conférences qui seront présentées au colloque. Une copie papier du cahier du participant vous sera remise sur place.
dans la section « Événements et revue de presse ». Ce recueil présente les résumés des conférences qui seront présentées au colloque. Une copie papier du cahier du participant vous sera remise sur place.
De plus, l’équipe du Réseau Ligniculture Québec est heureuse d’annoncer la sortie imminente du Guide de populiculture au Québec. Le lancement officiel aura lieu lors du colloque. Ce guide pratique sur la culture du peuplier hybride est le fruit d’un important travail d’équipe ainsi que d’une belle et longue collaboration entre les partenaires du RLQ. Le guide est destiné aux acteurs forestiers soucieux d’investir temps et argent dans la réalisation de plantations de peuplier hybride performantes. Il sera vendu au coût de 15$ (TPS incluse). Venez nous rencontrer au kiosque du Réseau Ligniculture Québec lors du CFI pour feuilleter, acheter ou commander un exemplaire.
Enfin, dès l’allocution d’ouverture du Carrefour Forêt Innovations, soit le mardi 4 octobre à 13h00, nous tenons à vous inviter à participer à un hommage qui sera rendu à M. Gilles Vallée par M. Richard Savard, sous-ministre associé à Forêt Québec. Ce témoignage de reconnaissance pour les 30 ans de carrière de M. Vallée à la Direction de la recherche forestière sera rendu dans la salle 400AB (salle d’exposition principale) du Centre des congrès de Québec. Venez partager avec nous ce moment important en hommage au travail d’un pionnier de la recherche forestière au Québec.
N’oubliez pas de venir visiter notre kiosque dans la salle d’exposition principale!
L’Équipe du Réseau Ligniculture Québec
13 mai 2011
Biomasse forestière: un enjeu crucial!
Texte par David Paré

La biomasse fournit actuellement 80 % de l’énergie renouvelable produite sur la planète et son utilisation est appelée à croitre d’ici 2050 selon un rapport de l’ONU.
Les énergies renouvelables sont appelés à se développer et à permettre à la fois de limiter les changements climatiques et de devenir un facteur majeur de développement selon un rapport du GIEC/IPCC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) dont le sommaire pour décideurs a été accepté par l’assemblé lundi le 9 mai à Abu Dhabi. Rappelons qu’un quart de l’humanité n’a pas accès à l’électricité. Parmi ces énergies, la bioénergie, en particulier celle produite à partir de biomasse ligneuse occupe la part du lion et est appelé à demeurer la source principale d’énergie renouvelable d’ici 2050 selon de nombreux scénarios évaluées par un panel d’experts.

David Paré, chercheur au Service canadien des forêts et professeur associé au CEF a participé au rapport spécial du GIEC sur les énergies renouvelables (SRREN) en tant que « Review Expert » du chapitre 2 Bioenergy. Ce volumineux rapport de 1400 pages se veut le document le plus complet sur les énergies renouvelables et sera disponible le 31 mai. Il couvre les enjeux techniques, sociaux et économiques du développement de ces énergies et se veut une référence incontournable pour les décideurs ainsi que pour le prochain rapport du GIEC (AR5) sur les changements climatiques. Le rapport montre que des politiques soutenues devront être mise en place pour assurer le développement durable de celles-ci et pour favoriser leurs essors mais que même sans politiques fortes elles se développeront. (Lire le sommaire du rapport) ![]()
Quelques échos dans la presse internationale:
- Renewables can fuel society, say world climate advisers
 (BBC)
(BBC)
- Key findings on renewable energy by U.N. panel
 (Reuters)
(Reuters)
- Exclusive: Renewable energies to leap, costs fall
 (UN)
(UN)
11 avril 2011
Texte par Alison Munson

La Faculté de Foresterie, de Géographie et de Géomatique de l’Université Laval et ses partenaires ont décerné plus de 260 000 $ en prix et en bourses aux étudiants de 1er, 2e et 3e cycles le 24 mars dernier, incluant un grand nombre d’étudiants-chercheurs du CEF. La soirée s’est terminée par un cocktail dînatoire. Félicitations à tous les récipiendaires! Merci également à tous les généreux donateurs qui supportent ces fonds qui constituent un atout pour nos étudiants et une grande motivation pour la poursuite de leurs études.
Voici les étudiants du CEF récipiendaires de bourses:
- Fonds Avenor (5000 $) | Frédérique Saucier
- Fonds Abitibi-Consolidated en Aménagement Durable (5000 $) | Julien Beguin, Juliette Boiffin, Charles Ward, Julie Barrette et Kaysandra Waldron
- Conseil de I'industrie forestière du Québec (1000 $) | Simon Delisle-Boulianne
- Fondation F.K Morrow | Bourse John-A.- Hinman en biologie forestière | Marie-Hélène Hachey (2000 $) et Nicole Barker (1000 $)
- Fonds de recherche et de développement en foresterie (FRDF) | Bourse Rodolphe-De-Koninck en Géographie forestière | Jason Laflamme (3 000 $)
- Hydro-Québec: Bourse d’admission à la maîtrise | Delphine Boyer-Groulx (5 000 $)
- Bourse BMP Innovation FQRNT-CRSNG | Centre collégial de transfert de technologie en foresterie (CERFO) | Juliane Laliberté (27 000 $)
- Bourse Accélération Québec FQRNT-MITACS | IAMGold Essakane SA | Estelle Campagnac , stage postdoctoral (45 000 $)
- Association québécoise de gestion de la végétation (AQGV) | Sebastien Renard (400 $)
- Bourse Wladimir-A.-Smirnoff | Nathalie-Suzette Delvas (5 000 $)
- Institut EDS (Environnement, développement et société) de l'Université Laval | Frédérique Saucier (4 000 $)
- Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) | Bourse d’études supérieures Alexander-Graham-Bell (BESC) – maîtrise | Delphine Boyer-Groulx 17 500 $
- Fonds de recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) | Bourse d’études supérieures (B2) – doctorat | Filip Havreljuk 20 000 $
17 décembre 2010


Cours de statistiques avancées offert en vidéoconférence
BIO8093 - Analyse statistique de données complexes (cours de 3 crédits; 2e et 3e cycle)
Préalables: Afin de tirer un maximum de ce cours, les étudiants inscrits doivent déja maîtriser les régressions multiples, analyses de variance (ANOVA) classiques, et quelques GLM's simples (Poisson, binomial). Une expérience préalable avec la programmation dans SAS ou R sera un atout.
Description: Ce cours avancé vise à développer des aptitudes de modélisation avancées chez l’étudiant qui dispose de données récoltées selon un dispositif expérimental à mesures répétées ou niché (hiérarchique) ou encore des données caractérisées par une distribution autre que normale (Poisson, binomiale, gamma, binomiale négative, multinomiale). Différentes stratégies d’analyses seront présentées allant de la régression robuste (“ robust regression ”) jusqu’au modèles mixtes généralisés (GLMM) en passant par les régressions logistiques ordinales et les simulations de Monte Carlo. Par le biais d’exemples détaillés, le cours mettra l’accent sur les applications de ces techniques en biologie, écologie, génie, et médecine avec R.
Contenu du cours:
Cours 1: Tests de randomisation
Cours 2: Intervalles de confiance et introduction au bootstrap (non-paramétrique)
Cours 3: Maximum de vraisemblance (Maximum likelihood) et optimisation de fonctions
Cours 4: Régression robuste aux valeurs extrêmes
Cours 5: Application de tests de randomisation/bootstrap sur des régressions
Cours 6: Régression de Poisson et binomiale négative
Cours 7: Régressions logistiques pour variables réponses binaires, multinomiales ou ordinales
Cours 8: Régression gamma pour temps de survie
Cours 9: Extensions aux GLM's pour mesures répétées: generalized estimating equations (GEE)
Cours 10: Modèles mixtes linéaires
Cours 11: Modèles mixtes généralisés (GLMM's)
Cours 12: Méthode delta pour calculer la variance et autres outils
Cours 13: Simulations de Monte Carlo (GLMM's revisités)
Cours 14: Introduction aux analyses de séries temporelles (ARMA, ARIMA, generalized least squares regression)
Ce cours sera offert en vidéoconférence à l’UQAM à la session d’hiver 2011 (les mercredis à partir du 19 janvier) par Marc Mazerolle, biostatisticien du Centre d’étude de la forêt et auteur du package R AICcmodavg, à partir de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda.
Veuillez contacter Marc Mazerolle pour de plus amples informations, pour les modalités d'inscription via la CREPUQ, et pour réserver vos places dès maintenant.
2 décembre 2010
Mastigouche, le Royaume du Grand Sorcier!
Texte par Sylvain Delagrange

Merci, un grand merci au CEF et à la SEPAQ ![]() . Au début août dernier, 18h45, après 4 heures de route dont 1 heure de chemins forestiers peu entretenus (pour une Mazda 3 un peu plus chargée qu’il ne faut évidemment), nous voilà arrivés au paradis… lac Shawinigan, réserve faunique de Mastigouche (46,673o N; 73,120o W), prix de participation du colloque du CEF 2010.
. Au début août dernier, 18h45, après 4 heures de route dont 1 heure de chemins forestiers peu entretenus (pour une Mazda 3 un peu plus chargée qu’il ne faut évidemment), nous voilà arrivés au paradis… lac Shawinigan, réserve faunique de Mastigouche (46,673o N; 73,120o W), prix de participation du colloque du CEF 2010.
Un petit coucher de soleil timide nous souhaite la bienvenue et chasse l’ours noir qui semblait avoir pris possession des lieux. Il va lui falloir patienter dans la réserve écologique toute proche. De notre côté, un petit tour sur la plage et hop le Coleman est en action. La première nuit, calme et fraiche malgré le mois d’août, nous a complètement fait décrocher. Au menu, balade en barque, visite de l’île, baignade et puis plus rien… repos total et absolu… Une sangsue plus tard, la journée est passée et c’est à nouveau l’heure du Coleman…

Deuxième nuit, une tempête aussi courte que violente à couler le long du lac juste pour rappeler la force du grand sorcier. Au matin, on a pu voir que les vieux pins en avaient l’habitude, les jeunes sapins et la chaise de jardin pas vraiment… En ce nouveau jour, l’exploration du lac est poussée un peu plus loin (on est allé jusqu’à la grosse roche… à droite) et le kayak est préféré à la barque. Une autre après midi de communion avec le silence étonnant de la place (il faut dire qu’on n’a pas vu une aile de mouche) et revoilà le Coleman. Mais le repas est un peu moins savoureux, le départ est proche et les voitures sont à nouveau trop pleines.

Un dernier bye-bye au site. Il semble impossible que nous ayons passé seulement 2 jours ici. L’impression qui nous reste est plutôt celle de quitter sa demeure. Comme s’il ne voulait pas qu’on parte, un loup nous barre le chemin (quelques secondes de gagner) et plus loin, revoici notre ami l’ours qui sort de sa réserve pour reprendre, au pas de course, possession de son « spot ». Maintenant nous comprenons pourquoi.
Merci donc encore, une expérience inoubliable, une place magnifique… L’année prochaine, promis, je ne participerai pas au tirage pour laisser une chance aux autres, mais j’y retournerai quand même! C’est l’appel du grand sorcier de Mastigouche – ds
25 novembre 2010
L’aménagement durable des forêts est au cœur de la gestion forestière depuis plus d’une décennie. La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, adoptée en mars 2010, implante un nouveau régime forestier qui marque un pas déterminant en ce sens.

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune souhaite connaître l’opinion de la population sur deux dossiers clés du nouveau régime forestier:
- la stratégie d’aménagement durable des forêts;
- les modalités proposées pour le futur règlement sur l’aménagement durable des forêts.
Plusieurs experts ont été consultés afin de connaitre leur position sur la Stratégie. Les experts ont produit trois avis à des moments clés de l’élaboration de l’ébauche de la SADF. Les commentaires des deux premiers avis ont été considérés dans la version soumise à la consultation publique.
En plus d’éclairer le débat, les commentaires du troisième avis des experts sont rendus disponibles pour la période de consultation publique. Ces derniers ne sont pas intégrés dans le présent document de consultation et seront considérés lors de la révision de la SADF, en même temps que les avis et commentaires qui seront reçus lors de la consultation publique.
- Volet économique: Robert Beauregard, Université Laval (pdf
 ) et Luc Bouthillier1, Université Laval
) et Luc Bouthillier1, Université Laval
- Volet social: Nicole Huybens, Université du Québec à Chicoutimi (pdf
 ), Solange Nadeau, Service canadien des forêts – Ressources naturelles Canada (pdf
), Solange Nadeau, Service canadien des forêts – Ressources naturelles Canada (pdf  ) et Stephen Wyatt, Université de Moncton (dimension autochtone) (pdf
) et Stephen Wyatt, Université de Moncton (dimension autochtone) (pdf  )
)
- Volet environnement: André Bouchard2, Université de Montréal et Yves Bergeron, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Université du Québec à Montréal (pdf
 )
)
1 En raison d’un surcroît de travail, M. Bouthillier ne rendra son avis qu'en décembre 2010. 2 Les travaux de M. Bouchard ont été poursuivis par M. Bergeron à la suite de son décès.
Plusieurs consultations publiques sont prévues en novembre et décembre dans toutes les régions du Québec. N'hésitez pas à consulter le calendrier ![]() .
.
19 octobre 2010
Appel à contribution | Un nouveau modèle de gouvernance: Parcs Nunavik

L’objectif de cet ouvrage collectif pluridisciplinaire est d’étudier les enjeux, perspectives et problématiques liés à la mise en œuvre (réalisée et planifiée) d’un réseau de parcs québécois nordiques par une organisation en cogestion avec les Inuits, Parcs Nunavik.
La création d’aires protégées en territoire autochtone s’est longtemps faite sans tenir compte des Premières Nations ou des Inuits qui utilisaient ces territoires. Ces pratiques entrainèrent de nombreuses protestations des Autochtones qui se sentaient dépossédés de leur territoire et se voyaient privés de la capacité d’exercer des activités traditionnelles. La signature d’ententes territoriales, à partir de la fin des années soixante-dix, ainsi que plusieurs arrêts de la Cour suprême du Canada allaient, néanmoins, contraindre les institutions publiques à prendre en compte les demandes des autochtones, notamment en termes de dévolution des pouvoirs. C’est ainsi que dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, notamment dans le domaine de la création d’aires protégées, la cogestion est apparue comme un moyen de satisfaire aux obligations légales découlant de ces ententes territoriales et des arrêts juridiques (Samson 2006).
Toutefois, derrière ce concept de cogestion se cache une variété de pratiques allant de la simple consultation à la définition d'une véritable gestion partenariale. Cest pourquoi de nombreuses études s’intéressent aux mérites et limites respectives de chacun des modèles de cogestion ou proposent des stratégies pour créer des formes de cogestion respectant les droits et besoins des Autochtones.
L’objectif de cet ouvrage collectif pluridisciplinaire est d’étudier les enjeux, perspectives et problématiques liés à la mise en œuvre (réalisée et planifiée) d’un réseau de parcs québécois nordiques par une organisation en cogestion avec les Inuits, Parcs Nunavik.
Les auteurs intéressés à contribuer à cet ouvrage sont priés d’envoyer le titre et un court résumé de leur article aux directeurs de l’ouvrage, Thibault Martin (Université du Québec en Outaouais, Thibault.Martin@uqo.ca) et Daniel Chartier (Université du Québec à Montréal, chartier.daniel@uqam.ca) avant le 1er novembre 2010. Ils devront par la suite envoyer leur article avant le 1er février 2011, rédigé selon le protocole qui les directeurs de la publication leur feront parvenir. Les articles devront compter entre 15 et 30 pages, soit entre 30 000 à 60 000 signes, ce qui inclut les espaces, les notes et la bibliographie. Les auteurs peuvent inclure des illustrations, qui seront reproduites en noir et blanc, en autant qu’ils incluent avec leur article une déclaration de libération des droits d’auteur. Chaque article sera évalué de manière anonyme par un comité de pairs.
L’ouvrage sera publié en 2011 dans la collection « Droit au pôle » des Presses de l’Université du Québec.
Nelly DUVICQ
Coordonnatrice, Laboratoire international d'étude multidisciplinaire comparée des représentations du Nord ![]()
Courriel: imaginairedunord@uqam.ca
19 août 2010
Le CEF participe à un projet photo sur la forêt boréale
Texte par Mélanie Desrochers

Deux français, quatre appareils photo, une mission: faire un portrait humain de la forêt boréale québécoise. C'est ce à quoi rêvait Agnès Domingo et Guillaume Ajavon, deux aventuriers qui ont tout laissé derrière eux pour partir à la découverte des gens qui habitent, travaillent et vivent en forêt boréale québécoise.
C'est par un survol sur Google Earth que leur destination s'arrête sur l'Abitibi-Témiscamingue. De Montréal, ils prendront le train vers Senneterre à bord duquel ils feront les premières rencontres de personnages forestiers. Rapidement, ils se rendent compte que tout le monde se connaît dans ce milieu! C'est ainsi qu'ils aboutissent, un beau soir d'été de juillet, à la Station de recherche de Duparquet (FERLD ![]() ) pour rencontrer les scientifiques de la forêt boréale. Les voilà donc prêts à accompagner deux groupes sur le terrain.
) pour rencontrer les scientifiques de la forêt boréale. Les voilà donc prêts à accompagner deux groupes sur le terrain.
En compagnie d'Aurélie Terrier, d'Emmanuelle Fréchette et de Mélanie Desrochers, ils partent pour une première visite en pessière à mousses, au nord de Villebois. Ils ont droit à un réel cours 101 sur la forêt boréale: essences forestières, biodiversité, aménagement écosystémique, perturbations, sols forestiers... tout y passe, même le changement d'un pneu crevé! Au cours de la journée, ils visiteront différents peuplements forestiers (perturbés ou non et de compositions et d'âges différents). On les sent impressionnés par l'ampleur du projet d'Aurélie, qui tente de modéliser les effets des changements climatiques sur le sol forestier et donc de sa réponse aux feux de forêts.
Quelques jours plus tard, ils suivront les traces de Simon Paradis et de Martin Payette, deux membres du laboratoire d'entomologie de Tim Work (UQAM), afin de récolter le contenu d'insectes dans les pièges fosses qui sont placés dans différents traitements forestiers et sites témoin, à même la FERLD. L'importance de la biodiversité présente dans le sol est un aspect qui a étonné nos deux visiteurs.
En plus des chercheurs du CEF, Guillaume et Agnès ont eu la chance d'arpenter nombreux endroits abitibiens, tels que Kitsisakik, Val d'Or, Rouyn-Noranda, Rapide-Danseur, LaSarre, Amos, Villebois, Joutel, lac Mistaouac et même Radisson au nord du Québec! Ce qu'ils ont été impressionnés du paysage à la vue d'un récent feu de forêt... Au cours de leur périple, ils ont pu échanger sur l'importance de la forêt avec les travailleurs forestiers, planteurs, industriels, autochtones, artistes, agriculteurs, environnementalistes, fonctionnaires, bohèmes, etc. Leur projet photo se veut donc une série de portraits accompagnés de citations des gens qui vivent en forêt boréale.
Une fois retournés à Toulouse, nos deux comparses désirent monter leur exposition photo et la proposer aux différents Museum d'Histoire Naturelle français. Si possible, ils souhaiteraient aussi rapporter leur expo en Abitibi, afin que les gens locaux puissent voir le travail réalisé en leur compagnie. Ce fut un réel plaisir pour les gens du CEF de collaborer à ce beau projet. Voici même, en primeur, quelques clichés pris en Abitibi.
Biologiste de formation et photographe de passion, Guillaume Ajavon tenait à faire une photo-reportage scientifique. Agnès Domingo, aménagiste du territoire, espère influencer les jeunes à se forger une conscience environnementale. Les premières idées de sujet et de destination comprennent la forêt amazonienne (Brésil), les sables bitumineux (Alberta), les défis environnementaux en Inde et la forêt boréale québécoise. Agnès ayant déjà passé deux ans au Québec à travailler pour le Conseil régional de l'environnement de Montréal, ils décident de démarrer la série de reportages au Québec. Les voilà donc enlignés pour le Québec à l'été 2010. Refusant de se plier à des contraintes et des exigences d'autrui, ils décident de partir sans subvention ni soutien de quelconque organisation, afin de réellement faire le projet dont ils rêvaient. On peut consulter certains projets photographiques passés sur leur site Douce Offensive ![]() .
.

















10 juin 2010
Un nouveau docteur au CEF, Julien Fortier
Texte par Daniel Gagnon

Mercredi le 9 juin s’est déroulée la soutenance de thèse en sciences de l’environnement de Julien Fortier, sous la direction de Daniel Gagnon (CEF UQAM) et la codirection de Benoit Truax (Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons-de-l’Est). Le jury de thèse était formé de Robert Bradley (évaluateur externe, Université de Sherbrooke), Annie DesRochers (évaluatrice interne, UQAT), Christian Messier (président du jury, UQAM) et des deux codirecteurs du candidat. Julien Fortier est parmi les rares à avoir réalisé l’exploit de terminer un doctorat en trois ans.
La thèse de Julien Fortier constitue une contribution majeure en environnement, dans un domaine (les plantations de bandes riveraines d’arbres en vue de contrer la pollution agricole diffuse) très peu étudié au Québec et dans l’est de l’Amérique en général, malgré son importance. La thèse montre clairement l’efficacité de bandes, relativement étroites, de peupliers hybrides à capter l’azote et le phosphore provenant des sols agricoles adjacents. Les volumes de bois obtenus (à 40 m3/ha/an, les plus élevés jamais mesurés au Québec) montrent aussi que les bandes riveraines pourraient être une source importante de bois et de biomasse pour le Québec, tout en réduisant efficacement la pollution agricole diffuse, et tous les problèmes qui y sont associés, en commençant par les blooms de cyanobactéries toxiques qui affligent plusieurs cours d’eaux et lacs du sud du Québec depuis les dernières années. Aussi, la séquestration importante de carbone par ces bandes a une valeur environnementale immédiate, et pourrait avoir une valeur économique dans le futur (crédits de carbone). La thèse montre également que le spectre des « méchants peuplier hybrides exotiques » sur la diversité végétale en milieu riverain se révèle être une idée sans fondement. Au contraire, les bandes riveraines de peupliers hybrides, en créant de l’ombre, ont réduit la biomasse et le recouvrement des espèces introduites (ou exotiques) trouvées en sous bois, car la plupart sont intolérantes à l’ombre, sans toutefois avoir eu d’effet négatif sur les espèces indigènes du sous bois, incluant les espèces indigènes des milieux humides.
Félicitations donc à Julien Fortier, qui a trouvé le moyen de dégonfler plusieurs « balounes » d’un seul coup avec sa thèse et ses quatre articles. Les multiples services écosystémiques et économiques des bandes riveraines sont bien illustrés et discutés dans cette thèse. La contribution de Julien Fortier est directement applicable à des objectifs importants en qualité des eaux, en production de bois et de fibres, ainsi qu’en conservation. Ceci décuple sa valeur sociétale et justifie parfaitement l’obtention du doctorat en sciences de l’environnement.
Les deux premiers chapitres de la thèse de Julien Fortier sont déjà publiés dans Biomass & Bioenergy (doi:10.1016/j.biombioe.2010.02.011) et Agriculture, Ecosystems and Environment (2010; vol. 137: 276-287).
19 mai 2010
Entente sur la forêt boréale canadienne: qu'en est-il exactement?
Texte par Mélanie Desrochers
Le 18 mai dernier, 21 sociétés membres de l'Association des produits forestier du Canada (APFC) et neuf grands organismes environnementaux ont dévoilé une entente historique qui couvre 72 millions d'hectares de forêts boréales publiques aménagées par les membres de l'APFC au Canada (soit deux fois la superficie de l'Allemagne), dont 16 millions d'hectares au Québec. Cette entente vise à mettre en place un moratoire de coupe et de construction de chemins pendant trois ans sur près de 29 millions d'hectares de forêt boréale, dont 8,5 millions se trouvent au Québec. En échange, les ONGE acceptent de mettre fin aux campagnes de boycott des produits forestiers non durables.
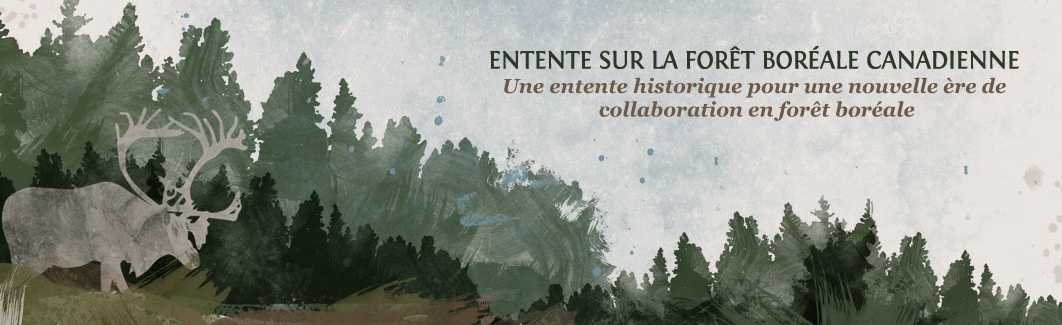
Près de deux ans ont été nécessaires pour que ces groupes antagonistes arrivent à une entente. Selon Avrim Lazar, président et chef de la direction de l'APFC "Le vieux paradigme dans lequel évoluaient les sociétés membres de l'APFC et les ONGE a été complètement réinventé. Ils ont défini ensemble une manière plus ingénieuse et plus productive de gérer les défis économiques et environnementaux associés à la forêt boréale, ce qui rassurera les acheteurs internationaux quant au caractère durable de nos produits".
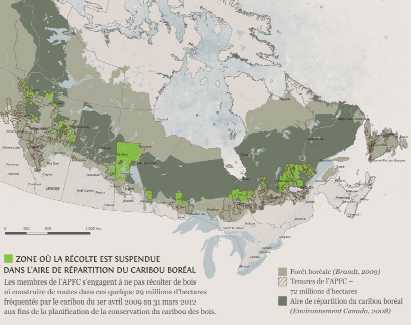
Territoire canadien couvert par l'Entente
Pendant les trois prochaines années du moratoire, les acteurs doivent mettre en œuvre un plan d'action sur 60 points, lequel sera évalué par un tierce parti indépendant qui rendra public ses rapports. Parmi les objectifs à atteindre, notons:
- l'élaboration et l'application de meilleurs pratiques d'aménagement forestier durable parmi les meilleures au monde
- la formulation de propositions conjointes d'aires protégées et le rétablissement d'espèces en péril, notamment le caribou forestier (espèce menacée au Canada et à statut vulnérable au Québec)
- une démarche qui tient compte de tout le cycle de vie des produits et leur empreinte carbone
- une plus grande prospérité économique pour les collectivités forestières et la reconnaissance sur le marché international des avancées au chapitre de la conservation
Au Québec
Au Québec, les principaux acteurs visés sont les compagnies forestières Tembec, Abitibi-Bowater, Louisiana-Pacific et Kruger. Suite aux négociations, les industriels et les groupes environnementaux ont ciblé, sur le territoire couvert par l'Entente sur la forêt boréale (en jaune sur la carte), de suspendre les activités d'aménagement sur 8,5 millions d'hectares (en rouge sur la carte). Un œil aiguisé remarquera que de nombreux territoires de coupes prévus aux plans d'aménagement pour 2010, 2011 et 2012 situés dans la zone rouge seront tout de même coupés.
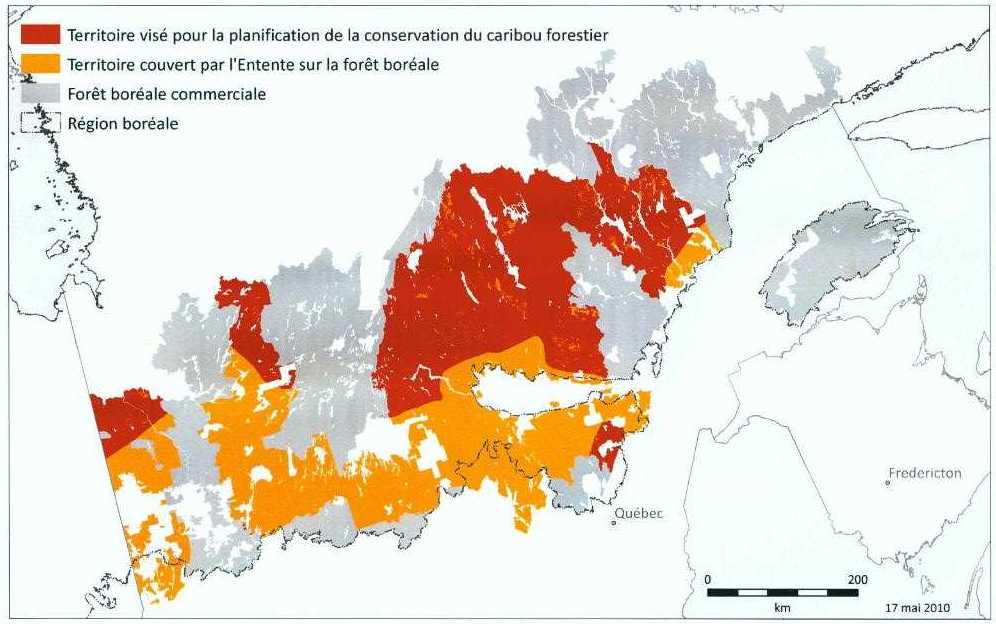
Territoire québécois couvert par l'Entente
Comme l'indiquait M. Patrick Nadeau de la SNAP lors de la conférence de presse, il s'agit d'un bon moment pour annoncer cette entente. Avec la venue de la nouvelle Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, l'engagement du gouvernement de passer de 8 à 12 % d'aires protégées au Québec et l'annonce du Plan Nord qui prévoit notamment la protection de 50 % du territoire au nord du 49e parallèle, c'est le moment d'identifier les forêts intactes et les habitats cruciaux pour les espèces menacées, et ce à temps pour les plans d'aménagement de 2013-2018.
Et la recherche dans tout ça?
Ce hiatus de trois ans devra permettre aux acteurs de se mettre à jour sur les récents travaux de recherche qui permettront de mieux cibler les territoires à protéger AVANT qu'il ne soit trop tard. Rappelons que la zone boréale de la forêt commerciale n'est protégée qu'à 5 % et qu'il ne reste que très peu de forêts intactes. Ces massifs forestiers sont indispensables pour la protection de la biodiversité. Selon Alain Leduc, chercheur à l'UQAM, membre du CEF et récent co-récipiendaire d'une subvention de recherche sur les massifs forestiers avec Pierre Drapeau et Louis Imbeau, "cette entente devrait permettre le développement d'une stratégie de récolte qui soit plus respectueuse des enjeux de biodiversité associés à l'existence de ces massifs".
De plus, la recherche mise en place par les équipes caribou des différentes institutions (Daniel Fortin à l'Université Laval, Pierre Drapeau à l'UQAM, Claude Dussault au MRNF, etc.) pourra donner des pistes de solution qui permettront d'identifier les aires cruciales d'habitat nécessaires à leur survie et aussi, à mieux comprendre les effets de l'aménagement sur les caribous forestiers.
Cette entente historique reflète bien le chemin parcouru en termes d'aménagement forestier durable depuis la dernière décennie. Les notions d'aires protégées, d'aménagement écosystémique, de résilience des forêts et de protection de la biodiversité sont maintenant ancrées dans le vocabulaire forestier et devront maintenant se traduire sur le terrain. Cette démarche permettra de positionner l'industrie forestière canadienne comme un chef de file en matière de durabilité. Enfin un souffle d'espoir sur ce secteur qui se relève tout doucement de son état de crise! Rappelons que l'industrie forestière au Québec c'est plus de 200 000 emplois liés à la forêt et un PIB de 6,2 milliards de dollars (soit 2,5 % du total provincial).
Bien que nos connaissances soient encore minces en termes de conservation du patrimoine forestier, cette Entente nous donne des outils et du temps pour palier à ce manque. Par ce moratoire de trois ans, les acteurs reconnaissent l'importance de protéger avant d'exploiter. À en voir les réactions à travers les médias internationaux (NY Times, BBC, Le Guardian, Financial Times, etc.), cette décision vient de mettre le Canada à l'avant plan pour devenir le chef de file mondial en matière d'aménagement durable du territoire.
Documents et sites webs
- Site de l'Entente

- Principaux éléments de l'Entente sur la forêt boréale canadienne

- Entente sur la forêt boréale canadienne: version abrégée

- Fiche d'information sur le Québec forestier

Médias et Réactions
31 mai 2010
Texte d'opinion: L’un des principaux problèmes de cette entente du 18 mai dernier, pompeusement qualifiée d’historique, réside dans le fait qu’elle s’est négociée par-dessus l’État fiduciaire des forêts, et sans la participation des communautés autochtones et non autochtones qui vivent du, et dans le territoire forestier. (Silva Libera)
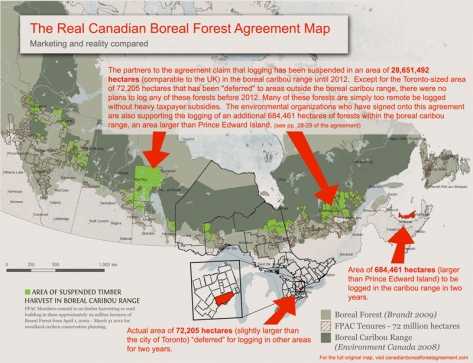
27 mai 2010
- The Canadian Boreal Forest Agreement Reconsidered

A critique of the recent Boreal Forest Agreement between FPAC industries and major ENGOs: In return for swapping 72,205 hectares of harvesting out of the boreal forest and maintaining “voluntary deferrals” for another two years, the CBFA transforms the nine ENGOs involved into a promotional service, protection racket and intelligence gathering service for twenty one companies that are actively logging woodland caribou habitat within the boreal forest. (Dominian) - Une entente historique pour qui? (lettre d'opinion d'Henri Jacob de l'Action Boréale)

21 mai 2010
- L'APNQL accueille favorablement l'entente pour la protection de la forêt boréale et réaffirme les droits des Premières Nations sur le territoire (CNW)

- Nishnawbe Aski Nation (NAN) says new national boreal forest agreement disrespects First Nations rights (NAN)

- Entente sur la forêt boréale: Richard Desjardins dénonce (Radio-Canada)

20 mai 2010
- Protection de la forêt boréale - L'entente historique sème la discorde chez les écologistes (Le Devoir)

- Richard Desjardins pourfend Greenpeace (La Presse)

- Forêt boréale: Une entente qui ne plaît pas à tous (Radio-Canada)

- '''Forêt boréale: l'entente de préservation suscite le scepticisme avec citation de Louis Bélanger (La Presse)

19 mai 2010
- Entente Forêt boréale: Grand reportage au Téléjournal (Radio-Canada)

- Entente Forêt boréale: entrevue avec Luc Bouthillier (Radio-Canada)

- Forêt boréale: Forestières et écologistes s'entendent (Radio-Canada)

- Groupes écolos et compagnies forestières s'entendent sur la forêt boréale (Rue Frontenac)

- La paix revient en forêt (Le Devoir)

- Tree huggers, hewers cut a deal (The Gazette)

- Timber groups in pact with activists (Financial Times)

- 170 million acres of Canada's boreal forest to be saved (USA Today)

- Canadian Loggers and Enviro Groups Call Truce, Will Craft Plan for 180M Forest Acres (NY Times)

- Canadian logging campaigners end protest with unprecedented forest truce (The Guardian)

- 'World's biggest' forest protection deal for Canada (BBC)

- Pact protects Canadian forests avec citation de Hank Margolis (Nature News)

- 'Stunning' forest-protection deal met with caution in B.C. Critics: Plan hasn't halted logging of caribou habitat; oil and gas industry not covered (The Province)

- With newly protected boreal forest, the caribou are smiling (Globe & Mail Editorial)

- Forest shakedown (National Post Editorial)

- Forest companies and environmentalists agree to save boreal forest (Toronto Star)

- Caribou still at risk under historic forestry deal (Vancouver Sun)

- La FQM salue l'accord sur la conservation de la forêt boréale

- Conservation de la forêt boréale - La CSN salue l'entente intervenue entre l'industrie forestière et les groupes environnementaux

- Le plus important accord au monde en matière de conservation est de bon augure pour l’avenir, selon Michael Ignatieff (Parti Libéral)

- Entente sur la forêt boréale canadienne - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec endosse ces objectifs (OIFQ)

- Entente sur la forêt boréale au Canada (Ma Terre)

- Entente historique de préservation des forêts du Québec (La Presse)

- Logging ‘truce’ protects millions of acres of Canadian forest (The Star)

18 mai 2010
- Forêt boréale: les écolos et l'industrie s'entendent avec citation de Louis Bélanger (La Presse)

- Gestion de la forêt boréale - Une entente aurait été conclue entre les forestières et les écologistes (Le Devoir)

Organismes environnementaux (ONGE) participants
La Campagne internationale de conservation de la forêt boréale (projet du Pew Environment Group), Canopée, la Fondation David Suzuki, la Fondation Ivey, ForestEthics, Greenpeace, l’Initiative boréale canadienne, The Nature Conservancy et la Société pour la nature et les parcs du Canada.
Entreprises forestières participantes
Abitibi Bowater, Alberta Pacific Forest Industries, AV Group, Canfor, Cariboo Pulp & Paper Company, Cascades Inc., DMI, F.F. Soucy, Inc., Howe Sound Pulp and Paper, Kruger Inc., LP Canada, Mercer International, Mill & Timber Products Ltd, NewPage Port Hawkesbury Ltd, Paper Masson Ltee, SFK Pâte, Tembec Inc., Tolko Industries, West Fraser Timber Co. Ltd et Weyerhauser Company Limited, toutes représentées par l’Association des produits forestiers du Canada.
17 février 2010
Le CEF lance et compte!
Texte par Mélanie Desrochers, photos de Conny Garbe, Emmanuelle Fréchette et Nicolas Fauvart
Le 12 février dernier, une délégation de 43 membres du CEF se sont donné rendez-vous à l'Auditorium de Verdun pour assister au match d'hockey junior majeur opposant le Junior de Montréal ![]() aux Foreurs de Val d'Or
aux Foreurs de Val d'Or ![]() . Cette activité a attiré nombreux étudiants étrangers provenant d'Algérie, de France, d'Autriche, de Belgique, d'Espagne, d'Allemagne et du Plateau Mont-Royal.
. Cette activité a attiré nombreux étudiants étrangers provenant d'Algérie, de France, d'Autriche, de Belgique, d'Espagne, d'Allemagne et du Plateau Mont-Royal.
Malgré la défaite du club local au compte de 3-2, nous avons été témoin d'un match enlevant. Pour certains, l'attrait de la poutine et des hot-dogs était plus grand que le match comme tel! Certains ont même eu la chance de gagner nombreux prix de présence (sac à dos, bonbons et becs de mascotte!). Mathieu Neau, stagiaire arrivé au CEF il y a quelques semaines seulement, a même décrit son expérience "typiquement québécoise" dans son blog aggrémenté de photos ![]() . Intéressant de voir une partie d'hockey du point de vue d'un étranger!
. Intéressant de voir une partie d'hockey du point de vue d'un étranger!
La soirée s'est poursuivie au Karaoké de Pointe-St-Charles où plusieurs ont démontré leurs talents artistiques (l'auteur a préféré vous faire grâce des photos prises à cette heure tardive de la nuit!).
Un gros merci à tous pour cet immense succès de participation!
Cliquez sur chaque image pour l'agrandir.