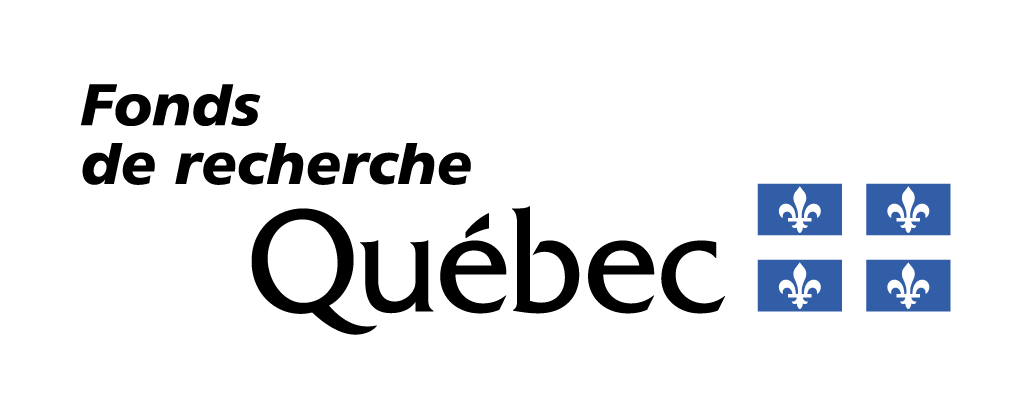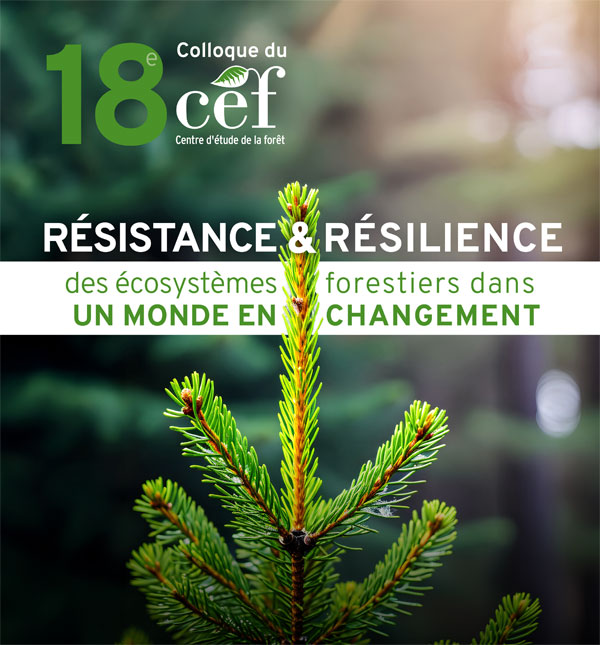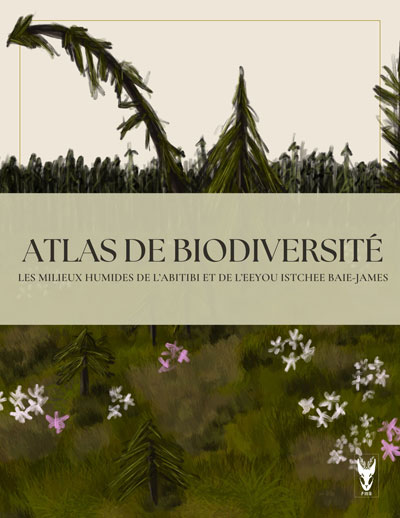Résumés des présentations et horaire (par ordre chronologique)
Sauter à la section affiches | Retour à la page du Colloque
Antoine Kremer
Institut National de Recherche pour l'Agronomie, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE), Université de Bordeaux
PDF non disponible
Bloc 1 -
Session Conférence principale #1
Grande Salle #1 - 08h30
L'accélération du climat suscite-t-elle une accélération de l'évolution biologique des arbres ? Cette question est au centre des préoccupations actuelles des scientifiques et des gestionnaires des forêts. Si plus d'un siècle d'expérimentation en génétique forestière a clairement mis en évidence des divergences adaptatives entre populations actuelles au sein des espèces, on manque cruellement de données expérimentales sur la vitesse à laquelle cette adaptation s'est mise en place. Et par voie de conséquence, on a peu d'éléments pour répondre à la question liminaire. Ma présentation portera sur les changements évolutifs récents observés à différentes échelles de temps chez les chênes blancs européens, au cours de changements climatiques bien documentés. Elle s'attachera à estimer le rythme et la direction de l'évolution en cours tout en identifiant les mécanismes à l'œuvre contribuant à l'évolution adaptative des arbres.
Mots-clés: climat, génétique
Alexandre Pace
Étudiant.e au doctorat
Université Concordia
Bloc 10 -
Session Dendrochronologie
Salle C0416 - 13h30
Les cédrières riveraines étaient autrefois un type de forêt abondant dans le sud du Québec. Après 200 ans de foresterie dans la région, beaucoup de ces forêts de cèdres n'ont pas été rétablies, mais dans la forêt mixte des contreforts appalachiens du Bas Saint-Laurent, quelques cédrières reliques subsistent. En utilisant les arbres subfossiles dans le fond d’un lac dans cette région, nous avons développé une chronologie de 814 ans des largeurs des cernes d’une cédrière, révélant l'histoire des perturbations de cette forêt et l'histoire climatique de la région. Les échantillons suggèrent une récupération constante et régulière de cette cédrière après un incendie au début du millénaire jusqu'au 19e siècle. Près de deux décennies avant que l'exploitation forestière arrive dans la région, une perturbation majeure s'est produite au début du 19e siècle et la forêt a subi un changement de composition majeur. La perturbation a éliminé presque complètement le recrutement de subfossiles dans le lac et a provoqué un relâchement de croissance chez les quelques subfossiles qui ont continué à être recrutés, suggérant une récupération post-incendie de cette cédrière. Les cèdres qui ont émergé après montrent des relâchements beaucoup plus forts en lien avec certaines périodes d'épidémies d'insectes, en particulier dans les années 1980. D'autres patrons croissance montrent des changements importants dans la forêt riveraine. Les patrons de bois de réaction partagés parmi les subfossiles démontrent les périodes de perturbations sur certaines sections de la rive, liées à l'activité des castors et à des tempêtes. Les cicatrices de glace sont particulièrement marquées au cours du 16e siècle, suggérant des changements dans le régime hydrologique qui ont affecté la forêt riveraine à cette époque, possiblement liés à la méga-sécheresse observée dans les reconstructions climatiques à travers l'Amérique du Nord. Notre compréhension de l'étendue de cette méga-sécheresse est approfondie par la sensibilité à l'humidité des forêts de cèdre de la région, permettant une longue reconstitution à basse-fréquence de l'humidité avec des connexions importantes aux autres longues reconstitutions dans l'est de l'Amérique du Nord.
Mots-clés: dendroclimatologie, ligne d'arbres, forêt subalpin, reconstitution climat,
Jonathan Lesven
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Laurent Millet (Université de Franche-Comté)
- François Gillet (Université de Franche-Comté)
- Thomas Suranyi (Université de Montréal)
- Augustin Feussom Tcheumeleu (Université de Montréal)
- Lisa Bajolle (UQAT)
- Yves Bergeron (UQAT)
- André Arsenault (RNCan)
- Cécile Remy (UQAT)
- Adam Ali (Université de Montpellier)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Dynamique forestière
Grande Salle - 13h30
Comprendre l’évolution à long terme des écosystèmes forestiers boréaux nécessite de démêler les interactions complexes entre les forçages climatiques, les régimes de perturbation et la dynamique de la végétation. Cependant, les incertitudes associées aux reconstitutions paléoclimatiques compliquent l’évaluation précise des réponses passées des écosystèmes. Dans cette étude, nous présentons des reconstitutions de température basées sur les assemblages polliniques et de chironomes provenant de cinq sites situés dans les forêts boréales de l’est du Canada. Notre objectif est d’évaluer les sensibilités et les limitations de ces indicateurs, avant d’utiliser ces évaluations pour affiner l’histoire climatique de l’est du Canada au cours des 9000 dernières années. Les résultats montrent que les estimations de température basées sur le pollen sont influencées par des facteurs tels que les feux de forêt, les décalages migratoires, et des estimations imprécises des optima thermiques des espèces, des biais qui varient fortement selon les zones de végétation étudiées. En revanche, les reconstitutions basées sur les chironomes s’alignent généralement mieux avec les tendances climatiques régionales, bien qu’elles restent sensibles aux conditions spécifiques des lacs étudiés. En nous appuyant sur ces résultats, nous affinons l’histoire climatique de l’Holocène dans l’est du Canada, en résolvant les divergences avec des études antérieures et en fournissant des estimations plus précises des variations de température lors de périodes clés telles que la déglaciation, l’Optimum Climatique de l’Holocène et la période Néoglaciaire. Ces résultats approfondissent notre compréhension des dynamiques climatiques à long terme dans les écosystèmes boréaux, et offrent des perspectives précieuses pour démêler l’impact du climat et des régimes de perturbations sur la dynamique de la végétation en contexte de changements climatiques.
Mots-clés: Pollen, Chironome, Température, Feux de forêt, Holocène, Québec-Labrador
Tony Franceschini
Collectif Régional de Développement du Bas-Saint-Laurent
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Mammifères
Mammifères - 13h30
Le modèle de qualité de l'habitat (MQH) évalue le potentiel d'habitat pour le cerf de Virginie en fonction des caractéristiques des peuplements forestiers. Il est utilisé pour guider les interventions forestières en faveur de cette espèce. Le projet visait trois objectifs : valider la classification d'habitats par le MQH, comparer ses résultats avec les indices de présence du cerf de Virginie, et évaluer l'impact des traitements sylvicoles sur ces indices. Quatre ravages de cerfs dans le Bas-Saint-Laurent ont été échantillonnés en 2023. Des inventaires de brout ont été réalisés en 2021 et 2022 De plus, des relevés de fèces et des survols aérien ont été réalisés dans les quatre ravages pour évaluer la présence et l'utilisation du territoire par les cerfs de Virginie. Ces données ont également été complétées avec des inventaires de brouts réalisés en 2021 et 2022. Les données cartographiques du 5e inventaire écoforestier du Québec méridional (IEQM) ont été utilisées. Les résultats montrent que le MQH, basé sur les données de l'IEQM présente une correspondance partielle de 74 % et une correspondance exacte de 57 % avec les données récoltées. Les peuplements de type « abri » sont les plus utilisés par les cerfs, avec une plus grande proportion de fèces et des réseaux de pistes plus proches de ces peuplements que des autres types de peuplement. Les coupes partielles et les éclaircies commerciales sont également fréquentées par les cerfs. De plus, parmi les peuplements perturbés, les plantations semblent plus utilisées par le cerf de Virginie que d'autres perturbations majeures, bien qu'une analyse plus approfondie soit nécessaire pour affiner ces résultats. Ce projet a validé la pertinence du MQH pour caractériser l'habitat du cerf de Virginie dans les ravages étudiés.
Mots-clés: Modèle de qualité d'habitat, cerf de Virginie, habitat, nourriture, abri, sylviculture, traitements sylvicoles
Zoé Ribeyre
Postdoctorant.e
UQO
Autres auteurs
- Pierrick Arnault (UQO)
- François Guillemette (UQTR)
- Tristan Monette (UQO)
- Tim Rademacher (University of Vermont)
- Morgane Urli (UQAM)
- Audrey Maheu (UQO)
- Frida Piper (Universidad de Talca, Chile)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Érable à sucre
Salle C0426 - 13h30
Plus de 70% de la production mondiale de sirop d’érable est québécoise, le secteur acéricole constitue donc un important pan de l’économie de la province. Les sécheresses estivales sont amenées à être plus longues et plus sévères au Québec, pouvant affecter la santé globale des arbres. L’impact des sécheresses estivales sur la production de sirop d’érable est très peu étudié, notamment dû au décalage temporel entre l’occurrence du stress et la période de récolte. Pourtant, l’été est la période où les arbres produisent leurs sucres et rechargent leurs réserves, indispensables à la production du sirop. Dans ce contexte, nous avons voulu vérifier si des sécheresses estivales successives impacteraient (i) le volume et la teneur en sucres de la sève récoltée, et (ii) les réserves en sucres racinaires de la saison de croissance précédente. Pour répondre à ces objectifs, des parcelles témoins ont été définies et un système d’exclusion des pluies a été installé de juin à septembre entre 2021 et 2024 dans des érablières de la forêt privée de Kenauk en Outaouais. Une cohorte de 34 arbres par traitement a été entaillée en 2024, et les racines de 10 arbres par traitement ont été échantillonnées en juin et en septembre 2023. Nos résultats révèlent une diminution de la teneur en sucre dans la sève récoltée au printemps 2024 des arbres sous exclusion par rapport aux témoins de 0.25 brix. En revanche, aucun effet du traitement n’a été observé sur les réserves racinaires de l’été précédent (2023). Le décalage observé entre l’impact du traitement sur la sève du xylème et sur les réserves des racines soulève la nécessité d’identifier plus clairement l’origine des sucres de la sève des érables à sucre. D'après nos résultats, l’augmentation projetée des sécheresses estivales avec les changements climatiques pourrait impacter la production acéricole en Outaouais.
Mots-clés: Érable à sucre, sécheresse estivale, sucre, changements climatiques
Nejm Eddine Jmii
Étudiant.e au doctorat
UQO
Bloc 10 -
Session Dynamique forestière
Grande Salle - 13h50
Les forêts évoluent continuellement sous l’influence des changements globaux, qu’ils soient climatiques, naturels ou anthropiques. Ces transformations modifient leur structure, leur composition et leur fonctionnement, influençant ainsi leur dynamique à long terme. À partir des vecteurs de transitions successives dans l’espace d’ordination de la composition, de la structure et de la fonction des placettes-échantillons permanentes, nous avons construit les champs de vecteurs des quatre principales végétations potentielles de la forêt tempérée du sud du Québec : l’érablière à bouleau jaune (FE3), l’érablière à tilleul (FE2), la bétulaie jaune à sapin (MJ2) et la bétulaie jaune à sapin et érable à sucre (MJ1). L’analyse des champs de vecteurs entre les périodes 1970-1997 et 1998-2022 a révélé plusieurs tendances marquantes. La reprise du sapin baumier après l’épidémie de la tordeuse des bourgeons d’épinette a été observée dans toutes les végétations potentielles, avec une régénération plus marquée dans la MJ1 et la MJ2, où le recrutement des feuillus a également été plus important. Par ailleurs, le hêtre à grandes feuilles a connu une expansion notable après des perturbations faibles à modérées, particulièrement dans la FE2 et la FE3, où la régénération des feuillus intolérants et mi-tolérants s’est aussi révélée plus marquée. En parallèle, une baisse du recrutement et un ralentissement de l'accroissment des petites classes de diamètre de l’érable à sucre ont été observés dans la FE3. Bien que les patrons classiques de succession et de régénération soient toujours présents, ces résultats suggèrent que des changements pourraient émerger dans les composantes de l’identité écosystémique. En intégrant le champ de vecteurs à l’analyse de la dynamique forestière et des trajectoires écologiques, notre approche constitue un outil novateur pour mieux identifier les transformations en cours et adapter les stratégies de gestion en vue de préserver la stabilité et la résilience des écosystèmes forestiers.
Mots-clés: Changements globaux, forêt tempérée, végétations potentielles, identité écosystémique, dynamique forestière, perturbations, transitions, champs de vecteurs.
Rachana Bhandari
Étudiant.e à la maîtrise
UQAC
Autres auteurs
- Roberto Silvestro (UQAC)
- Sara Yumi Sassamoto Kurokawa (UQAC)
- Sergio Rossi (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Érable à sucre
Salle C0426 - 13h50
Recent studies on sugar maple (Acer saccharum Marsh.) have focused on sap phenology and its response to climate change, as well as growth processes given their role in carbon sequestration. Yet the phenological and functional relationships between these processes remain unclear. We studied the timings of phenological events in sugar maple, including sap production, xylem functioning, and growth during 2018 to 2022 in Simoncouche, QC, Canada. Sap exudation marked the first phenological event, starting from late March to mid-April, coinciding with the snowmelt, the increase in soil water content, and air temperatures fluctuating, with maximum temperatures rising above zero and minimum temperatures dropping below zero. The sap season ended when the freeze-thaw events disappeared, snowmelt was complete, and soil temperature warmed up. The ending of the sap season coincided with the functional reactivation of xylem and bud burst. On average, twelve days after the end of sap season, full leaf expansion marked the onset of active photosynthetic activity. Radial growth started one month after the end of the sap season. The dates of phenological events were correlated with each other, indicating a potential physiological link between them. The years with warmer spring (e.g., 2021) resulted in an earlier reactivation of maple, longer and higher growth, but no greater volume of sap production. The synchronism between the sap season and xylem reactivation suggests a functional link between the two processes, marking the shift from storage to utilization of carbon for the active growth and development. Since these phenological events are interdependent, shifts in their timing could affect tree carbon allocation, productivity, and ultimately the stability of maple syrup production.
Mots-clés: phenology, growth, sap, climate
Rebecca Lacerte
Étudiant.e au doctorat
UQAR
Autres auteurs
- Christian Dussault (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Martin-Hugues St-Laurent (UQAR)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Mammifères
Mammifères - 13h50
Le réchauffement climatique est susceptible de contraindre les mammifères à utiliser davantage de stratégies de thermorégulation comportementale, par exemple utiliser des habitats plus frais ou réduire la chaleur corporelle produite par la locomotion. Notre étude vise à caractériser les comportements de thermorégulation chez l’ours noir (Ursus americanus), à ce jour peu connus, en évaluant l’impact des variations des conditions météorologiques sur leur comportement. Nous avons suivi 166 ours noirs par télémétrie GPS dans quatre domaines bioclimatiques du Québec entre 2015 et 2023. Le taux de mouvement (calculé à partir de localisations prises aux 2-3h), un indice du taux d’activité, nous a permis de déterminer un statut de déplacement (c.-à-d., mobile vs stationnaire). Pour évaluer les variations du rythme circadien, ce statut a été mis en relation avec l’heure et les conditions météorologiques locales (ERA5-Land Hourly) tout en considérant la variation confondante associée à l’habitat (p. ex. ressources alimentaires et topographie). La température influençait la probabilité de déplacement différemment selon l’heure de la journée. Lorsque comparé à des journées de température moyenne, la probabilité d’être mobile lors de journées chaudes était plus élevée à la fin de la nuit et en matinée (c.-à-d. lors des heures où la température est plus fraîche) et elle diminuait en après-midi lorsque la température est plus élevée. Notre étude permet de mieux comprendre les réponses des ours face aux conditions météorologiques. En effet, nos résultats suggèrent que lorsque le risque de stress thermique augmente, les ours utilisent des stratégies de thermorégulation comportementale visant la réduction de production de chaleur en diminuant leur probabilité de déplacement. L’utilisation d’une telle stratégie pourrait réduire le temps passé à s’alimenter, diminuer l’accumulation de réserves corporelles pour l’hivernation et ultimement réduire leur performance individuelle.
Mots-clés: Hyperthermie, rythme circadien, déplacements
Samuel Bouchut
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Dominique Arseneault (UQAR)
- Marc-André Lemay (UQAT)
- Fabio Gennaretti (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Dendrochronologie
Salle C0416 - 13h50
Les cernes de croissance des arbres sont des archives puissantes pour reconstituer la variabilité du climat au cours des siècles et des millénaires passés. Traditionnellement, la largeur des cernes et la densité du bois final sont les indicateurs les plus utilisés. Plus récemment, l'anatomie quantitative du bois est apparue comme un sous-domaine de recherche prometteur pour améliorer notre compréhension du fonctionnement des arbres en relation avec le climat. Plusieurs études dendroanatomiques et reconstructions climatiques utilisant des arbres subfossiles ont démontré une forte corrélation entre certains traits anatomiques, telles que l'épaisseur de la paroi cellulaire ou la taille du lumen, et la température ou les précipitations locales. L'un des réseaux dendrochronologiques les plus robustes pour la dendroclimatologie a été développé dans la taïga québécoise. En utilisant une nouvelle méthode automatisée pour mesurer les caractéristiques anatomiques du bois, nous avons étudié le potentiel de l'anatomie quantitative pour reconstituer le climat passé. Nous avons ainsi exploré le signal environnemental et la réponse climatique d'un ensemble d'arbres vivants de ce réseau pour plusieurs traits anatomiques du bois. Nos résultats préliminaires suggèrent qu'un signal commun significatif peut être extrait des chronologies de certains traits liés aux dimensions de la paroi cellulaire et du lumen. De plus, nous avons constaté que les caractéristiques liées à la paroi cellulaire sont très sensibles aux événements météorologiques extrêmes, tels que les vagues de froid et gels tardifs. Nos résultats suggèrent ainsi que les traits anatomiques du bois pourraient servir d'indicateurs climatiques robustes pour reconstituer le climat de périodes plus anciennes, avec potentiellement une réplication annuelle des arbres réduite par rapport à la largeur des cernes ou à la densité maximale du bois final.
Mots-clés: Anatomie quantitative du bois, reconstitution climatique, dendrochronologie
Joao Paulo Czarnecki de Liz
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Autres auteurs
- Nelson Thiffault (RNCan-Centre canadien sur la fibre de bois)
- Alexis Achim (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Érable à sucre
Salle C0426 - 14h10
Les changements climatiques (CC) posent des défis pour les pratiques forestières, nécessitant des mesures d’adaptation pour préserver les forêts et leurs services. La migration assistée (MA) est un outil clé pour soutenir l’adaptation des écosystèmes et maintenir la production forestière. Des études suggèrent que l’aire de répartition de plusieurs espèces d’arbres en Amérique du Nord pourrait s’étendre vers le nord sous l’effet des CC. L’approche courante modélise cette expansion à partir des caractéristiques abiotiques et du climat projeté des sites. Toutefois, les arbres s’intègrent dans un écosystème où les interactions entre espèces influencent son fonctionnement et sa résilience. Notre projet utilise l’érable à sucre (ERS) comme cas d’étude pour comparer la modélisation de son habitat fondée uniquement sur des variables abiotiques (climat, sol, topographie) avec une approche intégrant la valeur d’importance (VI) des espèces compagnes. La VI, indicateur synthétique basé sur l’abondance et la surface terrière des espèces, est reconnue comme étant corrélée à l’habitat des arbres. Nous avons modélisé la VI de l’ERS par régression Random Forest dans une zone de 863 km² à la limite nord de son aire de répartition, à l’écotone forêt tempérée-boréale du Québec. Le modèle basé sur des variables abiotiques (R² = 0.43) a identifié les caractéristiques du sol et la topographie comme principaux déterminants de la distribution spatiale de l’ERS, suivis des variables climatiques locales. En revanche, l’intégration des interactions biotiques (R² = 0.96) a montré que la VI des espèces compagnes devenait le facteur prédominant. Ces résultats suggèrent que la prise en compte des interactions biotiques améliore la capacité à prédire la distribution spatiale de l’ERS, apportant un éclairage sur les dynamiques écologiques et leur rôle potentiel dans la mise en œuvre de la MA.
Mots-clés: Migration assistée, interactions biotiques, modélisation d?habitat, érable à sucre, changement climatique
Lisa Nondier
Étudiant.e à la maîtrise
UQAR
Bloc 10 -
Session Dynamique forestière
Grande Salle - 14h10
Face aux changements globaux, les populations naturelles peuvent s’adapter aux nouvelles conditions locales ou migrer vers des habitats devenus plus favorables. Lors du dernier maximum glaciaire, les espèces boréales et tempérées ont persisté dans des refuges glaciaires abritant l’ensemble de la diversité génétique cruciale pour leur maintien et leur adaptabilité. Suivant la fonte des glaciers lors du réchauffement postglaciaire, les populations ont migré pour coloniser leur aire de répartition actuelle. Lors de cette migration, la théorie prédit une érosion de la diversité, notamment en raison d’effets fondateurs répétés au front d’expansion des populations.
Afin de mieux comprendre la dynamique éco-évolutive qui se déploie lors du processus de migration des espèces de conifères boréaux, nous avons étudié la variabilité génétique neutre et adaptative de l’épinette blanche (Picea glauca), l’épinette noire (Picea mariana) et du mélèze laricin (Larix laricina) le long d’une voie de colonisation postglaciaire. L’épinette blanche et le mélèze sont actuellement en expansion à leur limite nordique, alors que la limite de l’épinette noire est stable depuis 4500 ans.
La diversité génétique neutre des trois espèces ne change pas le long du gradient latitudinal. Toutefois, la diversité génétique adaptative augmente localement à la limite nordique de l’épinette blanche et du mélèze, mais pas de l’épinette noire. Parmi les marqueurs adaptatifs, on retrouve une proportion plus élevée de marqueurs dont la fréquence de l’allèle mineur est aberrante à la limite nordique pour l’épinette blanche et le mélèze comparativement à l’épinette noire. Une association génotype-phénotype indique que la capacité de dispersion des graines est élevée chez les individus d’épinette blanche porteurs de l’allèle mineur à ces marqueurs aberrants, lesquels sont plus abondants à la limite nordique de l’espèce. Ce phénomène n’est pas observé chez l’épinette noire. Ces résultats suggèrent une dynamique éco-évolutive de tri spatial à la limite nordique de l’épinette blanche.
Mots-clés: migration postgraciaire, adaptation locale, tri spatial, conifères boréaux, génomique des populations
Nourrédine Anaoura Fodi
Étudiant.e à la maîtrise
Université de Sherbrooke
Bloc 10 -
Session Dendrochronologie
Salle C0416 - 14h10
Malgré que les microhabitats dendrologiques (MHD) soient importants pour la biodiversité, ils demeurent méconnus dans les forêts tempérées du sud Québec. De plus, on ignore l’impact de l’aménagement forestier sur ceux-ci. L’objectif principal de l’étude était d’évaluer l’importance des différents MHD en tenant compte des caractéristiques des peuplements, des sites et du mode de gestion. Pour ce faire nous avons comparé les cortèges en MHD inventoriés dans des placettes d’un ¼ ha de forêts non-gérées (15) et avec ceux de forêts gérées (10). Les peuplements non-gérés présentent une densité, une richesse et une diversité en MHD significativement plus élevée. Bien que la relation entre l’âge de la forêt, et la densité et la diversité en MHD ne soit pas systématique, le temps sans intervention favorise l’apparition de certains MHD plus fréquemment observés chez certaines vieilles forêts (microsol perché, sporophore pérenne, coulée de sève, lichen et plante épiphytique). En effet, pour plusieurs types de MHD, la probabilité d’occurrence est plus élevée pour les arbres morts debout et les chandelles et augmente en fonction du diamètre de l’arbre. Ces résultats orientent sur le choix des MHD indicateurs de vieilles forêts et démontrent l’importance d’avoir des peuplements en libre gestion pour la biodiversité.
Mots-clés: Microhabitats dendrologiques, biodiversité forestière, vieille forêt, forêt aménagée, aménagement forestier écosystémique, Typologie, Végétation potentielle
Sophie Lavoie
Étudiant.e à la maîtrise
UQAR
Autres auteurs
- Christian Dussault (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Claude Samson (Parcs Canada)
- Martin-Hugues St-Laurent (UQAR)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Mammifères
Mammifères - 14h10
Les changements climatiques modifient les milieux naturels et plusieurs espèces s’y adaptent avec difficulté. Pourtant, certaines, comme l’ours noir (Ursus americanus), pourraient bénéficier de ces changements. Les végétaux, leur principale source de nourriture, bénéficieraient de meilleures conditions de croissance, offrant aux ours davantage d’opportunités alimentaires. De plus, une saison de croissance plus longue en raison d’un hiver plus tardif permettrait aux individus se nourrir plus longtemps avant l’entrée en tanière. Les individus auraient alors l’opportunité d’accumuler davantage de réserves avant l’hivernation, favorisant leur survie et permettant aux femelles d’améliorer leur succès reproducteur. Cependant, rares sont les populations suivies sur une période suffisamment longue pour documenter les effets des changements climatiques sur leur condition physique. Nous avons mis à profit des données amassées au Québec de 1983 à 2023 le long d’un gradient latitudinal allant de l’érablière à la pessière à mousses (ca. 600 km) pour évaluer les effets des conditions météorologiques locales sur la condition physique de l’ours noir. La masse des ours, ajustée pour la date, le sexe et le statut reproducteur, était positivement corrélée à la proportion de coupes forestières 11-20 ans et de forêts matures productrices de fruits durs, mais également négativement reliée au nombre d’heures de gel au printemps et à l’aridité des étés, deux indices climatiques liés à la productivité alimentaire. Nos résultats mettent en évidence la contribution du climat aux variations d’un trait d’histoire de vie important chez l’ours noir et permettent d’entrevoir les implications des changements climatiques à venir pour la gestion et à la conservation de l’espèce au Québec.
Mots-clés: ours noir, condition physique, conditions météorologiques, habitat, méta-analyse
Anthony St-Jean
UQAR
Bloc 10 -
Session Dynamique forestière
Grande Salle - 14h30
À l’échelle mondiale, on enregistre depuis quelques décennies la progression en altitude de plusieurs populations d’espèces de plantes exotiques naturalisées (PEN), ce qui représente un enjeu pour le maintien de l’intégrité des milieux naturels. Les facteurs qui favorisent la colonisation des PEN dans leurs nouveaux territoires sont multiples. Nous avons mesuré la distribution des PEN du parc national de la Gaspésie (PNG) et évalué le rôle 1) des conditions environnementales et 2) de la plasticité phénotypique dans le processus de colonisation. Il y a 107 espèces de PEN comprenant plus de 1,7 milliard d’individus dans le PNG. Notre analyse historique démontre une augmentation de 1000% de la richesse des PEN en 70 ans. Les colonies PEN possèdent les valeurs maximales tant en effectif qu’en richesse spécifique dans les sources de basses altitudes et il s’en suit une diminution graduelle de ces variables le long des sentiers. Nos résultats indiquent que les conditions environnementales des sites colonisés par les PEN sont semblables à celles de sites sélectionnés au hasard en raison de l’érosion de la couche organique du sol. L’environnement érodé des sentiers ne présente donc pas de limitation à la colonisation des PEN. Les espèces apparentées de PEN affichent des stratégies fonctionnelles différentes pour coloniser l’espace. Les résultats de notre analyse de piste indiquent des tendances directionnelles dans les traits phénotypiques mesurés le long du gradient d’altitude. Par exemple, la reproduction végétative augmente en altitude. Cette dernière peut avoir un effet direct ou indirect sur les traits et ultimement le nombre de fruits par plantes, notamment par le biais de variables environnementales telles que le couvert de canopée et l’épaisseur de matière organique. Le développement anthropique du massif gaspésien, les conditions environnementales favorables et l’ajustement phénotypique modulant le caractère invasif expliquent l’expansion des PEN dans ce territoire montagnard.
Mots-clés: colonisation, gradient d?altitude, plante exotique naturalisée, conditions environnementales, traits fonctionnels
Fabien St-Pierre
Étudiant.e au doctorat
UQAR
Autres auteurs
- Ève Rioux (Pêches et Océans Canada)
- Jean-Pierre Tremblay (Université Laval)
- Martin-Hugues St-Laurent (UQAR)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Mammifères
Mammifères - 14h30
Comprendre comment les variations environnementales influencent les relations entre des herbivores ayant des niches écologiques similaires est crucial pour anticiper les effets des changements globaux. Notre étude vise à quantifier le chevauchement des niches isotopiques de l’orignal et du cerf de Virginie et d’évaluer comment la composition de l’habitat influence la variabilité isotopique. Nous avons récolté 206 échantillons de poils d’orignaux et 46 de cerfs au Bas-Saint-Laurent (Québec) pour estimer la largeur des niches isotopiques à partir d’ellipses bayésiennes à 40% et 95%. Nous avons aussi calculé diverses métriques pour les relier à la composition de l’habitat pour chaque individu. Nos résultats montrent une absence de chevauchement du cœur des niches isotopiques (ellipses bayésiennes 40%) et un chevauchement de 25% pour l’entièreté des niches (ellipses bayésiennes 95%), suggérant un potentiel modéré de compétition alimentaire. Les orignaux avec une signature isotopique distincte des autres orignaux montraient des valeurs plus faibles en δ13C et une plus grande proportion de forêts mixtes >20 ans autour du point d’abattage, suggérant une alimentation accrue dans les peuplements présentant une canopée fermée. Certains orignaux avaient une signature isotopique présentant des valeurs plus élevées en δ15N, liées à une plus grande proportion de peuplements résineux d’âge 20-50 ans et de coupes ≤5 ans autour du point d’abattage. Ce résultat suggère une alimentation similaire à celle des cerfs dans les peuplements où la disponibilité alimentaire est plus faible. Nos résultats montrent que la composition de l’habitat et les activités anthropiques ont le potentiel de modifier les relations interspécifiques
Mots-clés: Niche isotopique, Variation individuelle, Interaction biotique, Cervidé
Jethro Katula Mumvudi
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Autres auteurs
- Valentina Buttò (UQAT)
- David Paré (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Osvaldo Valeria (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Érable à sucre
Salle C0426 - 14h30
Au Québec, comprendre la relation sol-productivité à l’échelle de l’arbre représente un défi. Ce défi englobe l’accès aux variables des sols de haute résolution spatiale et des effets des variables ontogéniques sur la productivité. Cette étude vise à identifier les variables des sols ayant un effet significatif sur la productivité de quatre espèces dans le sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’Est : Betula alleghaniensis (bouleau jaune), Acer saccharum (érable à sucre), Picea rubens (épinette rouge) et Abies balsamea (sapin baumier). L’étude s’appuie sur la base de données du Service canadien des forêts, comprenant 150 peuplements répartis dans la forêt Valcartier, selon les variables topographiques (pente, élévation, indice d’humidité). Dans ces peuplements, nous avons sélectionné les arbres dominants (codominants) isolé chacun dans une sous-placette de 5x5m. Chaque arbre avait les mesures des variables ontogéniques (âge, hauteur et taille de la couronne) et de la productivité (surface terrière moyenne entre 2009-2018). Dans chaque sous-placette, nous avons sélectionné les variables des sols dans les couches organique et minérale. Pour chaque espèce, une première régression linéaire a permis d’isoler les effets des variables ontogéniques et de la compétition sur la productivité. Les résidus obtenus ont servi comme variable réponse. La deuxième régression linéaire a mis en évidence l’effet positif du stock d’azote dans la couche minérale sur la productivité du bouleau jaune. Chez l’érable à sucre et le sapin baumier, l’acidité du sol a eu un effet négatif, auquel s’ajoute l’effet négatif de la pente chez le sapin baumier. Chez l’épinette rouge, l’eau disponible dans la couche minérale et l’élévation ont eu un effet positif, tandis que le limon a eu un effet négatif. Ces résultats contribuent à mieux comprendre la relation sol-productivité à fine échelle spatiale et fournissent des pistes pour adapter la gestion sylvicole aux exigences spécifiques des espèces.
Mots-clés: Relation sol-productivité, arbres, bouleau jaune, érable à sucre, fine échelle spatiale, forêt tempérée, Québec
Julie-Pascale Labrecque-Foy
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Marc-André Lemay (UQAT)
- Dominique Arseneault (UQAR)
- Fabio Gennaretti (UQAT)
- Miguel Montoro Girona (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Dendrochronologie
Salle C0416 - 14h30
L’augmentation de la fréquence des feux dans les pinèdes de pins blancs du Témiscamingue aux 19e et 20e siècles est souvent attribuée aux pratiques forestières, mais elle pourrait résulter des changements climatiques de la fin du petit âge glaciaire. Pour distinguer ces effets, des reconstitutions climatiques précises du climat du Témiscamingue sont nécessaires. Les cernes de croissance du bois de drave offrent une excellente précision temporelle. Cependant, les meilleurs proxys à utiliser pour les reconstitutions climatiques avec le pin blanc (largeur des cernes ou isotopes) restent inconnus. Cette étude vise à déterminer le proxy ou la combinaison de proxys de la croissance radiale du pin blanc offrant le signal climatique le plus fort sur différents types de drainage. La largeur des cernes de 60 pins blancs du parc national d’Opémican (30 sur sol à drainage rapide, 30 sur sol à drainage modéré) a été mesurée. La composition en isotope de carbone (δ13C) et d’oxygène (δ18O) a aussi été analysée sur cinq arbres par site pour la période 1950-2020. Les données climatiques ont été obtenues avec ERA5, et les fonctions de réponse ont révélé que les variables ayant le plus d’influence sur tous les proxys sont les précipitations et les températures de juin et juillet, indépendamment du type de drainage. Des modèles linéaires bayésiens ont révélé qu’une approche multi proxy combinant les isotopes de carbone et les largeurs de cernes présente le meilleur pouvoir prédictif pour les précipitations de juin et juillet (R=0.50). Pour les températures de juin et juillet, la combinaison des isotopes d’oxygène et des largeurs de cernes présente le meilleur pouvoir prédictif (R=0.48). Cette étude est l’une des premières en dendroclimatologie sur le pin blanc. Ces résultats sont cruciaux afin de mieux comprendre les facteurs ayant influencé le régime des feux et le déclin des pinèdes de pins blancs au Témiscamingue.
Mots-clés: Dendroclimatologie, Pinèdes de pins blancs, sensibilité climatique
Brendan Blanchard
Étudiant.e à la maîtrise
UQAR
Autres auteurs
- Robert Schneider (UQAR)
- Frédéric Lesmerises (UQAR)
- Martin-Hugues St-Laurent (UQAR)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Mammifères
Mammifères - 14h50
La sélection d’habitat réfère à une utilisation disproportionnée d’une ressource par rapport à sa disponibilité dans l’environnement. Chez les grands mammifères, elle s’appuie principalement sur des cartes dérivées de photographies aériennes ou satellitaires pour extraire des données environnementales et les relier aux localisations des individus. Au Québec, la carte écoforestière fournit des informations sur la composition en essences des forêts et est traditionnellement utilisée pour caractériser la sélection d’habitat chez les grands mammifères. Le LiDAR aéroporté permet de générer des métriques capturant la structure tridimensionnelle de la végétation, de la canopée jusqu’au sol, une technologie encore sous-exploitée dans la recherche sur la grande faune. Notre étude vise à déterminer si la combinaison de ces deux sources d’information améliore les prédictions de sélection d’habitat chez le caribou, l’orignal et le coyote. Nous avons caractérisé la sélection d'habitat en utilisant des régressions logistiques mixtes, les données de localisation GPS (1) des animaux ont été appariées à des points aléatoires (0) pour contraster respectivement l’utilisation à la disponibilité. Les modèles ont ensuite été évalué par une validation croisée. Les résultats montrent que coupler des données LiDAR à la carte écoforestière améliore les prédictions pour les espèces étudiées, bien que le gain varie selon les périodes biologiques, les aires d’étude ou les espèces. La carte écoforestière utilisée seule demeure un outil efficace et éprouvé pour étudier la sélection d’habitat mais le LiDAR aéroporté, utilisé indépendamment, peut offrir une alternative plus performante. La structure de la végétation apparaît parfois comme le facteur principal guidant les choix comportementaux des trois espèces. Ainsi, intégrer des données de structure de végétation dans les modèles de sélection d'habitat enrichit notre capacité de compréhension des décisions des grands mammifères dans les écosystèmes boréaux.
Mots-clés: Sélection d'habitat, carte écoforestière, LiDAR, grands mammifères
Denise Alano Bonacini
Étudiant.e à la maîtrise
UQAC
Autres auteurs
- Claudio Mura (UQAC)
- Nita Dyola (UQAC)
- Roberto Silvestro (UQAC)
- Patricia Raymond (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Sergio Rossi (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Érable à sucre
Salle C0426 - 14h50
La phénologie est essentielle pour évaluer l'impact des changements climatiques sur la croissance des forêts tempérées et boréales. Un réchauffement précoce accélère le débourrement, augmentant les risques liés aux gels tardifs, tandis qu'un hiver plus chaud peut retarder ce processus en empêchant de compléter les besoins de refroidissement. Nous avons simulé un réchauffement printanier sur des semis et des boutures d'érable à sucre (Acer saccharum) issus de deux provenances (Cantley et Duchesnay) au Québec. Leur débourrement a été évalué après transfert à 15 ou 20 °C à deux dates (jour julien 61 et 115), dans des conditions avec ou sans refroidissement artificiel (4 ou 7 °C). Les plantules transférées à 20 °C le jour julien 61 ont pris 12 jours de plus pour débourrer que celles transférées le jour julien 115. La provenance la plus nordique (Duchesnay) a débourré 11 jours plus tôt que la provenance du sud (Cantley). Un refroidissement à 7 °C suivi d'un forçage à 20 °C a accéléré le débourrement de 7 jours par rapport à un refroidissement à 4 °C et un forçage à 15 °C, et de 4 jours comparé à un refroidissement à 4 °C et un forçage à 20 °C. Aucune différence significative n’a été observée entre les boutures et les semis, ce qui démontre leur potentiel pour les études phénologiques. Nos résultats montrent que l’accumulation de froid à la fin de l’hiver et au printemps, ainsi que l’accumulation de chaleur au printemps, sont cruciales pour le débourrement de l’érable. Le réchauffement climatique risque d’avancer le débourrement, prolongeant la saison de croissance, mais accroît le risque de gel tardif. L’utilisation de provenances du sud, qui débourrent plus tard au respect aux provenances nordiques, pourrait limiter les dommages du gel printanier dans les nouvelles plantations d’érable à sucre.
Mots-clés: Phénologie, changements climatiques, refroidissement, débourrement, érable à sucre
José-Gabriel Yee Paré
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Hugues Power (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Mathieu Bouchard (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Dynamique forestière
Grande Salle - 14h50
La productivité forestière et la composition des paysages forestiers seront affectées par les changements climatiques (CC). Dans les forêts localisées dans la partie sud de la zone boréale, on s’attend que les espèces feuillues deviennent plus performantes et abondantes aux dépens des espèces résineuses. Il est donc probable que les CC auront des effets négatifs sur l’approvisionnement de bois d’œuvre provenant des régions boréales, particulièrement pour le bois résineux. Une stratégie d’adaptation proposée afin de maintenir la productivité des forêts est la migration assistée, soit le déplacement délibéré d’espèces ou de populations d’arbres par l’humain vers des emplacements ayant des conditions climatiques futures potentiellement favorables. Les objectifs de ce projet sont d’évaluer les conséquences sur les possibilités annuelles de coupes: (i) d’une réduction du volume disponible des espèces résineuses; (ii) d’un potentiel accru d’enfeuillement; (iii) de la migration assistée comme stratégie d’adaptation aux CC. Pour ce faire, nous avons intégré ces éléments dans des exercices de calcul de possibilité forestière réalisés sur 150 ans, pour une unité d’aménagement de la région de Charlevoix. Les exercices de calculs incluent l’effet de trois scénarios climatiques (climat historique, RCP 4.5 et RCP 8.5) et la migration assistée de deux essences (bouleau jaune, épinette rouge). Les résultats montrent que la récolte sera principalement déterminée par les peuplements actuellement présents sur le territoire au cours des 40 à 60 premières années de la modélisation, alors que les CC pourraient entrainer une réduction du volume disponible à cause de l'enfeuillement et d’un habitat moins favorable à certaines essences résineuses après cette période. Selon nos résultats, la migration assistée pourrait contribuer à maintenir les possibilités annuelles de coupes, particulièrement au niveau de la composante résineuse.
Mots-clés: Stratégie d'adaptation, modélisation, paysage forestier
Katherine Tripp
Étudiant.e à la maîtrise
UNB
Autres auteurs
- Shawn Fraver (University of Maine)
- Wendy Monk (UNB)
- Anthony Taylor (UNB)
- Loïc D'Orangeville (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 10 -
Session Dendrochronologie
Salle C0416 - 14h50
White spruce is a large part of the Atlantic Canada forestry industry, and its reported high sensitivity to drought and heat stress raises significant concerns for wood supply in the region. In this study, we take advantage of the recent drought that occurred during 2017-2021, the most severe in Atlantic Canada since the 1960s, to assess variations in drought sensitivity according to site and stand characteristics in an intensively managed forested landscape. A dendrochronology approach was used to assess the drought response of 600 trees across 32 plots that are 16-59 years old with a density range of 250-1900 trees·ha-1.
In line with long-term climate-growth analyses which indicate a negative sensitivity of white spruce growth hot, dry summers, we observed growth reductions up to 75% during the recent drought, although the species recovered quickly and mortality was not observed. Applying linear mixed models to compare stand and site factors, we find that tree size was the best predictor of growth response under drought, with larger trees showing growth declines up to 40% during drought. Interestingly, no effect of competition was detected, which may be due to the intensive thinning treatments applied in the study region. While the projected increases in drought and heat could be detrimental to white spruce productivity in Atlantic Canada, our results should help inform silviculture guidelines to better manage drought and prevent future growth declines.
Mots-clés: white spruce, dendrochrology, drought, climate change, boreal, maritimes
Monica Gagnier
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Evelyne Thiffault (Université Laval)
- Nelson Thiffault (RNCan-Centre canadien sur la fibre de bois)
- Michael Hoepting (RNCan)
- James Farrell (RNCan)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Effets des coupes
Effets des coupes - 15h20
La compétition végétale dans les plantations de pin blanc peut significativement compromettre leur succès d’établissement. En 2002, nous avons mis en place deux sites expérimentaux en Ontario et au Nouveau-Brunswick pour étudier les effets distincts de la compétition herbacée et arbustive sur les arbres plantés après une coupe progressive régulière. Vingt ans plus tard, nous avons comparé différents traitements visant à maîtriser la végétation : un témoin non traité, une maîtrise continue des arbustes ligneux pendant six ans, une maîtrise continue des plantes herbacées pendant six ans, une maîtrise combinée des plantes herbacées et des arbustes ligneux pendant la même période, ainsi qu’un contrôle unique de ces deux types de végétation au cours de la troisième saison de croissance. Nos résultats suggèrent que la gestion de la compétition influence les dimensions et la santé des pins blancs plantés et que les effets des différents traitements varient selon les régions étudiées.
Mots-clés: Pinus strobus, Compétition végétale, Maitrise de la végétation, Plantation
Omid Reisi Gahrouei
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Autres auteurs
- Luc Guindon (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Jean-François Côté (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Pauline Perbet (Université Laval)
- David Correia (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Martin Béland (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Télédétection
Salle C0416 - 15h20
Natural forest disturbances are integral to ecosystem dynamics around the world. Windthrow, a common abiotic disturbance in Canada, can significantly change forest structure and function. Detecting windthrow-affected areas is crucial for implementing appropriate treatments, such as salvage logging, and for understanding climate change impacts.
Remote sensing shows good potential for forest monitoring, but large-scale windthrow mapping remains challenging due to limited training data and similarities to other disturbances.
This study proposes a framework for detecting windthrow-affected areas by leveraging deep learning models. We created a training dataset across Canada using Northern Tornado Project data and applied various deep and machine learning models using Sentinel-2 summer composites (10m) from 2019 to 2024. We used approximately 20,000 hectares of windthrow-affected forest from more than 200 events to train the models, and 6,700 hectares for evaluating their performance.
The results show that the model incorporating spatial attention mechanisms, namely Coordination Attention Residual U-Net (CResU-Net), achieved the best performance, with an F1-score of 73.97% using test data from the May 2022 Canadian derecho. CResU-Net outperformed the other evaluated models (LinkNet, Deeplab, ResUnet, and RF) by approximately 3–40% in terms of F1-score.
We also implemented a protocol using the Continuous Change Detection and Classification (CCDC) approach to determine the optimal timestamp for areas detected by the deep learning model. Additionally, we created a windthrow map covering the province of Quebec from 2019 to 2024, which is currently being validated through photo interpretation using high-resolution Google Earth Pro images. The produced map captured the May 2022 Canadian derecho, as well as the affected area in December 2023 at Baie-Comeau and Baie Sainte-Laurent as highly affected areas between 2019 and 2024.
This approach can be used for large-scale windthrow mapping, supporting carbon budgeting efforts and improving our understanding of climate change impacts.
Mots-clés: Windthrow mapping, artificial intelligence, forest change detection, Sentinel 2
Rosario Guzmán Marín
Postdoctorant.e
Universidad Austral de Chile
Autres auteurs
- Matthias Mslati (UQAC)
- Jamie Warren (RNCan-CFGL)
- Eric Moïse (RNCan-CFA)
- Catherine Tremblay (UQAC)
- Valérie Néron (UQAC)
- Annie Deslauriers (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Tordeuse des bourgeons de l'épinette
Salle C0416 - 15h20
Depuis 2006, les infestations de la tordeuse des bourgeons de l'épinette constituent une préoccupation majeure pour les organismes responsables de la protection des forêts (ministères, industriels forestiers et usagers de la forêt, dont les Premières Nations). Pour limiter les dommages, les programmes de protection traitent les peuplements affectés par des pulvérisations de Bacillus thuringiensis variété kurstaki (Btk), appliquées lors de fenêtres temporelles optimales, déterminées par les modèles PhenoCaB (ouverture des bourgeons) et BioSim 11 (développement des larves). Toutefois, ces modèles ne prennent pas en compte les interactions dynamiques entre la phénologie de l’hôte et celle de l’insecte, ce qui pourrait influencer l’efficacité des interventions. L’objectif de cette recherche était d’analyser la composition chimique [teneur en eau (g·g?¹ poids sec), rapport C:N] et calorique (J) des bourgeons de sapin baumier, d’épinette blanche, d’épinette noire, ainsi que des larves de la tordeuse des bourgeons de l’épinette au cours de leur développement. Nous avons testé l’hypothèse selon laquelle le développement métabolique de la tordeuse dépend de la qualité nutritionnelle de chacun de ses hôtes. La méthodologie repose sur deux expériences de défoliation : l’une en chambre de croissance et l’autre en milieu naturel, avec des données recueillies à Pasadena, Terre-Neuve. Les résultats montrent des différences significatives dans la teneur en carbone et en azote des bourgeons entre les traitements et les espèces (p < 0.001), ainsi qu’une interaction entre le stade de développement, le traitement et l’espèce (p < 0.05). Le rapport C:N tend à augmenter dans les bourgeons défoliés, mais reste stable dans les aiguilles (différences non significatives). Une tendance similaire est observée pour les glucides, avec une diminution du saccharose et de l’amidon chez les bourgeons des arbres défoliés. Ces résultats contribueront au développement d’un modèle nutritionnel de croissance des larves, complémentaire à PhenoCaB.
Mots-clés: Choristoneura fumiferana (Clemens), Abies balsamea L. Mill, Picea glauca (Moench) Voss, Picea mariana (Mill.) B.S.P., physiologie, nutrients , temperature
Savannah Bissegger O'Connor
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Janani Sivarajah (Université Laval)
- Anne Bernard (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Foresterie urbaine
Foresterie urbaine - 15h20
Une proportion importante du couvert forestier urbain se trouve sur des terrains privés et résidentiels, échappant ainsi aux évaluations municipales systématiques. Nous avons envisagé que la science participative (aussi appelé science citoyenne) puisse contribuer à combler cette lacune, mais il était d'abord essentiel de vérifier la qualité des données recueillies par cette approche. Cette recherche avait donc pour objectif d'évaluer la fiabilité de la science participative comme outil de collecte de données dans un contexte de foresterie urbaine.
Dans le cadre d'un inventaire des arbres sur des terrains privés à Québec, les résident.e.s participant.e.s ont visionné dix capsules explicatives pour se familiariser avec les méthodes de collecte de données avant de réaliser leurs propres mesures sur leur terrain. En parallèle, notre équipe de recherche a effectué des mesures de référence. Nous avons ensuite effectué des tests statistiques pour comparer les mesures recueillies par les résident.e.s (non-experts) à celles de notre équipe (experts), en nous appuyant sur diverses caractéristiques des arbres.
Les résultats montrent qu'il n'existe aucune différence significative entre les mesures prises par les non-experts et celles des experts pour les variables étudiées. Ces résultats suggèrent qu'avec une formation simple, des non-experts peuvent fournir des données fiables dans un contexte de foresterie urbaine grâce à la science participative. Ils soulignent également la pertinence et la fiabilité de ces informations pour les municipalités et leurs partenaires, offrant ainsi une solution concrète pour pallier le manque de données sur les arbres en terrains privés.
Mots-clés: Validation des données, gestion collaborative, engagement communautaire
Pauline Perbet
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Autres auteurs
- Luc Guindon (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Jean-Françcois Côté (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Martin Béland (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Télédétection
Salle C0416 - 15h40
Les insectes ont un impact majeur sur la santé des forêts boréales. Il est essentiel de connaitre l'ampleur des attaques à l’échelle du Canada pour répondre à divers besoins, tels que la modélisation du carbone forestier. En utilisant des séries temporelles d'images satellites et des algorithmes d'apprentissage profond, nous avons développé une nouvelle carte des perturbations forestières à l’échelle du Canada pour la période de 1987 à 2024. Cette carte met en évidence les perturbations liées à une défoliation sévère des conifères. Cette présentation exposera la méthode, les défis associés et les analyses de qualité des données.
Mots-clés: Télédétection, insectes forestier, cartographie des perturbations, apprentissage profond, Landsat
Raphaël Grellety
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Bloc 11 -
Session Effets des coupes
Effets des coupes - 15h40
L’aménagement forestier durable dépend de méthodes de récolte du bois qui allient productivité et conservation de la biodiversité. Par rapport aux coupes totales, les coupes partielles à rétention élevée conservent mieux les caractéristiques des peuplements matures, mixtes ou résineux. Leur impact sur la biodiversité peut être évalué de façon directe, via des inventaires, mais aussi indirecte, via des indices de complexité du peuplement. L’inventaire des microhabitats portés par les arbres, ou dendromicrohabitats, a été proposé dans ce but. Ces dendromicrohabitats, qui abritent et bénéficient à des milliers d’espèces animales, végétales et fongiques, prennent diverses formes : cavités, polypores, mousses, branches mortes, etc. Leur abondance et diversité nous renseignent sur la biodiversité potentielle du peuplement étudié. Dans des forêts boréales mixtes de la sapinière à bouleaux blancs, nous avons inventorié les dendromicrohabitats en coupes partielles régulières et par trouées et en coupes totales (CPRS), 23 ans après l’application des coupes. Ces dendromicrohabitats ont été comparés à ceux de peuplements témoins non-coupés et d’une vieille forêt de 264 ans. Nous avons ainsi pu évaluer l’impact des coupes partielles sur les assemblages de dendromicrohabitats, le comparer à l’impact des coupes totales, traitement dominant en forêt boréale, et évaluer la capacité de ces coupes à accélérer leur succession. Nos résultats suggèrent que les coupes partielles à rétention élevée permettent de maintenir des assemblages similaires à ceux des témoins non-coupés. A l’inverse, les CPRS modifient durablement les assemblages dans leur composition et réduisent de moitié leur diversité. Aucune coupe n’a permis d’accélérer la succession des dendromicrohabitats vers une composition de vieille forêt. L’identification des caractéristiques des forêts naturelles et vieilles nous permet de proposer des dendromicrohabitats d’intérêts à conserver. L’étude de cet indicateur nouveau au Québec apporte ainsi de nouvelles pistes et méthodes pour l’aménagement durable de la forêt boréale mixte.
Mots-clés: aménagement écosystémique, dendromicrohabitats, indicateurs de biodiversité, dynamique forestière, régénération post-coupe
Sarah Tardif
Étudiant.e au doctorat
UQAM
Autres auteurs
- Lapa Gauthier (Nature-Action Québec)
- Maria Raquel Kanieski (Universidade do Estado de Santa Catarina)
- Rita Sousa Silva (Leiden University)
- Isabelle Laforest-Lapointe (Université de Sherbrooke)
- Alain Paquette (UQAM)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Foresterie urbaine
Foresterie urbaine - 15h40
Les arbres urbains jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité de vie dans les villes, en fournissant de nombreux services écosystémiques. Cependant, ils peuvent également contribuer à la détérioration de la qualité de l'air en produisant du pollen. L'exposition au pollen en suspension dans l'air est un facteur de risque d'allergies respiratoires et un problème majeur de santé publique, d'autant plus que les changements climatiques allongent la saison pollinique. Au sein d’une même ville, on sait que les concentrations de pollen varient dans l'espace et dans le temps. Cependant, à Montréal, les concentrations de pollen sont actuellement obtenues à partir d'une seule station pour toute l’aire urbaine. Il est donc crucial d’augmenter le nombre de stations de surveillance du pollen sur le territoire. Or cela entraînera une multiplication des échantillons à analyser, ce qui pose un défi en termes de ressources et de temps. Actuellement, la méthode standard pour l’identification des pollens repose sur la microscopie optique, une méthode exigeant une expertise spécialisée, chronophage et limitée à une classification au niveau du genre ou de la famille. Afin d’optimiser le processus d’identification, nous avons développé une approche combinant la cytométrie en flux et l’apprentissage automatique (RandomForest). Une fois l’algorithme entraîné ou les chercheurs formés en microscopie, notre méthode s’avère 30 fois plus rapide que la microscopie optique traditionnelle. En termes de performance, notre modèle atteint un taux de classification de 94 % au niveau du genre et 84 % au niveau de l’espèce. Les variables qui contribuent le plus à la différenciation des différents taxa sont les signaux de fluorescence dans le bleu et le violet ainsi que les variables de taille. Cette approche ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour la surveillance du pollen en milieu urbain.
Mots-clés: pollen, foresterie urbaine, intelligence artificielle
Sirine Boubeker
Étudiant.e au doctorat
UQAC
Autres auteurs
- Emma Despland (Université Concordia)
- Mathieu Cusson (UQAC)
- Éric Bauce (Université Laval)
- Annie Deslauriers (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Tordeuse des bourgeons de l'épinette
Salle C0416 - 15h40
En réponse à des stress biologiques tels que la défoliation, les arbres activent des mécanismes de production et de libération de métabolites secondaires en guise d'autodéfense. Parmi ces composés, les terpénoïdes sont très répandus chez les conifères. Si la présence de terpénoïdes dans le feuillage est bien établie, l'étendue de leur variation et les conditions sous défoliation par la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE), le plus grand insecte défoliateur d'Amérique du Nord, restent relativement peu étudiées.
L'objectif est d'évaluer si la défoliation de la TBE induisait une réponse de production et libération de terpénoïdes sur ses conifères hôtes.
De jeunes plants de sapin baumier, d'épinette noire et d'épinette blanche ont été placés en serre pour une expérience de deux ans, dont une partie a subi le traitement de défoliation (avec ajout de larves de TBE), tandis que l'autre a servi de groupe témoin. La phénologie des bourgeons et des larves a été suivie au long de la saison de croissance, et le feuillage en expansion et mature a été collecté à différentes étapes. Parallèlement, les profils de terpénoïdes ont été analysés après extraction des composés présents dans le feuillage, à l’aide de la chromatographie HS-GC.
L'analyse HS-GC a permis d'identifier 43 terpénoïdes, dont 67 % classés comme monoterpènes et 30 % comme sesquiterpènes. La composition en terpénoïdes présente des variations au long de la saison de croissance, particulièrement influencée par la phénologie des bourgeons, l'âge du feuillage, ainsi qu'entre les deux années d'échantillonnage. Nos résultats révèlent également des différences significatives dans la composition inter-espèces. Il est intéressant de noter que la défoliation par la TBE n'a pas démonter d'induction de production ni libération de terpénoïdes en réponse à l’attaque, bien qu'elle ait affecté la phénologie des bourgeons.
Mots-clés: tordeuse des bourgeons de l'épinette, défoliation, terpénoïdes, phénologie
Davia Yahia
Étudiant.e à la maîtrise
UQAM
Autres auteurs
- Kaisa Rissanen (UQAM)
- Daniel Kneeshaw (UQAM)
- Alain Paquette (UQAM)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Foresterie urbaine
Foresterie urbaine - 16h00
L’environnement urbain offre une diversité de conditions de croissance pour les arbres, les exposant à divers niveaux de stress liés notamment à la température et à la disponibilité en eau. Étant majoritairement plantés, les arbres ne peuvent s’adapter aux conditions urbaines par des moyens évolutifs sur le long terme. Un ajustement des traits hydrauliques du xylème faciliterait leur acclimatation à ces différentes conditions. En milieu naturel, un diamètre moyen de vaisseau plus petit est souvent associé à une meilleure tolérance à l’embolie et aux milieux arides, mais conduit à une diminution de la conductivité hydraulique. En revanche, une densité accrue de vaisseaux permettrait d’améliorer la conductivité. En ville, très peu d’études se sont penchées sur l’influence du stress urbain sur l’anatomie et l’agencement des vaisseaux. Notre étude compare les traits de vaisseaux de différentes espèces dans deux types de sites contrastés : en rue et en parc, et ce, dans cinq villes canadiennes, suivant un gradient climatique. À partir de carottes de tronc, nous avons mesuré le diamètre et la densité de vaisseaux, et la conductivité théorique pour six espèces de feuillus, sur une période de dix ans. Nous nous attendions à ce que les arbres de rue, soumis à un stress hydrique plus important, présentent un diamètre de vaisseau plus petit et une densité de vaisseaux plus élevée, ce qui reflèterait un investissement privilégiant la sécurité face à l’embolie plutôt que la conductivité hydraulique. Nos résultats préliminaires suggèrent une tendance chez les arbres de rue à privilégier la sécurité contre l’embolie plutôt que la conductivité hydraulique, mais cette tendance n’est pas observée chez toutes les espèces. Ceci révèle une différence marquée entre les conditions de croissance de rue et parc, soulignant l’importance de la plasticité des vaisseaux dans l’acclimatation des arbres urbains à leur site de croissance.
Mots-clés: forêt urbaine, vaisseaux hydrauliques, plasticité phénotypique, sécheresse, site de croissance.
Justine Gillis
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Miguel Montoro Girona (UQAT)
- Jonathan Boucher (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Mathieu Bouchard (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Tordeuse des bourgeons de l'épinette
Salle C0416 - 16h00
Au Québec, la tordeuse des bourgeons de l’épinette (Choristoneura fumiferana) (TBE) figure pami les principaux ravageurs des forêts. En 2024, cet insecte a affecté plus de 14 millions d’hectares de forêt dans la province de Québec. Après plusieurs années de défoliation, la TBE entraîne une mortalité accrue des sapins et des épinettes, ce qui modifie la dynamique des combustibles forestiers et peut affecter les risques associés aux incendies de forêt. Le Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (Btk) est utilisé comme insecticide biologique pour limiter les dommages causés par l’insecte, mais l’effet de ce traitement sur les combustibles forestiers demeure peu étudié. Ce projet vise à évaluer comment l’utilisation de différents traitements de Btk influence l’abondance et la structure des différents types de combustibles forestiers et ainsi, leur influence sur le comportement potentiel des feux de forêts. Un dispositif de recherche mis en place par la SOPFIM sur la Côte-Nord en 2007 a été utilisé afin d’étudier les effets cumulatifs sur 16 ans de divers scénarios de pulvérisation. Les résultats indiquent que dans les peuplements témoins n’ayant pas fait l’objet de pulvérisations, l’accumulation de combustibles morts et secs, tant sur pied qu’au sol, augmente l’intensité potentielle du feu à relativement court terme. Ces peuplements ont en moyenne une biomasse de 92,9Mg/ha associée à ce type de combustible, contre 51,5 Mg/ha dans les peuplements protégés contre la TBE. Toutefois, les peuplements ayant subi une forte mortalité d’arbres montrent un sous-étage constitué à près de 40% d’espèces feuillues moins inflammable en été, comme le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides Michx.) et le bouleau blanc (Betula papyrifera var. papyrifera), alors que les peuplements protégés en contiennent seulement 10,8 %. Ainsi, bien que les pulvérisations de Btk contribuent à réduire la charge de combustible au sol, les résultats suggèrent également que la régénération d'espèces feuillues moins inflammables dans certains peuplements pourrait moduler le comportement potentiel d'incendie, dépendamment de l'intensité de la défoliation subie et de la saison.
Mots-clés: Combustible forestier, tordeuse, Btk
Marie-Ève Jarry
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Autres auteurs
- Osvaldo Valeria (UQAT)
- Martin Barrette (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Maxence Martin (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Télédétection
Salle C0416 - 16h00
Les vieilles forêts boréales se distinguent des forêts plus jeunes par une abondance et une diversité supérieure d’habitats. Le bois mort, debout ou au sol, et les dendromicrohabitats, c’est-à-dire des habitats de faibles tailles situés sur les arbres vivants ou morts, comme les cavités ou les fentes de tronc, sont notamment des habitats inféodés aux vieilles forêts. Ils sont essentiels au maintien d’une biodiversité spécifique jouant des rôles clés dans le fonctionnement des écosystèmes. Cependant, nous avons peu de connaissances concernant leur abondance et leur diversité locale. L’objectif de ce projet est de développer des modèles prédictifs de la répartition spatiale du bois mort et des dendromicrohabitats dans les vieilles pessières à mousse du Saguenay Lac-Saint-Jean avec le LiDAR (« light detection and ranging ») aéroporté. Pour ce faire, la diversité et l’abondance en bois mort et en dendromicrohabitats ont été inventoriées dans 59 placettes de 400m2. Les variables LiDAR ont ensuite été extraites des modèles de hauteur de canopée, de pente et de l’indice d’humidité topographique du gouvernement du Québec. L’approche d’apprentissage Random Forest a été utilisée pour la création de modèles de prédiction d’abondance et de diversité de bois mort et de dendromicrohabitats en fonction des variables issues du LiDAR. Les données LiDAR permettent une prédiction robuste de l’abondance et de la diversité des dendromicrohabitats, ainsi que de l’abondance du bois mort. Elles sont toutefois peu efficaces pour prédire la diversité des stades de décomposition du bois mort. Les modèles développés dans cette étude permettent pour la première fois de révéler à large échelle la distribution spatiale et les caractéristiques d’habitats essentiels à la biodiversité des vieilles forêts. Ultimement, ces modèles ont le potentiel d’être des outils permettant de cibler les aires de coupe et de rétention afin d’assurer le maintien d’habitats abondants et diversifiés.
Mots-clés: Pessière à mousse, microhabitats, biodiversité, distribution spatiale, télédétection
Mathieu Lacroix
Étudiant.e à la maîtrise
UQAC
Bloc 11 -
Session Effets des coupes
Effets des coupes - 16h00
L'intensification du régime des feux et le rajeunissement causé par l’aménagement forestier érodent la résilience de la forêt boréale. En effet, les jeunes peuplements sont plus susceptibles aux échecs de régénération, soit un recrutement inférieur à 1750 semis/hectare ou un coefficient de distribution (stocking) de moins de 40 %. Dans cette étude, notre objectif était de déterminer un seuil d’arbres semenciers à laisser après coupe permettant d’assurer la régénération après un feu des peuplements d’épinette noire (Picea mariana). Nous avons échantillonné 91 peuplements aménagés entre 1973 et 2017, puis brûlés en juin 2020 dans le secteur de la Chute-des-Passes. Ces peuplements forment un gradient de densité de semenciers potentiels (arbres résiduels >9 cm de DHP) allant de 25 à 1500 tiges/hectare et sont réparties selon 2 niveaux de sévérité du feu. Selon les standards gouvernementaux, 78 % des placettes présentaient un échec de régénération et seulement 5 % présentaient une régénération satisfaisante (>8000 semis/hectare). Les résultats ne montrent aucun effet de la densité d'arbres résiduels sur la densité de semis. Notons que 46 % des placettes avaient un âge moyen inférieur à 50 ans et n'avaient donc pas de bons semenciers potentiels. La sévérité du feu a eu un impact négatif sur la régénération, probablement en altérant la banque de graines. De plus, la faible régénération globale du territoire semble être en partie attribuable aux épidémies de tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE), dont l’impact pourrait avoir affecté à long terme la production de graine et le potentiel de régénération. Dans un contexte de perturbations en rafales (TBE, coupe, feu), la rétention de semenciers potentiels après coupe ne permet pas la régénération des peuplements d’épinette noire après feu. Afin d’assurer leur régénération naturelle, il est crucial que les legs biologiques des coupes forestières puissent produire des graines viables et vigoureuses.
Mots-clés: Foresterie, Épinette noire, Régénération après feu, Effets des perturbations
Amandine Hermann
Étudiant.e à la maîtrise
UQAM
Autres auteurs
- Kaysandra Waldron (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Daniel Kneeshaw (UQAM)
- Maryse Marchand (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Stéphane Tremblay (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Dominique Boucher (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Maddie Clark (Agence d'évaluation d'impact du Canada)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Tordeuse des bourgeons de l'épinette
Salle C0416 - 16h20
Au Québec, la principale perturbation biotique qui affecte les forêts d’épinettes noires (Picea mariana) est la défoliation par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (Choristoneura fumiferana). L’épinette noire est l’espèce hôte la moins affectée et subit normalement peu de mortalité. Pourtant, depuis 2019, au cours de la dernière épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette, une augmentation inhabituelle de la mortalité a été observée dans certaines pessières noires de la Côte-Nord. Nous nous demandons si certaines caractéristiques spécifiques à ces sites peuvent expliquer cette vulnérabilité. Notre étude vise à déterminer l’effet (i) du régime hydrique, (ii) de l’inclinaison de la pente et (iii) des caractéristiques de peuplement, telles que la densité et la structure diamétrale, sur la vulnérabilité des pessières noires. Nous évaluons également si l’impact de ces facteurs sur la mortalité est modulé par l’intensité de défoliation. Pour ce faire, nous avons échantillonné 69 parcelles (0,04 hectare) dans des pessières noires de la région, entre Baie-Comeau et Manic-5. Les analyses préliminaires montrent que la défoliation est un facteur clé de la mortalité des épinettes noires mais son effet varie selon certaines conditions de site et de peuplement. L'impact de la défoliation sur la mortalité est plus marqué en conditions humides et dans les peuplements dominés par de petits arbres, suggérant que ces caractéristiques peuvent agir comme des facteurs prédisposants lors d’épisodes de défoliation. Par contre, la mortalité de l’épinette noire est plus élevée sur les terrains plats, mais cet effet n’est alors pas lié à la défoliation. Les résultats de cette étude contribuent à une meilleure compréhension des facteurs de risque qui pèsent sur les pessières noires de ce territoire. Certains peuplements, habituellement exclus des mesures de protection, pourraient bénéficier d’interventions comme l’arrosage pour limiter leur mortalité.
Mots-clés: Côte-Nord, Picea mariana, régime hydrique, topographie, densité, structure diamétrale
Andres Caseiro Guilhem
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Bloc 11 -
Session Télédétection
Salle C0416 - 16h20
Ground vegetation, including terricolous vascular plants (e.g., herbs and shrubs), bryophytes, and lichens, is a fundamental component of both forested and non-forested ecosystems, particularly for caribou. However, regional-scale maps of ground vegetation attributes remain scarce compared to those for trees, largely due to challenges in capturing species composition and morphological traits with remote sensing. To address this gap, we developed a framework for mapping ground vegetation within SpaDES, a free and open-source computational platform for predictive ecology. Our framework integrates plot data and land cover products to estimate mean ground vegetation biomass per land cover class within each product, generating biomass maps per product, then averaging them into a final biomass map with an associated pixel-level uncertainty map from the coefficient of variation across the products.
We show its application to map mean caribou lichen biomass density in the Southern NWT and Wek’èezhìı boreal caribou range planning regions of the Northwest Territories, Canada. Using three quadrat-level datasets—two containing lichen ground cover percentages and one of lichen biomass density values—we estimated mean lichen biomass density per land-cover class across four products: MVI, LCC10, ABoVE, and NTEMS. Our results showed that wetland and coniferous forest classes exhibited the highest and most accurate mean lichen biomass density across land cover products, with wetlands surpassing coniferous forests, consistent with previous studies. Additionally, the averaged biomass density map, along with its associated uncertainty map, represents the first predictive lichen biomass map with uncertainty for western North America and highlights high estimation uncertainty in recently disturbed areas.
Our framework offers a versatile approach for regional-scale mapping of ground vegetation attributes, supporting conservation efforts for species that depend on lichen as a primary winter forage, like caribou. Additionally, it can be easily adapted to integrate further lichen data, other land-cover products or for mapping other ground vegetation attributes across diverse regions globally.
Mots-clés: Ground vegetation mapping, Lichen biomass density, Land cover products, Plot data, Boreal caribou habitat
Maya Disraëli Ratsimandresiarivo
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Xavier Cavard (UQAT)
- Annie DesRochers (UQAT)
- Jérôme Laganière (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Vincent Poirier (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Effets des coupes
Effets des coupes - 16h20
Les sols forestiers boréaux jouent un rôle clé dans le cycle du carbone puisqu’ils stockent une importante quantité de carbone, supérieure à celle stockée par la végétation. Ainsi, la compréhension des changements qui s’opèrent dans le cycle du carbone du sol par le biais de l’aménagement forestier est importante tant pour atténuer les changements climatiques, mais aussi pour le maintien de la productivité forestière et des services écosystémiques. Cependant, les impacts à long terme des traitements sylvicoles sur le carbone organique du sol (COS) restent encore mitigés. Cette étude vise à quantifier l’effet l’éclaircie sur le COS dans les peuplements d’épinette noire, 20 ans après traitements. Nous avons sélectionné 16 parcelles situées dans deux régions du Québec (Abitibi et Côte-Nord) contrastant sur le plan climatique. Pour chaque région, les sites d’étude comprenaient des parcelles témoins comparées à des parcelles éclaircies. Nous avons prélevé des carottes de sol dans la couche organique puis dans la couche minérale à une profondeur de 0 à 15 cm et de 15 à 30 cm pour l’analyse de la concentration en COS. Nous avons observé que dans la couche organique, le stock de COS de la région de Côte-Nord est plus abondant que celle de l’Abitibi puisqu’il y fait plus froid et plus humide donc la matière organique se décompose plus lentement. 20 ans après éclaircie, nos résultats montrent une perte de COS dans la couche organique de Côte-Nord, indiquant un meilleur cas de récupération de COS dans les sols à texture fine de l’Abitibi comparé aux sols à texture grossière de la Côte-Nord. À long terme, l’éclaircie n’a pas d’effet sur le stock de COS de la couche minérale puisqu’elle est moins sensible aux gestions forestières par rapport à la couche organique due aux différences de tailles de réservoirs et du temps de renouvellement.
Mots-clés: Carbone organique du sol, traitement sylvicole, éclaircie, changement climatique
Nathalie Boucher
Organisme Respire
Bloc 11 -
Session Foresterie urbaine
Foresterie urbaine - 16h20
Comprendre comment l’environnement est perçu est de grand intérêt pour les aménagistes qui planifient son design, son acceptabilité sociale et son utilisation. C’est un sujet discuté dans la littérature dans différents contextes, incluant le milieu urbain, et ce, par différentes disciplines. Malgré tout, il n’existe aucun précédent quant à la perception de la biodiversité dans les infrastructures vertes urbaines de la vie quotidienne, telles que saillies de trottoirs et ruelles vertes implantées pour faciliter la végétalisation, la gestion des eaux et réduire les îlots de chaleur. Pourtant, il y a un réel engouement pour ces infrastructures au Québec. En plus, les études existantes tendent à ignorer la compréhension des dynamiques sociopolitiques entourant la perception de la biodiversité. Notre étude vise à comprendre comment les résident.es riverain.es perçoivent les infrastructures vertes urbaines et leur biodiversité à l’échelle de leur quartier.
Nous avons réalisé 16 marches exploratoires à Montréal et 16 à Trois-Rivières, parcourant des ruelles vertes et des rues arborées présélectionnées près de la résidence des participant.es. Les questions portaient sur la perception et l’appréciation de la nature, ses rôles et potentielles utilisations. Les marches ont été documentées par voie audio, géospatialisées et photographiées, et analysées par contenu thématique.
Les participant.es perçoivent certains éléments du vivant, comme les fleurs ou arbres, par leur couleur, odeur, couvert sonore ou taille. Sans faire la démonstration d’une connaissance approfondie des végétaux, les gens sont attirés par les contrastes et sont particulièrement sensibles aux différences entre les espaces sauvages, aménagés et entretenus. Peu ont associé les infrastructures vertes à la gestion des eaux, ou fait de liens avec le rôle des infrastructures vertes dans la biodiversité de la ville. Nos résultats contribuent à renseigner les études sur la nature en ville, en plus d’informer les stratégies politiques et aménagistes relativement à la biodiversité.
Mots-clés: infrastructures vertes, ville, biodiversité, perceptions, appréciations.
Amélie Juckler
Étudiant.e au doctorat
Université de Sherbrooke
Autres auteurs
- Richard Fournier (Université de Sherbrooke)
- Philippe Lejeune (Université de Liège)
- Osvaldo Valeria (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Télédétection
Salle C0416 - 16h40
Le manque de méthodes précises pour quantifier la distribution 3D de la végétation en forêt limite notre compréhension de ces écosystèmes. Une représentation détaillée de la structure verticale est essentielle pour améliorer les inventaires forestiers et affiner la compréhension des interactions entre la végétation et son environnement. Pourtant, cartographier efficacement l’ensemble du profil vertical de la végétation reste un défi. Le LiDAR mobile (MLS – Mobile Laser Scanning) permet de sonder finement l’environnement forestier à l’échelle de la placette, jusqu’à un hectare. Toutefois, l’occlusion du signal LiDAR nécessite une normalisation des nuages de points pour les rendre compatibles avec la distribution réelle de biomasse des composantes de la forêt, surtout dans les peuplements denses. Le MLS constitue une avancée technologique majeure en permettant une acquisition rapide et détaillée des nuages de points, tout en réduisant les problèmes d’occlusion fréquemment rencontrés avec d’autres capteurs.
Cette étude propose une approche basée sur l’ajustement de courbes de Weibull pour modéliser la distribution verticale de la végétation à partir des données MLS. L’analyse repose sur l’estimation du PAD (Plant Area Density) normalisé, un indicateur clé représentant la surface du matériel végétal dans un volume donné. Pour chaque placette, jusqu’à trois courbes de Weibull sont ajustées sur les valeurs de PAD pour caractériser la stratification de la végétation.
L’étude s’appuie sur un échantillon de 98 placettes représentatives des forêts de l’est du Canada. Les résultats mettent en évidence le potentiel du MLS pour capturer avec précision la complexité verticale des peuplements et mieux différencier les strates végétales, tout en conservant une information fiable sur la végétation du sous-bois. En offrant une estimation plus précise de la distribution de la densité végétale, cette approche améliore l’intégration de la structure verticale dans les inventaires forestiers, avec des applications directes en modélisation écologique et en aménagement forestier.
Mots-clés: LiDAR mobile, Structure verticale, Densité végétale, Weibull, Complexité structurelle
Bijay Pandeya
Étudiant.e au doctorat
UQAC
Autres auteurs
- Martin-Philippe Girardin (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Kaysandra Waldron (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Annie Deslauriers (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 11 -
Session Tordeuse des bourgeons de l'épinette
Salle C0416 - 16h40
Spruce budworm ( Choristoneura fumiferana ) (SBW) outbreaks significantly influence eastern Canada's boreal forest dynamics. Since 2006, a persistent SBW outbreak in eastern Quebec has severely impacted black spruce ( Picea mariana ) stands in the North Shore region of eastern boreal Canada. This outbreak led to widespread tree mortality across the region. Thus, we aimed to evaluate how the regime shifts in tree-ring growth are related to tree mortality in the black spruce-dominant forest affected by SBW. In this region, we selected 34 study plots and characterized the variability in tree growth using tree-ring width measurements from 276 and 102 living and dead trees, respectively. Regime shifts in growth were then identified to evaluate the stress impact of the SBW outbreak on tree ring growth. Next, logistic regression models were developed to predict tree mortality from predictors such as growth stress on tree ring growth calculated after regime shift and plot-level basal area. Our result showed the plots with higher severe cumulative defoliation (>65%) exhibited a high proportion of dead trees (92%). Changes in growth percentage revealed that negative growth was observed during the 1970s outbreak, reaching -60% from 2006 at the beginning of the new outbreak. We found that regime shift in the 1980s and growth stress were strongly linked to a probability of mortality reaching 90%. Additionally, a small basal area leads to a tree mortality probability of 50% in black spruce stands. This study highlights that regime shift in growth in conjunction with basal area is directly related to forest mortality under SBW defoliation.
Mots-clés: spruce budworm, regime shift, black spruce, boreal forest, dendrochronology
Emma Bacon
Étudiant.e à la maîtrise
Université Concordia
Bloc 11 -
Session Foresterie urbaine
Foresterie urbaine - 16h40
La diversité et l'abondance des arbres varient d'une ville à l'autre en fonction des facteurs tels que la forme urbaine, les investissements publics et privés et les préférences culturelles, ce qui créent des inégalités dans l'accès à la forêt urbaine et aux services qu'elle offre. Les types d'espaces verts varient en termes de propriété et de gouvernance (par exemple, les cours résidentielles, les terrains institutionnels, les parcs, les emprises publiques) et peuvent également différer en termes de diversité et d'abondance des arbres. Historiquement, les bases de données sur les arbres publics (typiquement axées sur les terrains publics, c'est-à-dire les arbres de rue et de parcs) servent à calculer la diversité de la forêt urbaine. Cependant, des études récentes suggèrent que les arbres sur les terrains privés sont souvent différents de ceux sur les terrains publics, ce qui influence la composition de la forêt urbaine. Nous utilisons l’Observatoire Urbain de Montréal, un ensemble de 25 placettes de 200 m rayon qui s’étendent sur 22 quartiers de l’île de Montréal et qui ont été optimisées pour couvrir des gradients de population, de statut socioéconomique et de densité de bâtiments. Ces données nous permet de déterminer comment la diversité et l'abondance de la forêt urbaine diffèrent entre les types d'espaces verts, et à travers les gradients de statut socio-économique et de forme urbaine. Nous avons inventorié 29 000 arbres individuels de 315 espèces différentes. Nous avons constaté que les espaces verts résidentiels représentent 60 % de tous les arbres de notre zone d'étude, suivis par l'emprise publique (26 %). Les espaces verts résidentiels sont également plus riches en espèces que les autres types d'espaces verts, avec 251 espèces, dont 87 ne se trouvent pas sur les terrains publics. Des analyses préliminaires suggèrent que la diversité et l'abondance des arbres sont également influencées par la forme urbaine et le contexte socio-économique des différents quartiers. Les résultats du projet nous aideront à mieux comprendre les facteurs d'interaction qui façonnent la diversité des forêts urbaines à travers la ville, et la manière dont nous pouvons réduire les inégalités grâce à la gestion des arbres publics et privés.
Mots-clés: forêt urbaine, biodiversité, arbres privés
Frédérik Doyon
Chercheur.e régulier.ère au CEF
UQO
Bloc 11 -
Session Effets des coupes
Effets des coupes - 16h40
Dans le cadre du dispositif SylvAdapt, le cadre de la Vulnérabilité et de l'Adaptation et l'écologie fonctionnelle sont combinés pour évaluer la capacité d'adaptation des peuplements. Ce diagnostic sylvicole évalue la résistance à court et moyen terme, ainsi que de la résilience à long terme séparément pour les différentes strates verticales du peuplement, et cela selon deux approches d’adaptation, soit: 1) celle qui maximise la diversité compositionnelle, structurelle et fonctionnelle (« police d’assurance de la diversité » (PAD)), et une 2) qui maximisent l’abondance des « espèces championnes » (ES), jugées plus résistantes et résilientes sur la base de la valeur de leurs traits de réponse aux perturbations et stress régionalement importants. Une prescription est ensuite élaborée selon chaque approche afin d’optimiser l’amélioration de la capacité d'adaptation des peuplements. Cette procédure a été mise en oeuvre en 2019-20 dans 26 érablières rouges mixtes au sein du dispositif SylvAdapt (Bois-Francs et en Appalaches) pour y prescrire trois traitements sylvicoles avec différents niveaux de surface terrière résiduelle (20 m2/ha, 12 m2/ha et 6 m2/ha), en répartissant chacune des deux approches d’adaptation équitablement. Nous avons ensuite utilisé le LiDAR aérien avant (2019) et après traitement (2024) pour représenter la transformation de la structure 3D et testé l’effet de l’approche d’adaptation et de la surface terrière résiduelle sur les métriques 3D de structure, tout en contrôlant pour les conditions initiales. Les valeurs des métriques d’hétérogénéité spatiale étaient significativement plus élevées dans l’approche PAD qu’ES mais avec un effet moindre sous le traitement 6m2/ha. Cette différence est attribuable à une plus grande diversité de formes de couronnes et de hauteur d’arbres en PAD et une distribution plus agglomérée des tiges dans la parcelle, résultant probablement d’une plus grande irrégularité spatiale des prélèvements lors de la récolte pour respecter les consignes de la prescription.
Mots-clés: Résilience, résistance, traits fonctionnels, éclaircies, structure 3D des peuplements, police d?assurance de la diversité, espèces championnes, hétérogénéité spatiale, dimension fractale
Le mot de la fin, remerciement des partenaires et remise des prix par le directeur du CEF
Mots-clés: mot de la fin
Thi Thanh Hien Pham
Chercheur.e régulier.ère au CEF
UQAM
PDF non disponible
Bloc 2 -
Session Conférences de nouveaux chercheurs.es au CEF #1
Conférences de nouveaux chercheurs.es au CEF #1 - 09h45
Géographe de formation, je suis professeure titulaire en études urbaines à l'UQAM et depuis 2020 je dirige la Chaire de recherche du Canada sur les petites et moyennes villes. En m?intéressant à ces villes, je décortique comment leur taille, leur pouvoir politique et économique limité ainsi que leur proximité à la campagne influent sur le cadre bâti, les pratiques sociales et la vie quotidienne dans ces villes. La forêt urbaine est ainsi pour moi un point d'entrée pur comprendre la ville, son gouvernance et sa vie sociale. Plus spécifiquement, la forêt urbaine est étudiée sous trois angles comme suit :
Comment la population locale perçoit les aménagements urbains intégrant la végétation et comment ces aménagements sont appropriés par la population ? À travers des sondages et des entretiens qualitatifs, nous prenons en compte la perception et le vécu sont analysés en prenant le compte du contexte socio-économique et politique au niveau du quartier (par ex : l'embourgeoisement ou d'autres changements sociodémographiques) afin de comprendre l'impact des changements structurels du quartier sur la vie quotidienne. Comment la planification et la gouvernance des infrastructures vertes sont-elles déployées au niveau municipal ? À travers des sondages, des ateliers, mais aussi d'une revue de littérature systématique, nous essayons de documenter les pratiques en cours au Québec, et visons à réunir les experts et praticiens dans le but commun de lutter contre les dérèglements environnementaux et de s'adapter aux changements climatiques. Quelle est l'ampleur et quels sont les facteurs explicatifs des inégalités dans l'accès aux espaces verts en ville (parc, arbres de rue et ruelles vertes) ? Je m?intéresse également à comprendre comment et pourquoi certains types de verdissement peuvent perpétuer les disparités spatiales.
Mes travaux sont disséminés dans des journaux en études urbaines, géographie urbaine ou planification. Nous utilisons également d'autres canaux pour joindre le milieu des pratiques, comme atlas avec carte interactive, magazines professionnels, fiches de synthèse, etc. Les projets se reposent sur des partenariats avec des collègues d'autres disciplines et du milieu des pratiques (comme Vivre en Ville, Québec Vert etc), visant à offrir une meilleure mobilisation des connaissances sur les espaces vertes en ville.
Mots-clés: nouveau chercheur
Maxence Martin
Chercheur.e régulier.ère au CEF
UQAT
PDF non disponible
Bloc 2 -
Session Conférences de nouveaux chercheurs.es au CEF #1
Conférences de nouveaux chercheurs.es au CEF #1 - 10h05
Les forêts naturelles ont une place centrale dans la définition de l'aménagement forestier écosystémique au Québec. Les paysages préindustriels de la province étaient notamment dominés par les vieilles forêts, ce qui devrait en faire le pivot autour duquel axer nos stratégies d'aménagement. Mes recherches doctorales et postdoctorales ont toutefois fait ressortir trois diagnostics clés. 1) Notre façon d'appréhender les vieilles forêts - que ce soit en recherche, aménagement ou conservation - suit une simplification excessive qui limite la façon dont nous percevons leurs enjeux et y répondons. 2) En conséquence de cette simplification, nos connaissances et des données d'inventaires forestiers ont d'importantes limites qui nous empêchent de garantir un aménagement réellement durable des forêts 3) Dans le même temps, les coupes forestières sélectionnent spécifiquement les vieilles forêts les plus riches, à l'inverse des feux. En plus de la disparition et de la fragmentation des vieilles forêts, il existe actuellement un enjeu de perte de représentativité qui est gravement sous-documenté. Mes projets de recherche actuels visent donc à trouver des solutions à ces diagnostics, suivant trois axes. Le premier axe s'intéresse au développement d'indicateur de biodiversité indirects, particulièrement les dendromicrohabitats et les indices de biodiversité potentielle, pour fournir des diagnostics écologiques approfondis et applicables à large échelle. Le second axe consiste au développement de modèles de télédétection, notamment basés sur les données LiDAR aéroporté, pour fournir une cartographie robuste des attributs, habitats et services écosystémiques fournis par les vieilles forêts. Enfin, le troisième axe développe l'intégration des connaissances développées au sein des précédents axes dans les stratégies d'aménagement et les pratiques sylvicoles. Les connaissances et méthodologies ainsi développées contribueront à garantir une durabilité réelle de notre aménagement forestier face aux multiples enjeux que posent les changements globaux.
Mots-clés: Lidar, vieilles forêts,
Loïc D'Orangeville
Chercheur.e régulier.ère au CEF
Université Laval
PDF non disponible
Bloc 2 -
Session Conférences de nouveaux chercheurs.es au CEF #1
Conférences de nouveaux chercheurs.es au CEF #1 - 10h25
Réduire l’impact négatif des changements climatiques sur la forêt canadienne constitue aujourd’hui un défi environnemental majeur. Les recherches menées dans mon labo visent à transformer les outils d’aménagement forestier en développant notre capacité à anticiper l’impact du réchauffement sur la démographie des arbres. Mon équipe travaille sur trois axes. Un premier axe utilise les bases de données continentales de parcelles permanentes pour anticiper l’effet du climat sur le recrutement, la croissance et la mortalité des forêts. Un deuxième axe vise le suivi en temps réel de l’impact du climat sur les processus de croissance d’un petit nombre d’arbres pour mesurer les impacts à l’échelle du peuplement. Un troisième axe utilise des expériences terrain (sécheresses artificielles, plantations le long de vastes gradients climatiques) pour développer des connaissances qui serviront à améliorer les interventions sylvicoles en réponse aux changements climatiques.
Mots-clés: changements climatiques, écologie appliquée, démographie forestière
Lucie Barbier
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Marc-André Lemay (UQAT)
- Étienne Boucher (UQAM)
- Sergio Rossi (UQAC)
- Fabio Gennaretti (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 3 -
Session Phénologie
Phénologie - 11h00
La xylogénèse, le processus de formation des cellules de bois, est un processus clé dans le bilan carbone terrestre étant donné qu’il permet le stockage définitif du carbone dans la biomasse. L’étude de la xylogénèse repose typiquement sur un échantillonnage hebdomadaire ayant pour objectif de déterminer le nombre de cellules produites à chaque instant de la saison de croissance. Cependant, l'étude des moteurs à court terme de la production de bois à l'aide de données de xylogénèse est difficile en raison du schéma d'échantillonnage habituel et de l'influence de la croissance excentrique (hétérogène autour de la tige). Dans cette étude, nous améliorons la recherche sur la xylogénèse en introduisant une approche statistique qui prend explicitement en compte la phénologie saisonnière, les taux de croissance à court terme et l'excentricité de la croissance. Pour ce faire, nous avons développé trois modèles bayésiens de la xylogénèse et nous les avons comparés à une méthode conventionnelle s'appuyant sur la fonction de Gompertz. Nos résultats montrent que l'excentricité génère une autocorrélation temporelle élevée entre échantillons successifs et que sa prise en compte explicite améliore à la fois la représentativité de la phénologie et de la variabilité intra-cerne. Nous avons détecté des patrons résiduels à court terme dans les modèles qui suggèrent l'influence de variables environnementales sur la production cellulaire. Nos modèles offrent plusieurs avantages par rapport aux méthodes traditionnelles, notamment des intervalles de confiance robustes autour des prédictions, une cohérence avec la phénologie, et une sensibilité réduite aux observations extrêmes à la fin de la saison de croissance. Ces modèles fournissent également une référence pour tester de façon mécaniste les moteurs à court terme de la formation du bois.
Mots-clés: Xylogénèse, Gompertz, Modèles bayésiens, Croissance excentrique
Marie-Pier Richard
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Jeremy Kirchman (New York State Museum)
- Teresa Pegan (University of Michigan)
- Ben Winger (University of Michigan)
- Junior A. Tremblay (Environnement Canada)
PDF non disponible
Bloc 3 -
Session Faune aviaire
Faune aviaire - 11h00
Le pic à dos rayé (Picoides dorsalis) est une espèce associée à la forêt boréale et aux forêts de montagne en Amérique du Nord. L'exploitation forestière a entraîné des changements dans la dynamique forestière de ces écosystèmes, avec pour conséquence la fragmentation et la dégradation des habitats favorables à cette espèce. Le déclin observé des populations, en particulier de la sous-espèce P. d. bacatus, dans l'est du Canada et le nord-est des États-Unis, soulève des inquiétudes pour la conservation de l'espèce. Afin de soutenir les efforts de conservation et de gestion de l’espèce, le projet s’intéresse à la structure génétique et à l’histoire biogéographique du pic à dos rayé. L’objectif est de déterminer si les données génétiques appuient la définition actuelle des trois sous-espèces morphologiques et d’évaluer l’impact de la dernière glaciation sur la structure génétique de l’espèce. Des séquences d'ADN ont été obtenues à partir de 60 échantillons fournis par différents musées ou échantillonnés sur le terrain dans l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce. Des analyses à partir de l’ADN mitochondrial révèlent deux groupes génétiques. Les sous-espèces P. d. fasciatus et P. d. bacatus forment un premier groupe, alors que la sous-espèce P. d. dorsalis forme un groupe distinct. Un modèle de distribution d’espèce projeté au dernier maximum glaciaire montre que les populations ont potentiellement été isolées dans des refuges glaciaires séparés. Toutefois, les données génétiques supportent une divergence antérieure à la dernière glaciation entre les deux groupes. Une reconstruction bayésienne de la taille effective des populations à l’aide de « skyline plots » révèle également une expansion des populations avant le dernier maximum glaciaire. Ainsi, la structure génétique du Pic à dos rayé aurait potentiellement été influencée davantage par les événements climatiques extrêmes du Pléistocène ayant eu lieu avant la dernière glaciation.
Mots-clés: Picoides dorsalis, génétique, biogéographie
Pauline Suffice
Professionnel.le de recherche
Université Laval
Autres auteurs
- Jean-Michel Beaudoin (Université Laval)
- Anne Bernard (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 3 -
Session Foresterie sociale
Salle C0420 - 11h00
L’aménagement durable des forêts (ADF) nécessite une compréhension approfondie des intérêts, des valeurs et des besoins des peuples autochtones. Les visions et perspectives autochtones valorisent la durabilité et l'interdépendance avec le territoire, favorisant ainsi une gestion forestière respectueuse de l'environnement.
Depuis 10 ans, la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone mène des recherches en partenariat avec des organisations des Premières Nations au Québec et au Canada. Fondée sur une approche collaborative, ces recherches ont contribué à documenter des réalités et des perspectives autochtones, ainsi qu’à leur donner du sens dans le cadre de projets d'aires protégées et de plans d'aménagement forestier. Les différents projets partagent un certain nombre de points communs d’importance pour l’ADF, notamment une prise en compte des modes de vie, des pratiques et des modes de gouvernance traditionnels, ou encore un développement économique qui met l’accent sur l’amélioration du bien commun et des liens au territoire.
L’ADF se doit de respecter et valoriser la biodiversité, les cultures et le développement. L'importance d'une vision holistique est ainsi cruciale pour l'acceptabilité sociale des projets de développement dans le secteur forestier. En combinant les savoirs autochtones et les savoirs scientifiques, il est possible de créer des modèles qui bénéficient à la fois aux communautés locales, à l'environnement et aux entreprises. Il faut créer cette vision partagée pour favoriser une cohabitation harmonieuse et durable entre les différentes parties prenantes.
Mots-clés: peuples autochtones, aire protégée, aménagement, culture
Yousry A El-Kassaby
University of British Columbia
Autres auteurs
- Eduardo P Cappa (INTA, Argentina)
PDF non disponible
Bloc 3 -
Session Génétique et mycorrhize
Génétique et mycorrhize - 11h00
Traditional quantitative genetics, relying on pedigree-based relationship matrices (A-matrix), has successfully improved forest trees, but long breeding cycles limit progress. Genomic relationship matrices (G-matrix), using single nucleotide polymorphisms (SNPs), offer a potential solution by capturing both contemporary and ancestral relatedness. However, standard genome-wide association study (GWAS) can miss important variants, contributing to missing heritability. We employed a GWAS-based SNP selection method, prioritizing SNPs based on their absolute contribution to genetic variance, regardless of statistical significance. We compared its efficacy in two species with vastly different genome sizes: white spruce (20 Gb, genotyped with genotyping-by-sequencing) and eucalyptus (640 Mb, genotyped with a high-density SNP chip). In white spruce, our method enhanced heritability estimates over traditional pedigree-based methods. However, in eucalyptus, where the SNP chip provided near-complete genome coverage, traditional methods yielded superior estimates, suggesting a strong effect of ascertainment bias. This discrepancy underscores the importance of carefully evaluating both SNP selection strategies and marker ascertainment bias when constructing G-matrices for accurate genetic parameter estimation. Our results indicate that GWAS-based SNP selection, when applied appropriately, has the potential to reduce missing heritability and improve the accuracy of breeding value prediction for tree improvement.
Mots-clés: Heritability, Quantitative genetics, Tree breeding, Genomic pairwise relationship, Genetic gain
Daniel Schönig
Étudiant.e au doctorat
UQAM
Bloc 3 -
Session Foresterie sociale
Salle C0420 - 11h20
Dans les zones néotropicales, et en particulier dans les forêts tropicales humides, la dégradation des forêts et leur conversion à d'autres utilisations menacent un grand nombre d'espèces végétales et vertébrées, contribuent aux changements climatiques et érodent les moyens de subsistance et de survie culturelle des populations humaines. Des chocs systémiques à grande échelle, tels que la pandémie de COVID-19, peuvent affecter à la fois les causes directes et les pressions sous-jacentes à l'origine des changements forestiers. Cette étude vise à déterminer si la pandémie de COVID-19 a affecté l'intensité des perturbations forestières et si les pressions sous-jacentes ont connu une réorganisation. Nous émettons également l'hypothèse que les effets de la pandémie ont été modulés par la gouvernance autochtone et par des mesures de protection formelles. À cette fin, nous utilisons des méthodes d'attribution causale spatialement et temporellement explicites, basées sur 12 millions d'observations de télédétection sur la période 2017-2022. Lors de la pandémie de COVID-19, deux phases distinctes ont entraîné des perturbations forestières supplémentaires de 15100 km² : une première phase de déboisement opportuniste le long des frontières agricoles dans toute l'Amazonie, suivie d'une deuxième phase au cours de laquelle des perturbations ont pénétré davantage dans les zones centrales et auparavant plus éloignées de l'Amazonie, potentiellement liées à la déréglementation environnementale et aux politiques de soutien à l'expansion de l'agriculture et au développement de l'infrastructure. Au cours de ces deux phases, les terres autochtones ont constitué des barrières à l'augmentation des perturbations anthropogéniques. Afin d'atténuer les mécanismes de rétroaction entre les urgences sanitaires mondiales (ou des chocs systémiques similaires) et la dégradation continue des forêts tropicales nous identifions plusieurs lignes d'action et de politiques visant à réduire l'accaparement opportuniste des terres, à soutenir les populations autochtones et à décourager le retour en arrière des réglementations environnementales.
Mots-clés: Inférence causale, forêts tropicales, déforestation, gouvernance autochtone
Jacob Beauregard
Étudiant.e à la maîtrise
Université de Sherbrooke
Autres auteurs
- Isabelle Laforest-Lapointe (Université de Sherbrooke)
- Pierre-Luc Chagnon (Université de Sherbrooke)
PDF non disponible
Bloc 3 -
Session Génétique et mycorrhize
Génétique et mycorrhize - 11h20
In temperate forests, most trees associate with ectomycorrhizal (EM) and/or arbuscular mycorrhizal (AM) fungi, which are crucial for nutrient provisioning, pathogen protection, and environmental stress tolerance. These symbiotic relationships can also influence soil biogeochemical processes and other microbial taxa. Research in diverse forest types have demonstrated the impact dominant forest mycorrhizal types can have on microbial community assemblages and plant soil feedbacks (PSFs), with implications for host trees and forest ecosystems. AM dominated stands have been shown to harbour more diverse belowground fungal communities, with pathogenic and saprotrophic taxa particularly enriched, relative to EM stands. Furthermore, climate change is anticipated to increasingly favour AM trees, leading to augmented nutrient cycling and increasingly negative PSFs. However, the impacts of these shifts on specific species, particularly in Québec’s temperate forests, remain unclear. As such, there is a need to assess how differing mycorrhizal types impact trees’ belowground fungal community assembly, especially those with important structuring roles in forest ecosystems, and in the context of climate change. Therefore, we aimed to elucidate the impacts of dominant forest mycorrhizal types on the soil and root fungal communities of the sugar maple (Acer saccharum) and the eastern hemlock (Tsuga canadensis) (keystone and foundational species, respectively). We sampled over 400 seedlings and 400 soils across four sites to measure the relative abundances of pathogens and saprotrophs in AM and EM dominated stands (via ITS sequencing) and growth metrics for both species (ACSA: averages of 19.8cm height, 2.55mm diameter, 13.5cm crown width, 8y age, 4.9mm average annual growth; TSCA: averages of 20.6cm height, 3.3mm diameter, 16.7cm crown width). We also measured the degree of mycorrhizal colonization in both species, anticipating differing degrees of colonization by stand type, particularly in the eastern hemlock, for which we find compelling evidence of dual-mycorrhization which was singularly demonstrated in the 1990s.
Mots-clés: mycorrhizae, soil microbial ecology, forestry, mycorrhizal types
Mauro Brum
Postdoctorant.e
UQAC
Autres auteurs
- François Gionest (UQAC)
- Valérie Néron (UQAC)
- Stéphane Bourassa (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Dominique Boucher (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Kaysandra Waldron (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Mathieu Gauvin (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Annie Deslauriers (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 3 -
Session Phénologie
Phénologie - 11h20
Climate change is expected to increase summer temperatures and vapor pressure deficit (VPD) in Canadian boreal forests, intensifying tree water stress and potentially affecting water use, productivity, and hydraulic function. To investigate these impacts, a Temperature-Free Air Controlled Enhancement (T-FACE) experiment was employed to simulate global warming and drought conditions in conifers species. The experimental treatment led to an 8% increase in mean temperature and a 35% rise in VPD. We assessed the physiological responses of juvenile balsam fir (Abies balsamea) and black spruce (Picea mariana), focusing on water use, growth, and hydraulic function. Summer tree diameter fluctuations and growth were monitored using high-frequency point dendrometers (2023-2024), while a custom sap flow sensor was developed to measure sap flux density (Js) and whole-tree water use (2024) under both control and experimental treatments. During the summers of 2023 and 2024, both species exhibited greater stem shrinkage under elevated temperature and VPD, with balsam fir showing stronger effects in summer 2024, compared to summer 2023. Additionally, tree growth significantly declined under T-FACE, indicating reduced productivity under long-term exposure to warming and drying conditions for both species. During the summer of 2024, T-FACE significantly increased water use in both species, with the effect being most pronounced in the early morning (6–10 AM) and late afternoon (4–8 PM). Hourly Js initially increased with rising VPD but declined beyond a species-specific threshold (VPD > 2 kPa). However, under warming and drier conditions, this threshold increased, allowing sap flux to remain high at VPD levels exceeding 2.7 kPa for both species. These results suggest that higher VPD drives greater transpiration, leading to increased water loss, while simultaneously reducing water use efficiency and growth. This highlights the potential vulnerability of boreal trees to climate-induced shifts in hydraulic function and the potential long-term consequences for boreal forest carbon and water cycles.
Mots-clés: sap flow, water use efficiency, climate change, point dendrometer, boreal forest, temperature
Rachel-Isolde Lane Shaw
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Bloc 3 -
Session Faune aviaire
Faune aviaire - 11h20
The integration of bird conservation objectives into forest management planning is often enabled by the use of categorical forest type suitability estimates in forest optimization models. Moving from expert-based suitability to empirical density estimates can be time-consuming and costly if bird population data collection and production of models are to be done separately for each management area of interest. We demonstrate and assess a method of leveraging existing regional data to produce “bird yield tables” for use in forest optimization models. We produce a reproducible and open-source “piecewise smoothing” method to map spatially explicit density estimates from regional datasets onto forest type and age classes relevant to forest management for a suite of bird species anywhere in Canada. A large number of environmental variables are incorporated into regional density models and then aggregated by forest type and age class to produce bird density estimates that are directly applicable to forest management units. This post-hoc summarization approach can leverage regional datasets in a manner that incorporates environmental heterogeneity without requiring extensive structured surveys. With careful choice of parameters, piecewise smoothing can be used to produce density predictions for a large suite of landbird species, in a format that can be used to integrate bird conservation objectives into forest management planning across large spatial extents. Future work will further investigate variation in parameters and input data for model improvement and demonstrate a workflow for the methods use in optimization models for integrated forest management and bird conservation.
Mots-clés: birds, forest management planning
Claudio Mura
Étudiant.e au doctorat
UQAC
Autres auteurs
- Guillaume Charrier (INRAE Clermont-Ferrand, Université Clermont-Auvergne)
- Al Kovaleski (University of Wisconsin-Madison)
- Patricia Raymond (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Annie Deslauriers (UQAC)
- Sergio Rossi (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 3 -
Session Phénologie
Phénologie - 11h40
Dans les climats froids, les arbres doivent ajuster leur phénologie et leur résistance au froid en fonction des conditions environnementales. L'exposition aux températures froides (« chilling ») pendant la dormance est fondamentale pour la lévée d’endodormance et pour permettre à l'arbre de réagir aux signaux externes. Dans cette étude, nous comparons l'effet du refroidissement artificiel (4 °C) et naturel (incluant températures < 0°C) sur des semis d'érable à sucre (Acer saccharum) de 7 provenances. À partir de la fin de l'automne (mi-Novembre), nous avons effectué des transferts réguliers des échantillons vers des conditions de forçage (20 °C) pour quantifier la résistance au froid (LT50) et calculer le temps nécessaire au débourrement. Nous avons calculé l’accumulation du froid avec des modèles classiques considérant seulement les températures > 0 °C et avec un modèle incluant les températures jusqu'à -5 °C. Le point de rupture de l’endodormance était entre 2715 et 3075 heures à 4 °C. Les échantillons maintenus à 4°C jusqu'à fin avril ont initié le processus de débourrement, suggérant que cette température peut à la fois satisfaire les exigences de levée de la dormance et initier le développement ontogénétique. De plus, 4 °C a induit une perte progressive de résistance au froid, indiquant une désacclimatation. En revanche, les échantillons en refroidissement naturel ont conservé une résistance au froid plus élevée jusqu'à la fin de la saison. Celle-ci était liée à un temps de débourrement plus long et à une identification plus difficile du point de rupture de l’endodormance. Le modèle tenant compte des températures < 0°C a surpassé les modèles classiques. Il n’y avait aucune différence entre les provenances. Enfin, nos résultats indiquent qu'inclure les températures < 0°C et mesurer la résistance au froid pendant ce type d’expériences peut améliorer les résultats en climats froids.
Mots-clés: Dormance, Gel, Phénologie, Printemps hâtif
Jérôme Cimon-Morin
Chercheur.e régulier.ère au CEF
Université Laval
Autres auteurs
- Daniel Fortin (Université Laval)
- Yan Boulanger (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
PDF non disponible
Bloc 3 -
Session Foresterie sociale
Salle C0420 - 11h40
L’opinion publique est essentielle au succès des initiatives de conservation, ce qui rend cruciale l’identification des facteurs influençant l’attitude des individus. Les communautés locales, souvent en première ligne des efforts de conservation, supportent la majorité des coûts associés tout en bénéficiant plus rarement de ses retombées. Les efforts pour rétablir les populations de caribous forestiers ont engendré de nombreux débats concernant la légitimité de leurs impacts socioéconomiques auprès des communautés locales. Nous avons interrogé 665 citoyens provenant de régions du Québec, Canada, où les caribous sont présents, ainsi que 733 citoyens provenant de régions où ils ne le sont pas, afin d’examiner les facteurs influençant les attitudes du public envers la conservation. Les répondants issus des régions où les caribous sont présents ont exprimé des préoccupations concernant la vitalité économique régionale, la diminution de leur qualité de vie et la perte des bénéfices régionaux, comparativement aux habitants des régions sans caribous. Les impacts appréhendés sur les emplois ont entraîné une baisse de support envers la conservation, en particulier parmi les individus ayant des liens avec le secteur forestier. De plus, un effet interrégional a été observé : les répondants liés au secteur forestier partageaient des opinions similaires, quel que soit leur lieu de résidence. Parmi les trois mesures de conservation les plus utilisées pour le caribou – le contrôle des prédateurs, le confinement en enclos, et la réduction des proies alternatives pour les prédateurs – ce sont celles qui ont reçu le moins de soutien de la part des répondants. Malgré les discours ambigus relayés par les médias, la conservation des caribous bénéficie d’un soutien global du public, ce qui témoigne d’une reconnaissance généralisée de ses bénéfices intrinsèques. Les résultats fournissent des perspectives pour développer des stratégies de conservation plus efficaces et adaptées au contexte local.
Mots-clés: Caribou, conservation, opinion publique, foresterie, aménagement forestier durable
Pierre Nassivera
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Autres auteurs
- Francis Lessard (Université Laval)
- Yves Aubry (Université Laval)
- Jérôme Lemaître (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Junior A. Tremblay (Environnement Canada)
PDF non disponible
Bloc 3 -
Session Faune aviaire
Faune aviaire - 11h40
L’essor des énergies renouvelables pose un défi pour concilier le développement des parcs éoliens avec la conservation des espèces vulnérables. Parmi elles, la Grive de Bicknell (Catharus bicknelli) est particulièrement menacée par la perte et la fragmentation de son habitat de reproduction. Cet oiseau néotropical niche dans les forêts denses de sapin baumier (Abies balsamea) en altitude. Cela en fait l’une des espèces les plus restreintes géographiquement en Amérique du Nord. De plus, ce milieu est convoité pour les parcs éoliens et leurs infrastructures associées. Jusqu'à 30 % de sa population mondiale se trouve au Canada, dont 95 % de ces individus au Québec, où elle est classée menacée au niveau national et vulnérable à l'échelle provinciale.
Notre étude quantifie l’impact des infrastructures anthropiques sur son habitat en comparant des modèles spatiaux avec et sans perturbations. En nous fondant sur un modèle de niche développé à l’échelle du Massif du lac Jacques-Cartier, nous appliquons une interpolation spatiale pour reconstruire les conditions d’habitat en l’absence d’impact. Dans un second temps, une analyse coût-bénéfice intégrant le potentiel éolien et une version inversée du modèle de niche permet d’identifier les zones où le développement éolien maximiserait la production tout en minimisant les impacts écologiques sur l'espèce et son habitat.
Nos résultats montrent que si les routes sont responsables de la majorité des zones déboisées, elles affectent peu les habitats favorables. En revanche, 78 % des zones classées très bon habitat coïncident avec un fort potentiel éolien (>7.8 m/s). Ces zones de chevauchement ne couvrent que 1,19 % de l’aire d’étude tandis que le fort potentiel éolien en représente 12,04 %, offrant des alternatives moins conflictuelles. Dès lors, une planification stratégique des parcs éoliens, privilégiant les zones dépourvues d’habitat de qualité pour la Grive de Bicknell, est essentielle pour concilier transition énergétique et conservation.
Mots-clés: Grive de Bicknell, énergie éolienne, interpolation spatiale, analyse coût-bénéfice, planification stratégique
Vincent Quevillon
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Sébastien Gérardi (Université Laval)
- Jean Bousquet (Université Laval)
- Patrick Lenz (RNCaN-CFL)
PDF non disponible
Bloc 3 -
Session Génétique et mycorrhize
Génétique et mycorrhize - 11h40
L'épinette noire (Picea mariana [Mill.] B.S.P.) est une espèce emblématique et ubiquitaire de la forêt boréale nord-américaine. Traditionnellement, les programmes d'amélioration génétique se sont concentrés sur les caractères de croissance et les propriétés mécaniques de son bois. Cependant, l'étude des caractères liés à son adaptation au climat gagne rapidement en importance, compte tenu du considérable impact prédit qu’auront les changements climatiques sur la forêt boréale en Amérique du Nord. Dans cette optique, cette étude a comme objectif d’identifier des gènes associés à l'adaptation climatique chez l'épinette noire à travers le Canada. Un total de 254 épinettes noires, provenant de 30 populations et couvrant la majeure partie de l'aire de répartition de l'espèce, ont été échantillonnées. Chaque individu a été génotypé pour 4838 SNP tous situés dans des loci codants et représentant autant de gènes distincts. Des approches d’association génotype - environnement (GEA) univariées et multivariées (soit RDA et LFMM), ainsi qu'une méthode de détection d’outliers basée sur la différenciation génétique entre les populations (FST) ont été utilisées pour identifier des gènes sous sélection. Un total de 81 SNP / gènes candidats ont montré des associations significatives avec le climat, incluant 19 candidats détectés par au moins deux méthodes statistiques. L’annotation fonctionnelle des gènes candidats a permis de corroborer leur rôle potentiel dans les mécanismes d’adaptation au climat. Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet pourraient aider à soutenir les divers programmes d'amélioration génétique existants pour cette espèce, qui sont essentiels pour les efforts de reboisement dans la forêt boréale.
Mots-clés: adaptation, SNP codant, association génotype-environnement, sélection naturelle, Picea mariana
Fidele Bognounou
Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL)
Autres auteurs
- David Paré (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Evelyne Thiffault (Université Laval)
- Jérôme Laganière (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
PDF non disponible
Bloc 5 -
Session Stocks de carbone #1
Stocks de carbone #1 - 15h00
Les pratiques de gestion forestière, notamment la récolte de biomasse, influencent le bilan carbone (C) des forêts et leur potentiel d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Une meilleure quantification des variations nettes des stocks de C après la récolte est nécessaire pour adapter les pratiques aux engagements climatiques. Cette étude évalue des stocks de C forestier une décennie après coupe, avec et sans récolte de résidus, dans deux sites: Forêt Montmorency (FOM) et Ville La Tuque (VLT). Les stocks de C des débris ligneux de toutes tailles augmentent immédiatement après coupe, diminuent progressivement puis convergent avec le temps, quel que soit le traitement, à l’exception des parcelles témoins de FOM, où un chablis a transféré beaucoup d’arbres vivants en débris ligneux. Le stock de C des petits arbres en régénération ne diffère pas entre les traitements de récolte. Toutefois, ce stock est supérieur au témoin à VLT alors qu’il est encore pratiquement nul à FOM 10 ans après récolte. Le stock de C dans la couche organique du sol a connu une augmentation initiale suivie d’une baisse, avec des tendances variables d’un site à l’autre. Le stock de C dans le sol minéral a montré peu de variations en fonction de la profondeur et des traitements, sauf une augmentation dans l’horizon intermédiaire dans le traitement sans récolte après 5 ans à FOM. Bien que des différences aient été observées selon les méthodes de récolte et dépendamment des compartiments, l’effet de la récolte de biomasse sur les stocks de C semble s’atténuer avec le temps et pourrait ne plus être significatif après 10 ans. Un suivi à plus long terme est nécessaire pour confirmer ces résultats et mieux comprendre l’évolution du C dans les sols et la végétation après récolte de biomasse.
Mots-clés: séquestration du carbone, récolte de biomasse, coupe forestière, carbone du sol organique, carbone du sol minéral, carbone des débris ligneux
Louis Allard
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Pierre-Luc Couillard (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Pierre Grondin (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Mathieu Bouchard (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 5 -
Session Trajectoire de la composition forestière dans l'est du Québec
Trajectoire de la composition forestière dans l'est du Québec - 15h00
Le hêtre à grandes feuilles est en expansion dans le sous-bois des érablières du Québec, et tend à remplacer des espèces comme l'érable à sucre. Cet envahissement par le hêtre constitue un enjeu écologique important, ainsi qu’un enjeu potentiel pour la mise en valeur des forêts, puisque le hêtre est généralement moins apprécié que l’érable pour une diversité d’usages. L’objectif de cette étude était de voir si le régime de coupes partielles successives pratiqué depuis les années 1960 pourrait avoir contribué à l’expansion du hêtre, et si le maintien d’un régime similaire pourrait aggraver la situation actuelle. 5 érablières comportant une proportion importante de hêtre ont été étudiées le long d’un gradient est-ouest, de Portneuf à l’Outaouais. Dans chaque peuplement, la structure d’âge des arbres a été établie par dendrochronologie et un inventaire dendrométrique a été réalisé. Les caractéristiques dendrométriques ont révélé qu’il y a un déséquilibre entre la proportion de hêtre dans le couvert dominant et celle dans les strates de haute et de basse régénération. La dendrochronologie a révélé que l’augmentation de recrutement du hêtre a commencé entre 1950 et 1990 selon les sites. Les périodes où le recrutement est le plus abondant sont associées à des coupes partielles ou au verglas de 1998. Enfin, les résultats ont permis d’identifier des cohortes d’arbres distinctes, ayant été recruté à la suite de coupes partielles successives. La composition de ces cohortes suggère que le recrutement de hêtre par rapport à l’érable augmente d’une coupe à l’autre. Les résultats suggèrent que les perturbations partielles du couvert comme les coupes partielles pourraient accélérer l’expansion du hêtre en sous-bois.
Mots-clés: hêtre à grandes feuilles, coupes partielles, dendrochronologie
Maxence Soubeyrand
Postdoctorant.e
UQAT
Autres auteurs
- Fabio Gennaretti (UQAT)
- Pierre Grondin (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Yves Bergeron (UQAT)
- Marie-Hélène Brice (Université de Montréal)
PDF non disponible
Bloc 5 -
Session Effets du climat #1
Effets du climat #1 - 15h00
Les populations nordiques d'espèces tempérées des forêts du Québec résident généralement dans des habitats extrêmes, tant au niveau climatique que topographique et édaphique. Dans ces habitats, les espèces tempérées atteignent leur limite de tolérance écologique, ce qui impacte leur croissance et leur survie par rapport aux populations plus méridionales. Dans le contexte des changements climatiques, ces habitats pourraient devenir plus favorables pour leur développement, mais les conditions topographiques et édaphiques pourraient atténuer les effets positifs des changements climatiques. Cette étude vise à comparer l'habitat des populations marginales nordiques à celui des populations méridionales pour quatorze espèces d'arbres tempérés au Québec, et à identifier les facteurs limitant leur abondance au nord de leur répartition. Nous avons utilisé les données d’abondance de 97 606 inventaires provenant de placettes permanentes et temporaires du gouvernement du Québec. En utilisant le modèle random forest, nous avons modélisé l’abondance des espèces tempérées en fonction de variables de température et de précipitation, de variables topographiques, de sols et des dynamiques de peuplements. Nous avons ensuite analysé les valeurs de SHAP (SHapley Additive exPlanations) utilisées pour mesurer l’importance ainsi que le sens de la contribution en abondance de chaque variable explicative sur chacune des observations. Random forest modélisait correctement l’abondance des arbres avec des R² allant de 0.26 pour les espèces érable de Pennsylvanie et épinette rouge jusqu’à 0.57 pour le thuya occidental. L’importance des variables explicatives sur l’abondance était dépendante des espèces: l’érable rouge était fortement influencé par le climat, tandis que l’érable à sucre était davantage affecté par des facteurs édaphiques et topographiques, avec une importance modérée du climat. L’analyse des valeurs SHAP nous a révélé que les températures plus froides dans les populations nordiques avaient pour la plupart des espèces une contribution négative à l’abondance. L’abondance de l’érable à sucre était aussi limitée par les faibles teneurs en nutriments dans le sol et pH trop acide mais était favorisé dans des altitudes plus élevées. La relâche des contraintes climatiques pourrait augmenter l’abondance dans les zones nordiques pour la majorité des espèces, bien que certaines, comme l’érable à sucre, soient limitées par des conditions de sol défavorables.
Mots-clés: Population nordiques; espèces tempérées; random forest
Élise Deschenes
Professionnel.le de recherche
RNCan-CFGL
Autres auteurs
- Kierann R. Santala (RNCan-CFGL)
- Jonathan Lavigne (Lakehead University)
- Isabelle Aubin (RNCan-CFGL)
PDF non disponible
Bloc 5 -
Session Diversité #1
Diversité #1 - 15h00
La capacité des écosystèmes à se rétablir naturellement après perturbation est actuellement peu utilisée en restauration, et les obstacles à la régénération passive des communautés végétales demeurent mal compris. Dans cette étude, nous explorons l'utilisation de la diversité sombre, ou le ‘’dark diversity’’, pour la restauration des écosystèmes. La diversité sombre désigne l’ensemble des espèces absentes d’une communauté, mais théoriquement capables de survivre dans les conditions écologiques de celle-ci. Nous avons combiné cette approche avec l’approche par traits fonctionnels afin d’évaluer le rétablissement des communautés végétales du sous-bois le long d'un gradient de perturbations lié aux fonderies à Sudbury, Ontario, Canada. La région, affectée par des dommages environnementaux liés aux fonderies depuis le 19e siècle, a vu ses forêts se rétablir grâce à d’importantes réductions des émissions depuis les années 1970. L’indice de complétion des communautés (CCI) calculé à l’aide de la diversité sombre a été utilisé afin d’évaluer l’efficacité des efforts de restauration, tout en identifiant les sites nécessitant des interventions supplémentaires pour favoriser leur rétablissement. Les moyennes pondérées par la communauté (CWM) des traits ont ensuite été utilisées pour analyser les relations entre les traits des espèces observées et ceux des espèces de la diversité sombre, facilitant ainsi l’identification des facteurs limitant leur rétablissement. Enfin, nous discutons de la manière dont cette approche peut être utilisée pour améliorer les efforts de restauration en atténuant les obstacles au rétablissement, et nous concluons en présentant les limites et les opportunités qu'elle présente dans le contexte de la restauration écologique.
Mots-clés: restauration passive, restauration forestière, indice de complétion des communautés, traits, pool d'espèces
Amy Heim
Postdoctorant.e
Université de Sherbrooke
Autres auteurs
- Maddie Clark (Agence d'évaluation d'impact du Canada)
- Jeremy Lundholm (Saint Mary's University)
PDF non disponible
Bloc 5 -
Session Diversité #1
Diversité #1 - 15h20
Spatial variability in soil and microclimate variables is often hypothesized to be an important driver of fine-scale plant species richness, as greater variability should lead to more opportunities for coexistence and higher richness, if species are sufficiently specialized on the different conditions available. However, cross scale studies involving plant functional diversity, environmental variability and mean conditions are required to elucidate drivers of community patterns. In this study, we examined the relationships between species richness, functional diversity and environmental heterogeneity in nested plots of 0.25 m2, 1 m2 and 50 m2 in a Nova Scotian coastal heathland. Our study site contained diverse and distinct plant communities, including tree islands, tall shrubs, dwarf shrubs, bogs, and rocky outcrops. Overall, positive or non-linear asymptotic relationships between environmental heterogeneity, richness and functional diversity at the 1 m2 scale provide some support for niche-based explanations of species coexistence in plant neighborhoods. At broader sampling extents, greater topographic heterogeneity may allow distinct plant communities to co-occur within a sample, increasing richness but not functional diversity because functional diversity in leaf and canopy traits are already high within each plant community.
Mots-clés: Functional diversity, heathland, scale, spatial heterogeneity, species diversity
Jane Adim Ijeaku
Étudiant.e au doctorat
UQO
Bloc 5 -
Session Stocks de carbone #1
Stocks de carbone #1 - 15h20
Les réservoirs de la matière organique morte (MOM) représentent une portion significative du carbone forestier mais sa dynamique est complexe et constitue la plus grande source d'incertitude dans la modélisation du carbone. Forest Carbon succession dans LANDIS-II utilise un pré-processus de constitution des réservoirs de la MOM dans les sols à partir de la dernière perturbation catastrophique pour initialiser les réservoirs avant la simulation. Dans les forêts tempérées, où de telles perturbations sont rares, cette approche est peu appropriée et peut mener à des sous-estimations. Nous avons amélioré le processus d'initialisation de la MOM en 1) modélisant manière empirique la MOM dans l’humus et les couches minérales des sols et 2) en imputant les cohortes de chicots observées dans les parcelles d'échantillonnage permanentes au cours des 50 dernières années dans les communautés forestières initiales. La MOM du sol a été modélisé en appliquant un apprentissage automatique par forêts aléatoires pour prédire les stocks de carbone à partir des données du Point d'Observation Écologique (POE) et des variables biophysiques de l'inventaire forestier. Nous avons ensuite effectué une synthèse de la littérature sur les taux de décomposition publiés pour les chicots et les débris ligneux des essences feuillus et résineuses du Québec. Cette revue a révélé que les taux de décomposition des chicots et des débris ligneux grossiers pour les feuillus (~0,08 an-1) étaient deux fois plus rapides que ceux de la plupart des résineux (~0,04 an-1), à l'exception du sapin baumier (0,08 an-1), des valeurs largement plus grandes que celles utilisées dans CBM-CFS3. L'intégration de ces améliorations s’est traduite par des stocks de carbone significativement différents pour presque tous les réservoirs de la MOM et ceux-ci présentent une variation spatiale plus détaillée qu’après une initialisation standard. Ces améliorations sont importantes pour guider les aménagistes vers des stratégies forestière d'atténuation du changement climatique appropriées.
Mots-clés: matière organique morte, carbone organique du sol, chicot, débris ligneux grossiers, taux de décomposition, LANDIS-II, forêt tempérée
Léa Blanchette
Étudiant.e à la maîtrise
UQAM
Autres auteurs
- Guillaume de Lafontaine (UQAR)
- Pierre-Luc Couillard (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Pierre Grondin (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
PDF non disponible
Bloc 5 -
Session Trajectoire de la composition forestière dans l'est du Québec
Trajectoire de la composition forestière dans l'est du Québec - 15h20
La forêt boréale s'étend du nord de la forêt tempérée jusqu'à la limite des arbres et représente 75% de toutes les forêts canadiennes. Ce biome est largement dominé par des espèces résineuses due à une dynamique naturelle régulée principalement par les feux de forêt qui facilitent l’établissement d’essences à cônes sérotineux. Pourtant, dans ce paysage essentiellement coniférien, des bétulaies blanches (Betula papyrifera), se démarquent sporadiquement sur les versants collinéens, souvent orientés vers le sud-est. L'origine, la dynamique, la structure et la composition de ces îlots de feuillus, de plus en plus isolés en progressant vers le nord, restent encore mal comprises et peu étudiées. Afin de comprendre leur mise en place et leur trajectoire, mon étude vise d'abord à faire une caractérisation de ces peuplements marginaux (composition et structure des peuplements) et une analyse du potentiel de régénération sous le couvert forestier. Aussi, mon étude reconstitue l'historique des feux et la composition forestière passée aux échelles plurimillénaire (Holocène) et récente (dernier feu). Je postule que les bétulaies représentent soit i) des écosystèmes reliques qui témoignent d'une étendue ancestrale plus nordique, ii) des écosystèmes transitoires suivant une perturbation récente ou iii) des états alternatifs stables qui marquent le début d'un enfeuillement de la forêt boréale. Je présenterai, lors de cette communication, les résultats des 150 datations au radiocarbone issus de charbons de bois extraits des sols. Ces dates offrent un aperçu de la dynamique forestière plurimillénaire à l’origine de ces bétulaies en comparaison avec des peuplements résineux adjacents sur un gradient latitudinal de plus de 500km. L’identification de ces charbons indique également une divergence au niveau de la composition forestière au cours de l’holocène entre les bétulaies et la matrice forestière environnante et les structures de peuplement me permettent d’esquisser un scénario probable quant à leur trajectoire future dans le paysage boréal canadien.
Mots-clés: Forêt boréale, betula papyrifera, dynamique forestière, holocène, datation radiocarbone
Mandiow Adrien Guy Roger Brou
Étudiant.e à la maîtrise
UQAM
Autres auteurs
- Jérôme Cimon-Morin (Université Laval)
- Evelyne Thiffault (Université Laval)
- Frédérik Doyon (UQO)
PDF non disponible
Bloc 5 -
Session Effets du climat #1
Effets du climat #1 - 15h20
Les forêts contribuent à la régulation du climat de par leur albédo, qui varie selon la latitude, la couverture neigeuse, la topographie, l'âge des peuplements et les perturbations les affectant . Optimiser le potentiel d’atténuation de l’albédo peut néanmoins s’opposer à celui de la séquestration du carbone par les forêts. Le projet ACCFor intégre l'effet de l'albédo dans la modélisation pour maximiser les bénéfices climatiques de la gestion forestière au Québec. Plus spécifiquement, l’objectif de ce projet est de développer un modèle permettant de prédire l’albédo à l’échelle du peuplement et d’identifier les variables forestières responsables de sa variation sur le territoire du Québec. Pour ce faire, nous avons utilisé les estimations d’albédo mensuel dérivés des données satellitaires Sentinel-2 et avons mis celles-ci en relation avec les variables biophysiques de l’inventaire écoforestier dans un modèle structuré en trois niveaux hiérarchiques. Nous avons ensuite développé un modèle prédictif d’apprentissage machine de forêts aléatoires pour chaque région écologique du Québec. Pour la région 2a, le modèle construit obtient un R2 de 84%. Outre les variables liées au climat, celui-ci fait intervenir principalement lle type de couvert (F > M > R), la classe de densité (B > A = C > D) et la classe de hauteur (basse > haute) des peuplements. Ces résultats montrent que la gestion de la composition, de la densité des peuplements et de la durée des rotations peut influencer l’effet net sur le climat.
Mots-clés: Albédo, Sentinel-2, terrain, caractéristiques des peuplements, climat, modélisation hiérarchique, modèle de forêts aléatoires, atténuation des changements climatiques
Elise Berthiaume
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Autres auteurs
- Guillaume Grosbois (UQAT)
- Bruno Drolet (Université Laval)
- Miguel Montoro Girona (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 5 -
Session Diversité #1
Diversité #1 - 15h40
Au Québec, la bande riveraine de 20 mètres est l’un des seuls outils sylvicoles cherchant à mitiger les effets néfastes des coupes forestières sur les milieux aquatiques. À l’échelle de la province, il est estimé que les bandes riveraines de tous les lacs, cours d’eau et milieux humides représentent 10% des forêts productives. Toutefois, la contribution de la bande riveraine pour la biodiversité demeure mal comprise, surtout à long terme. Notre projet vise donc à évaluer le rôle de la bande riveraine pour le maintien de la diversité végétale, aviaire et mammifère, 15 à 20 ans après une CPRS. À cet effet, nous avons échantillonné 40 sites en Abitibi, la moitié étant des bandes riveraines et l’autre, des zones riveraines témoins. Suivant une approche multi taxon, nous avons réalisé un inventaire des plantes par transects, des oiseaux à l’aide d’enregistreurs acoustiques et des mammifères avec des pièges photographiques. Nos résultats indiquent qu’en moyenne les bandes riveraines présentent 3 espèces végétales, 4 espèces aviaires et 1 espèces mammifères de plus que les témoins, 15 à 20 ans après la coupe. Toutefois, ces deux milieux abritent des communautés végétales et aviaires significativement différentes. Au total, nous avons identifiés 13 espèces indicatrices des bandes riveraines et 5 associés aux témoins. Enfin, nos analyses ont déterminé que la composition végétale est influencée par la profondeur de la matière organique, la richesse en espèces arborescente et la densité du peuplement, alors et que la composition en oiseaux et en mammifères est modulée par la densité de bois mort. Ces résultats montrent que la diversité des bandes riveraines est complexe. En effet, ces milieux aménagés ne conviennent pas nécessairement à toutes les espèces riveraines. Néanmoins, la bande riveraine contribue au maintien de la diversité, à long terme, assumant un rôle clé dans un paysage forestier aménagé.
Mots-clés: biodiversité, bande riveraine, aménagement forestier écosystémique, forêt boréale
Marianne Bouthillette
Université de Montréal
Autres auteurs
- Marie-Hélène Brice (Université de Montréal)
- Pierre-Luc Couillard (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Pierre Legendre (Université de Montréal)
PDF non disponible
Bloc 5 -
Session Trajectoire de la composition forestière dans l'est du Québec
Trajectoire de la composition forestière dans l'est du Québec - 15h40
Le déclin de la biodiversité, principalement causé par les activités humaines, observé mondialement est préoccupant. Avec l’augmentation soutenue des changements climatiques, la croissance de la population mondiale et l’intensification des activités anthropiques, il est impératif de surveiller la perte de biodiversité afin d’identifier des solutions pour la ralentir. Dans le cadre d’un important suivi de la diversité végétale couvrant le Québec méridional, 228 placettes ont été inventoriées en 1986-1992 puis en 2020-2023 dans les Moyennes Appalaches, au Bas-Saint-Laurent. Ce suivi est une occasion unique d’explorer les changements de diversité végétale qui ont eu lieu durant les dernières décennies. Des tests de comparaison de moyennes révèlent une augmentation de richesse au cours du temps dans cette région. En effet, pour chaque unité d’échantillonnage, on observe en moyenne un gain d’une espèce pour les arbres ainsi que les mousses et les lichens, et de trois espèces pour les herbacées. Toutefois, une analyse de la diversité bêta temporelle nuance ce résultat en confirmant qu’il y a des changements significatifs dans la composition en espèces. Ces changements seraient principalement attribués au climat avec une influence limitée des perturbations. De plus, par leur abondance ou leur présence, 109 espèces ont significativement changé entre les deux inventaires. Parmi celles-ci, on retrouve une augmentation marquée de l’abondance de plusieurs espèces d’arbres, telles que le sapin baumier et le bouleau jaune, et de la présence d’autres espèces d’arbres, comme l’érable rouge. Il y a aussi une augmentation élevée de la présence d’herbacées et de mousses et lichens, notamment la trientale boréale, la dryoptère spinuleuse et les cladonies. On retrouve aussi une diminution notable de l’abondance de l’épinette rouge ainsi que de la présence de certains lycopodes et de violettes. Qu’est-ce que cela implique pour la biodiversité du Bas-Saint-Laurent ?
Mots-clés: biodiversité, végétation, changements climatiques, perturbations
Miray Andrianirinarimanana
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Jean-François Boucher (UQAC)
- Nelson Thiffault (RNCan-Centre canadien sur la fibre de bois)
- Xavier Cavard (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 5 -
Session Stocks de carbone #1
Stocks de carbone #1 - 15h40
Le scarifiage suivi de plantation d’arbres est un traitement sylvicole couramment utilisé en forêt boréale, notamment pour pallier le manque de régénération naturelle de l’épinette noire (EPN, Picea mariana (Mill.), B.S.P.) après une coupe avec protection des régénérations et des sols (CPRS). Toutefois, ces peuplements deviennent fréquemment dominés par des plantes éricacées, qui entravent la croissance des arbres. Étant donné que les forêts d’EPN constituent d’importants puits de carbone, nous avons évalué les effets du scarifiage sur leur stock de carbone aérien, 20 ans après traitement.
Nous avons ainsi réalisé des inventaires de la végétation et calculé la biomasse, puis le stock de carbone de chaque étage de la végétation dans des dispositifs expérimentaux de scarifiage établis il y a environ 20 ans. Nous avons d’abord comparé les parcelles scarifiées aux peuplements naturellement régénérés après CPRS. Ensuite, nous avons évalué l’effet du climat en comparant des parcelles plantées avec et sans scarifiage préalable dans deux régions contrastées du Québec (Canada) : la Côte-Nord (climat froid et humide) et l’Abitibi-Témiscamingue (climat plus chaud et sec).
Nos résultats montrent que, 20 ans après le traitement, le stock de carbone des arbres dans les parcelles scarifiées est comparable à ceux des peuplements bien régénérés naturellement. Dans les plantations expérimentales, le scarifiage a eu un impact positif significatif sur le stock de carbone des arbres mais uniquement sur la Côte-Nord, où la compétition avec les éricacées était plus forte. Enfin, nous avons observé des effets négatifs à long terme du scarifiage sur la biomasse du sous-bois, mais qui pourrait influencer positivement la régénération et la productivité forestière futures. Notre étude souligne l'importance de prendre en compte les conditions environnementales des sites lors de l'application des traitements sylvicoles et mettent en évidence le rôle important de la végétation du sous-bois dans la dynamique des peuplements et du carbone.
Mots-clés: scarifiage, Picea mariana, stock de carbone, végétation du sous-bois
Édouard Reed-Métayer
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Claire Depardieu (Université Laval)
- Patrick Lenz (RNCaN-CFL)
- Jean Bousquet (Université Laval)
- Martin Perron (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
PDF non disponible
Bloc 5 -
Session Effets du climat #1
Effets du climat #1 - 15h40
Les changements climatiques imposent des stress auxquels les arbres devront s’adapter, notamment des événements météorologiques sévères plus fréquents en raison de la variabilité accrue du climat. L’épinette noire et l’épinette rouge sont des espèces phylogénétiquement proches, mais adaptées à des conditions écologiques différentes. De plus, elles forment une vaste zone hybride naturelle là où leurs aires de répartition se chevauchent. Elles constituent ainsi un modèle intéressant pour étudier l’effet de l’hybridation et de l’introgression dans le contexte des changements climatiques, sachant que le flux génétique interspécifique pourrait éventuellement influencer leur capacité d’adaptation dans les zones où leurs répartitions naturelles se recoupent. Dans cette étude, des arbres issus de croisements dirigés rigoureux, et dont l’identité génétique des parents avait été préalablement vérifiée moléculairement, ont été placés en test de jardin commun et étudiés après 20 ans. Une approche dendroécologique, basée sur l’analyse de cernes annuels de carottes de bois, a révélé des différences significatives de croissance et de densité du bois entre les deux espèces, ainsi qu’entre celles-ci et leurs hybrides F1. L’analyse des données a aussi montré que l’épinette noire et l’épinette rouge présentaient des réponses similaires lors de stress liés à des épisodes météorologiques sévères. Cependant, ces réponses variaient entre le bois initial et le bois final, indiquant des adaptations divergentes de la phénologie cambiale entre espèces, elles-mêmes probablement fonction d’adaptations à la durée de la saison de croissance. Les hybrides F1 ont montré une vigueur hybride pour la croissance cumulative à long terme dans les conditions du site expérimental et des valeurs intermédiaires pour les traits liés à la réponse au stress. Ces résultats contribuent à une meilleure compréhension des dynamiques d’adaptation au climat dans les zones hybrides et pourraient éclairer la gestion des ressources génétiques forestières face aux défis climatiques à venir.
Mots-clés: Dendroécologie, Hybridation interspécifique, Stress climatiques, Sécheresse, Froid, Résilience
Hiba Merzouki
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Vincent Poirier (UQAT)
- Alison Munson (Université Laval)
- Annie DesRochers (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 6 -
Session Diversité #2
Diversité #2 - 16h10
Les amendements de sol sont de plus en plus utilisés dans les plantations de la forêt boréale pour améliorer la productivité, mais leurs effets sur la végétation du sous-bois sont encore mal compris. Le biochar (2,6 Mg ha-1), les cendres de bois (7 Mg ha-1) et le fumier (105 Mg ha-1) ont été utilisés seuls ou en combinaison, et les effets sur la végétation de sous-bois ont été évalués après deux saisons de croissance. Nous avons mesuré les indices de diversité et évalué la composition des communautés végétales du sous-bois. Les effets des amendements sur les traits fonctionnels ont été évalués au niveau des espèces et de la communauté végétale. Nos résultats montrent que le fumier a significativement augmenté l'indice de biodiversité de Shannon de 14 %, favorisé l'établissement de graminées et de légumineuses non indigènes, et augmenté la diversité fonctionnelle de 18 % par rapport aux traitements sans fumier. En revanche, le biochar et les cendres de bois n'ont pas modifié de manière significative la diversité végétale. Le biochar a maintenu une composition végétale similaire à celle du témoin, tandis que les cendres de bois ont introduit des espèces supplémentaires. Les deux amendements ont favorisé l'établissement d'espèces ligneuses rudérales et forestières typiques des perturbations forestières, les cendres de bois augmentant significativement la teneur en azote des feuilles de 9 % par rapport aux traitements sans cendres de bois. Cette étude souligne l'importance de combiner les approches taxonomiques et fonctionnelles pour obtenir une vision globale des effets des amendements du sol sur la diversité et le fonctionnement des communautés végétales de sous-bois.
Mots-clés: Végétation de sous-bois, diversité, traits, diversité fonctionnelle
Julie Lalouer
Étudiant.e à la maîtrise
UQAC
Autres auteurs
- Valérie Néron (UQAC)
- Stéphane Bourassa (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Kaysandra Waldron (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Dominique Boucher (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Annie Deslauriers (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 6 -
Session Effets du climat #2
Effets du climat #2 - 16h10
Avec les changements climatiques actuels, incluant une augmentation des températures et des changements de régimes de précipitations, l’habilité des forêts boréales à se maintenir de manière durable est compromise. Afin de prédire les réponses de la forêt à ces changements, il est important de comprendre les mécanismes physiologiques de l’acclimatation au froid des arbres, deux mécanismes impliquant la dessication des tissus. En effet, le stress hydrique et la résistance au froid implique une augmentation de la concentration en sucres modifiant l’osmolarité des tissus. L’objectif de ce projet est d’étudier l’osmolarité, le potentiel osmotique de l’eau, l’allocation en sucres et le contenu en eau durant l’hiver sous différents régimes de températures et de sécheresse se produisant l’été. Les espèces étudiées sont le sapin baumier (Abies balsamea, L. Mill.) et l’épinette noire (Picea mariana B.P.S. Mill.). Les mesures incluent la résistance au froid (exprimée par la température léthale de 50 % des cellules LT50), la concentration en sucres et en amidon, l’osmolarité et le contenu en eau des aiguilles des deux espèces durant deux hivers. Durant l’hiver 2023-2024, les deux espèces sont très résistantes avec une absence de lyse cellulaire à des températures allant jusqu’à -100°C de décembre à mars. La LT50 varie significativement en fonction du temps (p<0.001) mais pas en fonction de l’essence ni du traitement. Les variables physiologiques (osmolarité, concentration en glucose, fructose, saccharose) varient significativement en fonction du temps (p<0.001). Seuls l’osmolarité (p<0.001) et la concentration en glucose (p=0.005) varie significativement en fonction de l’essence. La concentration en saccharose est la seule variable qui varie significativement en fonction du traitement de température (p=0.007). Durant l’hiver 2024-2025, la même observation d’absence de lyse a été réalisée jusqu’à une température de -150°C en décembre ce qui pourrait nous indiquer que ces espèces sont super résistantes au froid.
Mots-clés: Acclimatation au froid, Osmolarité, Sucres, Conifères
Théophile Kabasele Walelu
Étudiant.e au doctorat
Université de Montréal
Autres auteurs
- Marie-Hélène Brice (Université de Montréal)
- François Girard (Université de Montréal)
PDF non disponible
Bloc 6 -
Session Trajectoire de la composition forestière dans l'est du Québec #2
Trajectoire de la composition forestière dans l'est du Québec #2 - 16h10
Les changements climatiques observés et projetés peuvent déplacer les niches climatiques des essences forestières, facilitant ainsi la migration des essences tempérées vers la forêt boréale. Les populations marginales nordiques, petites et dispersées, jouent un rôle clé dans cette migration. Parmi les espèces d'arbres au Québec, l'érable rouge (Err) est le plus susceptible de migrer vers le nord de sa répartition actuelle en raison des changements climatiques.
À sa limite nord, au sein de la sapinière à bouleau blanc, l'érable rouge forme des populations marginales de petite taille, discontinues et dispersées sur les sommets de collines. Leur dynamique contemporaine est liée aux perturbations naturelles et anthropiques telles que les feux, les coupes forestières et les épidémies de tordeuse de bourgeons d'épinettes. Étant positionnées sur les sommets des collines, la première étape de l'expansion des populations marginales nordiques de l'érable rouge s'effectue le long du gradient topographique, de haut en bas.
Les populations marginales de l'érable rouge au sein de la sapinière à bouleau blanc datent des fins des années 1800 et du début des années 1900. L'établissement continu de l'érable rouge au fil du temps sur les sommets des collines est favorisé par les perturbations successives qui créent des ouvertures dans la canopée et des microsites propices à son établissement le long du gradient topographique. Ces perturbations entraînent également une augmentation de la croissance radiale des érables rouges, ainsi que du sapin baumier et du bouleau à papier quelques années après. Ainsi, cet établissement continu permet à l'érable rouge de se maintenir à des niveaux importants au sein des peuplements forestiers, tout en préservant la dominance d'autres espèces telles que le bouleau à papier et le sapin baumier dans le paysage forestier.
Mots-clés: 297
William Brais
Université de Montréal
Autres auteurs
- Julie Talbot (Université de Montréal)
- Paul Del Giorgio (UQAM)
PDF non disponible
Bloc 6 -
Session Stocks de carbone #2
Stocks de carbone #2 - 16h10
Les écosystèmes boréaux, caractérisés par la diversité de leurs paysages comprenant notamment des tourbières, des forêts et des lacs, jouent un rôle central dans le cycle global du carbone (C). Toutefois, la quantification des stocks de C, en particulier ceux situés en profondeur, demeure un défi en raison des limites de la télédétection et de l’accessibilité restreinte des régions éloignées.
Nous avons cartographié les stocks de C du bassin versant de la rivière Bernard (Québec, Canada), un paysage boréal de 64 km² composé principalement de forêts de conifères, de lacs et de milieux humides. En combinant des indices de télédétection, des données topographiques et des covariables environnementales, nous avons estimé les stocks de C dans les principaux compartiments de séquestration. Ces analyses ont été couplées à des mesures en laboratoire, incluant la perte au feu et la spectrométrie élémentaire, ainsi qu’à la datation des sédiments lacustres par Pb-210.
Les résultats obtenus rendent compte de l’importance de la densité de carbone présente dans les milieux humides, qui présentent une densité moyenne de 69.44 kg C/m2 comparativement à 26.93 kg C/m2 pour les sols forestiers et 22.00 kg C /m2 pour les lacs. Cependant, à l’échelle du bassin-versant, le compartiment de stockage le plus important s’avère être les sols forestiers, contenant environ 1740 kilotonnes de C, contre 240 pour les lacs et 45 pour les milieux humides.
Les cartes produites révèlent une hétérogénéité marquée des stocks de C selon la couverture terrestre et les gradients environnementaux. Nos résultats suggèrent que les stocks de C à l’échelle d’un grand bassin versant peuvent être estimés en combinant des techniques de télédétection et des analyses en laboratoire, malgré des données initiales limitées.
Cette approche exploratoire fournit des informations précieuses sur la dynamique régionale du C et pourrait contribuer à l’élaboration de stratégies de gestion pour la séquestration du carbone et l’atténuation des changements climatiques.
Mots-clés: carbone, bassin versant boréal, télédétection, biogéochimie, séquestration du carbone, changements climatiques.
Jeanne Léger
Étudiant.e à la maîtrise
UQAR
Autres auteurs
- Pierre Grondin (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Martin Lavoie (Université Laval)
- Guillaume de Lafontaine (UQAR)
PDF non disponible
Bloc 6 -
Session Trajectoire de la composition forestière dans l'est du Québec #2
Trajectoire de la composition forestière dans l'est du Québec #2 - 16h30
Depuis sa formation postglaciaire, la forêt boréale de l’est de l’Amérique du Nord a subi d’importantes transformations en réponse aux changements du climat et des perturbations naturelles. L’ouverture progressive du couvert forestier subarctique résulte d’une combinaison entre le refroidissement néoglaciaire et une modification du régime des feux. Toutefois, la variabilité des conditions environnementales locales complexifie la réponse de la forêt à cette interaction climat-feux. Cette étude aborde la résilience de la forêt boréale en reconstituant l’histoire des feux et leur rôle dans la dynamique de l’interface forêt-lande alpine sur des sommets aujourd’hui déboisés.
L’étude a été menée sur un gradient latitudinal de 400 km entre la forêt fermée et la toundra-forestière. L’analyse et la datation radiocarbone de 133 macrofossiles de charbon de bois ont permis de reconstruire les régimes de feux passés, tandis que les analyses dendrochronologiques ont documenté la dynamique récente des versants.
Nos résultats indiquent une activité des feux plus marquée vers le nord du gradient. À Caniapiscau-Nord, les sommets densément forestiers ont résisté à un régime de feux récurrents pendant le Néoglaciaire avant de s’ouvrir il y a 700 ans, versus 400 ans à Caniapiscau-Sud. À Fermont, les sommets se sont ouverts 500 ans et 300 ans avant nos jours, mais la plus faible fréquence des feux et l’anthracomasse réduite suggèrent que le couvert forestier n’a probablement jamais été dense à l’Holocène. La quasi-absence de charbon dans les Monts Uapishka indique que les sommets au centre du massif n'ont probablement jamais été boisés. L’âge vénérable des arbres et la structure inéquienne des peuplements dans les vallées des Monts Uapishka suggèrent que les vieux peuplements forestiers colonisent progressivement les versants en réponse au réchauffement suivant le Petit âge glaciaire. De manière similaire, les jeunes forêts plus au nord semblent recoloniser les versants depuis le dernier feu.
Mots-clés: Forêt boréale, feux, écologie forestière
Lukas Van Riel
Étudiant.e au doctorat
Université de Montréal
Autres auteurs
- François Girard (Université de Montréal)
- Marie-Hélène Brice (Université de Montréal)
- Mathieu Bouchard (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 6 -
Session Effets du climat #2
Effets du climat #2 - 16h30
Il est peu probable que les arbres et les communautés forestières puissent suivre le rythme des changements climatiques. Cette discordance aura des répercussions non seulement sur les espèces individuelles, mais également sur la santé des écosystèmes et les services écologiques qu’ils fournissent. Il est donc fondamental de comprendre les décalages spatio-temporels dans le déplacement des aires de répartition des arbres des forêts nordiques afin d’améliorer la précision des modèles prédictifs et d’élaborer des stratégies de conservation efficaces. Nous avons utilisé des mesures d’échanges gazeux pour évaluer la capacité photosynthétique du bouleau jaune (Betula alleghaniensis) au Québec méridional. Cette étude permettra de déterminer si l’espèce se trouve déjà en décalage par rapport à sa niche climatique actuelle. Des individus adultes ainsi que des gaules ont été échantillonnés le long d’un gradient latitudinal de plus de 200 km, s’étendant jusqu’à la limite nord de l’aire de répartition de l’espèce. Nos analyses révèlent que la capacité photosynthétique ne varie pas de manière significative le long de ce gradient, tant chez les arbres matures que chez les gaules. Ces résultats suggèrent que la limite nord du bouleau jaune au Québec résulte davantage de la lenteur de sa migration que d’une contrainte climatique directe. Dans un contexte où l’accélération des changements climatiques est anticipée, les espèces tempérées risquent d’être de plus en plus éloignées de leurs conditions environnementales optimales, ce qui pourrait affecter leur croissance, leur compétitivité et leur résilience à long terme.
Mots-clés: Migration forestière, Capacité photosynthétique, Changements climatiques, Forêts nordiques
Marianne Vogel
Postdoctorant.e
University of Toronto
Autres auteurs
- Nicole Sanderson (UQAM)
- Antonin Prijac (UQAM)
- Nicole Balliston (University of Waterloo)
- Julia Hathaway (University of Toronto)
- Ruth Hall (University of Toronto)
- Natalie Anderson (University of Toronto)
- Grace Cullinane (University of Waterloo)
- Sarah Finkelstein (University of Toronto)
PDF non disponible
Bloc 6 -
Session Stocks de carbone #2
Stocks de carbone #2 - 16h30
Les tourbières du Bouclier boréal couvrent de vastes zones dans le nord-est du Canada et représentent actuellement d'importants stocks et puits de carbone ; toutefois, le réchauffement climatique suscite des inquiétudes quant à la dynamique future du cycle du carbone. Ici, nous estimons les stocks de carbone de la tourbe et les taux d'accumulation dans deux complexes de tourbières boisées, dans le nord de l'Ontario, afin de mieux comprendre les facteurs de variabilité et les changements récents. Nous avons déterminé les principaux prédicteurs des stocks de carbone en surface (0-30 cm) dans une série de 10 monolithes (30 cm) et de cinq profils de tourbe complet (tout le profil) à partir des principales caractéristiques environnementales - comme le type de végétation, la profondeur de la tourbe, la pente, le niveau de la nappe phréatique et la densité des arbres. Il apparaît que la tourbière boisée (« bog ») et le marécage boisé (« swamp ») sont les tourbières associées aux stocks de carbone les plus élevés, éventuellement dus à une matière organique moins labile ou plus dense, tandis que la profondeur totale de la tourbe et la nappe phréatique sont des facteurs supplémentaires négativement corrélés aux stocks de carbone en surface. Plusieurs profils sont datés au 210Pb et 14C et permettent d'estimer les taux d'accumulation de carbone. Grâce à un coefficient de décomposition, nous comparons les stocks de carbone récents (RERCA) et à long terme (LORCA). Notre recherche teste l'hypothèse selon laquelle l'allongement de la période de végétation apporte suffisamment de biomasse supplémentaire pour entraîner une augmentation du taux d'absorption du carbone. L’ensemble de ces résultats permettent d'estimer avec plus de précision les stocks de carbone récents et de mieux prévoir les conséquences futures des changements des tourbières du Bouclier boréal et du réchauffement climatique.
Mots-clés: Stocks de carbone, Taux d'accumulation du carbone à long terme (LORCA), Taux d'accumulation du carbone récent (RERCA), Tourbières, Type de végétation
Mialintsoa Aroniaina Randriamananjara
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Bloc 6 -
Session Diversité #2
Diversité #2 - 16h30
Les peuplements mixtes sont reconnus pour abriter des communautés végétales de sous-bois plus diversifiées que les peuplements monospécifiques. Toutefois, les recherches sur l’influence des mélanges d’espèces arborées se sont principalement concentrées sur les associations conifères-feuillus, laissant peu de données pour évaluer si le mélange d’espèces au sein d’un même genre pourrait aussi favoriser la biodiversité de la végétation de sous-bois par rapport aux plantations monospécifiques.Cette étude visait à évaluer comment les plantations monoclonales (un seul clone) et polyclonales (deux clones ou plus) de peuplier hybride (Populus spp.) influencent la diversité et la composition de la végétation de sous-bois, ainsi que la diversité des traits fonctionnels de cette végétation. Quatre clones de peuplier hybride ont été sélectionnés : Clone1 (Populus trichocarpa Torrey & A. Gray × balsamifera L.), Clone2 et Clone3 (P. balsamifera × maximowiczii Henry), et Clone4 (P. maximowiczii × balsamifera). Ces clones ont été établis en plantations monoclonales et polyclonales sur trois sites répartis le long d’un gradient latitudinal. Nos résultats ont montré que les plantations polyclonales favorisaient une plus grande diversité fonctionnelle des plantes par rapport aux plantations monoclonales, en particulier dans les environnements plus contraignants. La composition fonctionnelle des communautés végétales dans les plantations polyclonales reflétait un assemblage des traits fonctionnels observés dans chaque plantation monoclonale. Par ailleurs, l’effet du type de plantation sur la biodiversité du sous-bois variait selon le site de plantation.Notre étude suggère que les plantations polyclonales sont une option prometteuse pour améliorer la biodiversité de la végétation de sous-bois et qu’elles pourraient contribuer à la création d’habitats hétérogènes pour une plus grande diversité fonctionnelle.
Mots-clés: peuplier hybride, clone, plantation, végétation de sous-bois, biodiversité, trait fonctionnel
Antoine Harel
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Autres auteurs
- Evelyne Thiffault (Université Laval)
- David Paré (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Renée Hudon (Université Laval)
- Maude Larochelle (Hydro-Québec)
- François Bilodeau (Hydro-Québec)
PDF non disponible
Bloc 6 -
Session Stocks de carbone #2
Stocks de carbone #2 - 16h50
Le Québec est traversé par près de 35 000 km de ligne de transport d’électricité, principalement en milieu forestier. Ces lignes créent un effet de bordure qui influence la dynamique du carbone dans les forêts adjacentes. Néanmoins, cet effet sur les flux de CO2 (FCO2) et de CH4 (FCH4) entre le sol et l’atmosphère reste peu étudié. Or, FCO2 est un flux de carbone important à l’échelle de l’écosystème forestier puisqu’il peut influencer la capacité de l’écosystème à agir comme un puits ou une source de carbone dans l'atmosphère. L’objectif principal de mon projet est de documenter le comportement de FCO2 et de FCH4 dans les forêts adjacentes aux lignes, ainsi qu’en dessous de celle-ci (i.e. emprise). Entre mai et octobre 2023 et 2024, nous avons réalisé des mesures ponctuelles de FCO2 et de FCH4 dans 8 sites répartis dans un gradient climatique au Québec. Concernant FCO2, la méthode de mesure utilisée a permis de séparer et de quantifier le CO2provenant de l’activité microbienne du sol (FCO2 hétérotrophe) du CO2 dérivé des racines (FCO2 autotrophe). Les flux de CO2 totaux étaient significativement plus élevés (+9,78 %) dans la forêt de bordure par rapport à la forêt témoin et significativement plus faibles (-8,79 %) dans l’emprise par rapport à la forêt témoin. En revanche, aucune différence significative n’a été observée pour les flux de CO2 hétérotrophes. Ces résultats mettent en évidence (1) l’importance du CO2 dérivé des racines et donc de la végétation aérienne, et (2) que les différences de microclimat (température et teneur en eau du sol) entre l’emprise, la forêt de bordure et la forêt témoin ne se répercutent pas sur FCO2, contrairement à notre hypothèse initiale. FCH4 dans les emprises ne sont pas significativement différent de ceux de la forêt témoin, et il n'y a pas d'effet de bordure. Comprendre comment l’effet de bordure influence FCO2 et FCH4 nous permettra de mieux comprendre la dynamique du carbone dans les forêts de bordure.
Mots-clés: Effet de bordure, Flux de CO2 du sol, emprise, dynamique du carbone
Mamitiana Arielle Rasoanaivo
Étudiant.e au doctorat
UQO
Bloc 6 -
Session Diversité #2
Diversité #2 - 16h50
Face aux changements climatiques, la biodiversité a été mise en avant comme stratégie d'adaptation des forêts compte tenu de sa corrélation positive avec la productivité. Cependant, une plus grande productivité s’accompagne souvent d’une augmentation de l’utilisation de l’eau par les arbres. Très peu d’études se sont penchées sur l’effet de la biodiversité sur le bilan hydrique forestier. L'objectif de ce projet est de comprendre l'effet de la diversité des espèces sur la transpiration des arbres. Le projet a été mené sur le site expérimental IDENT (International Diversity Experiment Network with Trees) à Montréal. La transpiration des arbres a été mesurée à l'aide de senseurs de flux de sève installés sur 44 arbres appartenant à quatre espèces natives des forêts tempérées nord-américaines (Acer rubrum, Betula alleghaniensis, Betula papyrifera, Quercus rubra). Pour chaque espèce, la densité de flux de sève (Fd), qui représente le flux par unité de surface de bois d’aubier, des arbres en monoculture a été comparée à celle des arbres dans des mélanges de deux et quatre espèces. Les résultats ont montré que l’effet de la diversité sur Fd varie selon l’espèce. Pour Betula papyrifera et Acer rubrum, Fd en mélange à deux espèces est réduit par rapport à la monoculture pour les arbres de petite taille (DHP < 7 cm), mais on observe l’effet inverse pour les arbres de grande taille (7 < DHP < 11 cm. Toutefois, en mélange à quatre espèces, Acer rubrum montre un Fd plus faible pour les arbres de grande taille. Pour Betula alleghaniensis et Quercus rubra, aucun effet significatif de la diversité sur Fd n’a été observé. Ces résultats soulignent la grande variabilité dans les effets de la diversité sur la transpiration des arbres, avec des effets pouvant varier selon l’espèce, la taille des arbres et le niveau de diversité du mélange.
Mots-clés: diversité, densité de flux de sève, utilisation de l?eau, forêt tempérée, IDENT
Philippe Blier
Étudiant.e à la maîtrise
UQAR
Autres auteurs
- Pierre Grondin (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Guillaume de Lafontaine (UQAR)
- Luc Sirois (UQAR)
PDF non disponible
Bloc 6 -
Session Trajectoire de la composition forestière dans l'est du Québec #2
Trajectoire de la composition forestière dans l'est du Québec #2 - 16h50
Dès le début du XIXe siècle, von Humboldt a observé des similitudes dans l’étagement de la végétation le long des gradients d’altitude à travers le monde. Ce phénomène reflète des facteurs climatiques tels que la baisse des températures, l’augmentation des précipitations, l’augmentation de la force des vents et une saison de croissance réduite, qui influencent la distribution des espèces et structurent des étages de végétation régionaux. Nous avons étudié ce patron en Gaspésie en appliquant l’allocation latente de Dirichlet (LDA), une méthode bayésienne permettant d’identifier des assemblages d’espèces récurrents. À notre connaissance, il s’agit de la première utilisation de cette approche pour analyser l’étagement altitudinal de la végétation. Nos analyses reposent sur des données issues de 1839 parcelles forestières de 400 m² réparties dans la péninsule gaspésienne. La LDA permet de i) détecter des assemblages d’espèces similaires, ii) identifier les espèces caractéristiques de chaque groupe et iii) attribuer une probabilité d’appartenance des placettes à ces assemblages. Nos résultats montrent une transition de la forêt tempérée au niveau de la mer jusqu’à la toundra alpine dominée par les éricacées et les lichens aux altitudes les plus élevées. L’influence des variables environnementales sur la distribution des assemblages a été évaluée à l’aide de modèles additifs généralisés mixtes (GAMM). Ceux-ci confirment que l’altitude est un facteur clé de structuration de la végétation en Gaspésie. En utilisant un modèle LDA indépendant des données environnementales, nous avons identifié des assemblages végétaux reflétant fidèlement le schéma d’étagement altitudinal de la flore régionale.
Mots-clés: Étagement de la végétation, Assemblage floristique, Latent Dirichlet Allocation (LDA), Gaspésie
Thaulin Dushimiyimana
Étudiant.e au doctorat
UQAC
Autres auteurs
- Frédérik Doyon (UQO)
- Jean-François Boucher (UQAC)
- Arthur Guignabert (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgium)
- Evelyne Thiffault (Université Laval)
- Catherine Périé (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
PDF non disponible
Bloc 6 -
Session Effets du climat #2
Effets du climat #2 - 16h50
The accurate prediction of forest carbon dynamics is crucial for assessing the mitigation potential of forest management strategies in the context of climate change. We used the HETEROFOR model to simulate carbon dynamics of boreal spruce-moss forests in Québec. HETEROFOR is a process-based forest dynamics model that explicitly represents individual trees in three-dimensional space, monitoring photosynthesis, phenology, carbon allocation (growth and maintenance), and water balance. Its forest carbon module enables monitoring of biomass and necromass in all compartments, including soil. The model has been parameterized and calibrated for black spruce (Picea mariana) and associated species: balsam fir (Abies balsamea), trembling aspen (Populus tremuloides), and white birch (Betula papyrifera). As the model was not previously parameterized for jack pine (Pinus banksiana), its specific parameters were compiled from literature and open datasets and integrated into the model. Calibration was performed using tree inventory data, soil databases from eight RESEF network plots, and ERA5 climate data (1989-2023). A short-term five-year tree growth simulation was conducted to ensure accurate parameterization by comparing the model predictions with observed data. We found very good model adjustments for tree BAI growth across all five species, but mortality was less predictable due to stochastic events at the tree level. However, at the stand level, the model accurately predicted survival, mortality, and ingrowth. The parameterized and calibrated HETEROFOR model will serve to test impacts of climate change (using SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5) and management practices (clear-cutting, irregular shelterwood cuts, and changing species composition) on carbon dynamics and stock over the long term; 77 years (2023-2100). This study aims to improve precision of carbon stock and flux forecasts and enhance decision-making for forest management and climate adaptation in Québec's boreal forests.
Mots-clés: Boreal forest, Carbon dynamics, forest management, HETEROFOR model and climate change
Catherine Potvin
Université McGill
PDF non disponible
Bloc 7 -
Session Conférence principale #2
Grande Salle #2 - 08h15
J'ai terminé mon doctorat en botanique à l'université Duke en 1985. Je travaillais déjà sur les changements climatiques. J'ai maintenant le luxe de regarder en arrière pour démêler les fils de ce qui est devenu ma carrière. Je vous ferai remonter le temps en partageant mes impressions sur l'évolution du lien entre la compréhension du rôle des forêt dans le cycle du carbone et les politiques climatiques. Étant actuellement très préoccupée par la conservation des forêts je présenterai quelques pistes de réflexions quant à l'individualisme et la collectivité inspiré bien sûr par des années de collaborations avec des Peuples autochtones.
Mots-clés: changements climatiques
Alexis Achim
Chercheur.e régulier.ère au CEF
Université Laval
PDF non disponible
Bloc 8 -
Session Conférences de nouveaux chercheurs.es au CEF #2
Conférences de nouveaux chercheurs.es au CEF #2 - 09h30
Je présente un tour d’horizon de mon parcours en recherche en démontrant comment une approche collaborative et interdisciplinaire a permis à mon équipe de contribuer à l’élargissement des cadres de la science sylvicole. Je fais un retour sur des projets qui ont mené à des partenariats structurants et des contributions scientifiques dont l’impact a largement dépassé les limites de mon propre programme de recherche. L’un des faits marquants de mon passage comme chercheur à l’institut Forest Research à Édimbourg, en Écosse, fut mon implication dans des projets regroupant plusieurs institutions de recherche à l’échelle européenne, via notamment les projets Ecoslopes (ancrage des arbres au sol) et EFORWOOD (modélisation de la chaine de création de valeur à l’échelle européenne). Dès mon arrivée à l’Université Laval comme professeur adjoint en 2007, j’ai retrouvé cet esprit de collaboration, mais à l’échelle nationale cette fois, à travers des projets comme ForValueNet (sylviculture et valorisation du bois) et AWARE (utilisation du LiDAR pour prédire les propriétés des approvisionnements en bois) qui se sont voulus d’importants catalyseurs du développement de mon programme de recherche. Notre travail sur le LiDAR aéroporté, et plus particulièrement le développement du package lidR dans R par Jean-Romain Roussel, a transformé profondément mon programme de recherche en ajoutant la télédétection comme outil facilitant la mise en œuvre d’une sylviculture mieux adaptée à des réalités changeantes. Cette approche constitue d’ailleurs l’une des assises du projet pancanadien Silva21 qui vise à fournir des données, des outils et des solutions pratiques pour améliorer la résistance des forêts canadiennes à diverses perturbations et sources de stress, contribuant ainsi à la santé de ces écosystèmes et au bien-être des communautés qui en dépendent. Je termine en évoquant les leçons que j’ai tirées de mon parcours en recherche ainsi que les prochaines initiatives que je développe avec mon équipe et qui nous apporteront de nouvelles opportunités de collaboration et de développement.
Mots-clés: Bois ingénierie, sylviculture
Morgane Urli
Chercheur.e régulier.ère au CEF
UQAM
PDF non disponible
Bloc 8 -
Session Conférences de nouveaux chercheurs.es au CEF #2
Conférences de nouveaux chercheurs.es au CEF #2 - 09h50
Les projections climatiques montrent des modifications de la quantité, du type et de la distribution saisonnière des précipitations, ainsi qu’une augmentation de la sécheresse atmosphérique en raison de l’augmentation des températures. Il est crucial d’évaluer la vulnérabilité des forêts boréales et tempérées nordiques aux sécheresses afin de prédire les espèces et populations les plus à risque de déclin (ralentissement de la croissance, dépérissement, mortalité, difficultés de régénération). Toutefois, d’importantes questions restent en suspens sur les mécanismes physiologiques conduisant au dépérissement des arbres induits par la sécheresse et sur la façon dont les différentes stratégies adaptatives à la sécheresse, en interaction avec les caractéristiques de la sécheresse (intensité, durée et fréquence) ou d'autres stress biotiques et abiotiques, affectent la vulnérabilité des arbres pendant la sécheresse. L’objectif à long terme de mon programme de recherche est d’évaluer et de surveiller la vulnérabilité des forêts naturelles ou plantées, face aux changements climatiques. À court terme, mes travaux se concentrent sur les forêts boréales et tempérées nordiques à travers des expérimentations contrôlées et sur le terrain. Je réalise cet objectif via notamment l’étude de différents traits fonctionnels liés aux capacités adaptatives des arbres à la sécheresse qui est une approche prometteuse pour comparer la sensibilité des espèces à la sécheresse. En effet, ces derniers sont peu documentés pour les forêts boréales et tempérées nordiques, notamment en ce qui concerne leur variation intraspécifique (entre organes et entre stades de vie de l’arbre) et de l’effet d’autres stress environnementaux. Dans le cadre de l’aménagement d’adaptation des forêts aux changements climatiques, les praticiens de la forêt sont encouragés à se fier aux traits fonctionnels pour les aider à choisir les espèces à promouvoir ou à contrôler. Une meilleure connaissance de ces traits et de leur variabilité est critique pour leur permettre de prendre des décisions éclairées.
Mots-clés: Traits fonctionnels
Janani Sivarajah
Chercheur.e régulier.ère au CEF
Université Laval
PDF non disponible
Bloc 8 -
Session Conférences de nouveaux chercheurs.es au CEF #2
Conférences de nouveaux chercheurs.es au CEF #2 - 10h10
Janani Sivarajah est professeure adjointe au Département des sciences du bois et de la forêt et titulaire de la Chaire de recherche sur l’arbre urbain et son milieu à l’Université Laval. Ses recherches, transdisciplinaires, appliquées et collaboratives, visent à développer des solutions fondées sur la nature pour la gestion durable des environnements urbains et périurbains. Un axe central de ses travaux porte sur la conception de nouveaux outils pour la conservation et l’intégration des arbres en milieu urbain, ainsi que sur l’amélioration de la qualité des sols urbains. Elle s’intéresse également à l’utilisation des arbres pour atténuer les effets du changement climatique. Un autre aspect majeur de ses recherches concerne l’étude des impacts anthropiques sur les forêts urbaines et les sols. La professeure Sivarajah examine comment les conditions urbaines influencent la croissance, la santé et la résilience des arbres, en mettant particulièrement l’accent sur leur capacité à fournir des services écosystémiques et des bienfaits pour les êtres humains. Son travail se situe à l’intersection de la science, de la politique et de la société, et elle collabore étroitement avec les praticiens, les secteurs industriels, les communautés locales et les gouvernements pour aborder de manière intégrée et durable les enjeux environnementaux complexes.
Mots-clés: Urban forest
Audrey Maheu
Chercheur.e régulier.ère au CEF
UQO
Autres auteurs
- Gabriel Bastien-Beaudet (UQO)
- Marc-André Bourgault
- Cha Zhao (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Stress hydrique
Stress hydrique - 10h40
À l’échelle globale, on observe une augmentation du taux de mortalité des arbres et les sécheresses constituent l’une des causes importantes derrière cette tendance. Plusieurs indices météorologiques existent pour identifier les sécheresses mais ceux-ci considèrent de manière variable certains processus hydrologique comme l’évapotranspiration et la fonte de la neige. Or, ces processus constituent des déterminants importants de la disponibilité en eau à certaines périodes de l’année au Québec. L’objectif de cette présentation est de comparer quatre indices météorologiques utilisés pour décrire les sécheresses afin de mettre en relief i) les nuances d’interprétation dans le contexte québécois et ii) les trajectoires divergentes en climat futur. À partir de données de réanalyse (ERA5-Land) et de projections climatiques (NEX-GDDP), quatre indices standardisés ont été calculés : standardized precipitation index (SPI), standardized precipitation-evapotranspiration index (SPEI), standardized snowmelt runoff index (SMRI) et standardized water budget index (SWBI). En climat actuel, les indices sont bien corrélés entre eux, sauf pour la période printanière où la fonte a une grande influence sur l’évaluation des conditions de sécheresse. En climat futur, les indices montrent une augmentation des conditions sèches sévères, mais l’ampleur des changements projetés varie largement selon les processus considérés. Au printemps, des conditions plus sèches sont projetées mais seulement pour les indices tenant compte de la fonte de la neige. À l’été, des conditions plus sèches sont projetées mais seulement pour les indices tenant compte de l’évapotranspiration. Dans l’ensemble, les choix méthodologiques associés au calcul des indices météorologiques ont une influence importante sur l’évaluation des conditions de sécheresse en milieu forestier.
Mots-clés: sécheresse, indices standardisés, processus hydrologiques, évapotranspiration, fonte, changements climatiques
Marc-André Villard
Chercheur.e associé.e
SEPAQ
Autres auteurs
- René Charest (SEPAQ)
- Patrick Gendreau (SEPAQ)
- Jonathan Lasnier (SEPAQ)
- Hugues Sansregret (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Conservation (présentée par la SEPAQ)
Conservation (présentée par la SEPAQ) - 10h40
Les parcs nationaux du sud du Québec contribuent à préserver des échantillons d'une forêt tempérée jadis beaucoup plus étendue. Cette forêt, qui abrite une faune et une flore très riches, est soumise à de nombreux stress, incluant une fréquence accrue d'événements météorologiques extrêmes ainsi que la pression de ravageurs ou pathogènes exotiques et d'herbivores surabondants, sans parler de la compétition de plantes exotiques envahissantes. Ces différentes menaces soulèvent des questions d’ordre à la fois scientifique et philosophique. D’une part, nous devons déterminer, en tant qu’organisation, quels sont nos objectifs par rapport au couvert forestier : laisser-aller, maintien (selon quel niveau de référence?) ou restauration/adaptation? D’autre part, il nous faut adopter une stratégie intégrée qui permette de sélectionner les interventions les plus efficaces, en fonction des objectifs adoptés, tant dans les zones fréquentées par les visiteurs que dans les secteurs voués à la conservation stricte. Nous avons tout d’abord formé un groupe d’experts afin de nous conseiller sur l’approche à suivre. Ce groupe supervise actuellement un chercheur postdoctoral afin de mettre au point un outil d’aide à la décision. De plus, nous avons mis en place des programmes de dépistage, suivi et contrôle des plantes exotiques envahissantes et un contrôle de certains herbivores surabondants. Enfin, nous appliquerons l'outil d'aide à la décision en développement (cf. Rolando Trejo Perez) afin d'identifier, dans chacun des 7 parcs visés, les interventions les plus efficaces à mettre en oeuvre pour maintenir le degré de couvert forestier jugé nécessaire à l'atteinte de nos objectifs de conservation.
Mots-clés: Forêt tempérée; agrile du frêne; maladie corticale du hêtre; surbroutement; cerf de Virginie; restauration écologique; arbres dangereux
Zackary Shakeri
Postdoctorant.e
University of Toronto
Autres auteurs
- Dominique Arseneault (UQAR)
- Marc-André Parisien (RNCan-CFN)
- Martin Simard (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Feux de forêts
Feux de forêts - 10h40
Fire return intervals (FRIs) are fundamental to the dynamics of landscape age mosaics of the North American boreal forest, influencing ecosystem recovery and carbon storage between successive stand-replacing fires. While post-fire reductions in biomass provide resistance against short FRIs, but the significance of this effect and its role in mitigating climate change impacts remain unclear. In this study, we thoroughly reconstructed FRIs and fire sizes over the past 204 years along a 300-km transect characterized by increasing fire activity and shifting vegetation composition in the eastern Canadian taiga. We conceptualized fire sizes and FRIs as the spatial and temporal components of the fire activity that jointly structure the landscape age mosaic. Our main objectives are quantifying resistance to burning in terms of FRIs frequencies and determining whether the resistance varies with wildfire size. Our results indicate that more severe fire weather favors large fires, which exhibit high resistance to short intervals in their interiors. Burn rate ratios between immature and mature fuels were over ten times higher in the core areas of large fires (37.7 vs 3.4) than their edges. Without resistance, short FRIs (≤30 years) would have occurred at unsustainable frequencies across 55-80% of the landscape, and FRI ≤10 years would have impacted 23-43% of the landscape. These large areas of well-protected fuels become extremely fire-prone as they mature, favoring the cyclical recurrence of large fires. Despite this decisive protection, potentially harmful short intervals of <10 years have still occurred across 2% of the landscape over the last 200 years, highlighting the inherent instability of the most fire-prone sectors of North American boreal forest. Our findings indicate that resistance to short FRIs comprises complex spatial and temporal interactions. A comprehensive assessment should focus on the entire landscape age mosaic and its spatial configuration.
Mots-clés: Black spruce, Boreal vegetation, Compositional change, Fire return interval, Fire size, Forest resilience, Jack pine, Landscape configuration, Self-protecting feedback
Élise Bouchard
Étudiant.e au doctorat
UQAM
Autres auteurs
- Sylvain Jutras (Université Laval)
- Daniel Houle (Environnement Canada)
- Annie Deslauriers (UQAC)
- Christian Messier (UQO-UQAM)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Acériculture
Salle C0420 - 10h40
Les érables sans feuilles au printemps génèrent une pression positive dans leur tronc pour se réhydrater en dissolvant les embolies causées par le froid. Cette adaptation physiologique modifie le transport de la sève dans l'arbre, de manière encore mal comprise. La pression positive du xylème stimule également l'exsudation de la sève, permettant la récolte d’eau d’érable pour la production de sirop. Cette étude vise à comprendre la dynamique des sources d’eau dans la sève d’érable au printemps, en relation avec les conditions météorologiques et les rendements acéricoles. Nous avons utilisé de l'eau lourde comme traceur, injectée dans le sol pour l'absorption racinaire ou dans le tronc à différentes hauteurs de 55 érables entaillés. Les rendements acéricoles et les ratios isotopiques de la sève ont été suivis, puis analysés à l'aide de modèles additifs généralisés et linéaires mixtes.
Nous avons montré que les érables sous pression positive du xylème absorbent d'importantes quantités d'eau du sol au printemps, même sans feuilles et sous la neige. Ce processus est toutefois lent, avec du transport de sève sur de courtes distances et un mélange important de différentes sources d’eau dans l’arbre. Une période clé pour la réhydratation de l'arbre survient avec l’arrivée de l'eau racinaire, autour du septième épisode de gel-dégel, coïncidant aussi avec les rendements les plus élevés d’eau d’érable de la saison (60 % récolté en 4 jours). Les conditions idéales pour maximiser les rendements quotidiens en eau d'érable combinent des nuits froides, favorisant des taux de sucre élevés, suivies de longues périodes de dégel avec des températures modérées (3 à 5 °C), propices à des volumes importants. Ces résultats soulignent l’effet conjoint de la physiologie printanière et des conditions météorologiques dans la réhydratation printanière des érables et leurs rendements acéricoles.
Mots-clés: Érable à sucre, acériculture, physiologie printanière, xylem, traçage isotopique
Abir Arbi
Étudiant.e à la maîtrise
UQAC
Autres auteurs
- Yan Boucher (UQAC)
- Kaysandra Waldron (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Feux de forêts
Feux de forêts - 11h00
Avec l’augmentation de l’activité des feux, l’expansion des superficies brûlées accroîtra les coûts de reboisement. Les coupes de récupération pourraient favoriser passivement la régénération de ces forêts, limitant ainsi les investissements de remise en production. Cette étude compare la régénération entre des peuplements brûlés puis récupérés et des peuplements brûlés laissés intacts, en supposant que les coupes de récupération pourraient améliorer la régénération par deux mécanismes : (1) en augmentant la pluie de graines au sol lors de la manipulation des tiges par les abatteuses ; (2) en exposant le sol minéral par le passage de la machinerie, créant des microsites propices à la germination. La régénération a été mesurée dans 44 placettes de peuplements matures (>60 ans) dominés par l’épinette noire (>75 % EPN, <25 % pin gris) aux conditions similaires, différant seulement par la coupe, après un feu survenu en 2020 au nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le stocking des semis d’épinette noire et de pin gris a été significativement plus élevé dans les forêts récupérées (51 % ± 27,9 %) que dans les forêts intactes (24 % ± 20 %, p = 0,007). Au total, 59 % des placettes récupérées présentait une régénération classifiée de moindre à satisfaisante (>40 % de stocking), contre seulement 27 % des placettes intactes. L’épaisseur moyenne de matière organique, un proxy pour qualifier les microsites de régénération, a été significativement plus faible dans les forêts récupérées (216 ± 85,28 mm) que dans les forêts intactes (282 ± 56,5 mm, p = 0,005), révélant un sol minéral plus exposé et des conditions de germination plus favorables que dans les forêts laissées intactes. Ces résultats suggèrent que les coupes de récupération pourraient améliorer la régénération post-feu en augmentant la pluie de graines et la qualité des microsites. L’intégration des coupes dans la planification forestière optimiserait les investissements en remise en production et la restauration post-feu.
Mots-clés: Sylviculture, coupe de récupération, régénération, épinette noire, pin gris, stocking, remise en production, feux
Claire Depardieu
Professionnel.le de recherche
Université Laval
Autres auteurs
- Patrick Lenz (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Sébastien Gérardi (Université Laval)
- Simon Nadeau (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Edouard Desaulniers (Université Laval)
- William Marchand (UQAT)
- Zoé Ribeyre (UQO)
- Nathalie Isabel (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Martin-Philippe Girardin (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Jean Bousquet (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Stress hydrique
Stress hydrique - 11h00
Le changement climatique représente un défi majeur pour la résilience des forêts canadiennes, notamment face à l’intensification des périodes de sécheresse. Comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette résilience est essentiel pour anticiper l’évolution des écosystèmes forestiers et adapter les stratégies d’aménagement. Cette présentation propose une synthèse des résultats les plus prometteurs de quatre projets scientifiques récents visant à approfondir les connaissances sur les mécanismes physiologiques et moléculaires impliqués dans la résilience à la sécheresse. Ces projets ont utilisé, de manière combinée ou indépendante, des approches de dendroécologie, de génomique et de transcriptomique. Une analyse dendroécologique à grande échelle sur 23 espèces canadiennes sera d’abord présentée, mettant en évidence une diminution progressive de leur résilience aux épisodes ponctuels de sécheresse sévère au cours du dernier siècle. Nous explorerons aussi l’influence des facteurs génétiques et environnementaux sur la résilience à la sécheresse en analysant les patrons de croissance, les caractéristiques du bois et les gènes chez les épinettes blanche et noire. Nos résultats indiquent une forte variabilité intraspécifique, les arbres issus de différentes sources génétiques (familles, provenances) adoptant des stratégies physiologiques diversifiées pour faire face aux conditions de sécheresse. La combinaison des approches génétiques et dendroécologiques a permis d’identifier les sources génétiques et les caractéristiques du bois les plus prometteuses pour renforcer la résilience aux conditions climatiques futures. Ces résultats apportent un éclairage nouveau sur l’importance relative des mécanismes physiologiques sous-jacents à la résilience à la sécheresse chez les conifères et constituent une avancée majeure vers la caractérisation de ses bases génomiques.
Mots-clés: jardin commun, indices de résilience, associations génétiques, efficience d'utilisation de l'eau
Nita Dyola
Postdoctorant.e
UQAC
Autres auteurs
- Roberto Silvestro (UQAC)
- Sara Yumi Sassamoto Kurokawa (UQAC)
- Sergio Rossi (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Acériculture
Salle C0420 - 11h00
Technological advancements in maple syrup production have led to a shift from traditional gravity to the vacuum system to increase sap yield. Despite the large use of the vacuum system, the mechanisms explaining its higher efficiency in respect to gravity remains limited. Here, we tested whether vacuum extends sugar season and increases sap extraction compared to the gravity system. We monitored sap exudation from four adult maples, two sugar maples (Acer saccharum) and two red maples (Acer rubrum) using rain gauges with tipping bucket in gravity system. We compared sap yield from gravity with the vacuum system at the sugarbush level (6000 taps) in the 2023 sugaring season in Laterrière, QC, Canada. The vacuum system is equipped with a vacuum pump to create a pressure gradient and a flow meter to measure the yield automatically. Sap yield occurred from DOY 84 to 120, with vacuum extending the yield by only two days. The vacuum produced higher yield (25.03 L/tap) than gravity (10.29 L/tap), representing a increase of 143.24%. Overall, 20% of the days contributed to 80% of the total sap in gravity, while the vacuum maintained a relatively consistent yield during the sugar season, with 11 consecutive productive days. Vacuum was able to extract sap during nighttime, between 6 PM and 5 AM, when no or few sap was produced under gravity. The yield reached a maximum around 2 PM and 10 AM in vacuum and gravity, respectively. The high yield was associated with high vacuum pressure. The sap yields in vacuum and gravity were related by an exponential pattern followed by an asymptote. Our findings confirm that the vacuum enhances sap yield, particularly during the days with low production under gravity. Thus, using vacuum technology can optimize total sap yield and provide greater stability for the maple syrup industry.
Mots-clés: gravity system, pressure gradient, sap yield, tipping bucket, vacuum system
Rolando Trejo-Pérez
Postdoctorant.e
TELUQ
Autres auteurs
- Marc-André Villard (SEPAQ)
- Louis Bernier (Université Laval)
- Emma Despland (Université Concordia)
- Daniel Kneeshaw (UQAM)
- François Lorenzetti (UQO)
- Deepa Pureswaran (RNCan-CFA)
- Élise Filotas (TELUQ)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Conservation (présentée par la SEPAQ)
Conservation (présentée par la SEPAQ) - 11h00
Le maintien du couvert forestier des parcs nationaux du sud du Québec est essentiel à la conservation de leur biodiversité et joue un rôle dans l’expérience éducative et récréative des visiteurs. Cependant, les impacts cumulatifs de perturbations variées, telles que les insectes et pathogènes exotiques, les plantes exotiques envahissantes et le surbroutement, affectent la capacité future de ces parcs à remplir leur mission.
Afin de réduire les risques pesant sur le couvert forestier, la question clé pour la SÉPAQ est donc: comment procéder pour identifier les peuplements les plus vulnérables au dépérissement et, éventuellement, mettre en œuvre des interventions efficaces. Pour répondre à cette question, un outil d’aide à la décision interactif destiné aux gestionnaires a été développé pour sept parcs du sud du Québec. De plus, des protocoles d’échantillonnage standardisés ont été élaborés pour recenser les facteurs de stress. Pour créer cet outil, nous utilisons des données géomatiques du 5ième inventaire écoforestier du Québec méridional, des données des risques des peuplements associés aux vingt-six principales menaces biologiques, identifiées par les experts, puis des données de risques générées à l’aide de l’intelligence artificielle et vérifiées par les experts, et finalement des données fournies par les différents parcs et portant sur des zones affectées par des menaces.
Cet outil interactif permet de brosser un portrait global des facteurs de stress qui menacent sept parcs du sud du Québec. Il permet à la SÉPAQ de réaliser une évaluation systématique des vulnérabilités des peuplements forestiers à risque. Enfin, il facilite l’identification des zones touchées par certaines menaces et l’anticipation des risques futurs, afin d’adapter les stratégies de gestion. Cet outil pourra éventuellement être déployé à l’échelle de l’ensemble du réseau de la SÉPAQ.
Mots-clés: Menaces biologiques, couvert forestier, insectes, pathogènes, plantes exotiques, surbroutement
Aya Garfa
Étudiant.e au doctorat
UQAC
Autres auteurs
- Roberto Silvestro (UQAC)
- Sara Yumi Sassamoto Kurokawa (UQAC)
- Sergio Rossi (UQAC)
- Annie Deslauriers (UQAC)
- Serge Lavoie (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Acériculture
Salle C0420 - 11h20
Parmi les espèces utilisées pour la production de sirop, l’érable à sucre (Acer saccharum Marsh.) est préféré par les producteurs, tandis que l’érable rouge (Acer rubrum L.) est considéré comme moins productif en termes de rendement en sève et de teneur en sucre. Cette étude vise à comparer le volume et les caractéristiques physicochimiques de la sève entre les deux espèces au cours de la saison des sucres 2023 à Laterrière (QC, Canada), à la limite nordique de l’aire de distribution de l’érable. La production de sève a été mesurée en continu sur deux individus par espèce à l’aide de pluviomètres automatiques, qui simulent la méthode de récolte par gravité. La production de sève était hétérogène, atteignant 2,6 L lors de la journée la plus productive. Aucune différence significative n’a été observée dans la coulée journalière entre les espèces, mais l’érable à sucre s’est démarqué par une production totale de sève plus élevée, en raison d’une période de coulée plus longue. Malgré des variations quotidiennes du pH, des valeurs Brix, de la concentration en saccharose, de l’osmolalité et de la conductivité, aucune différence significative n’a été détectée entre les espèces. Nos résultats n'ont pas confirmé l'hypothèse d'une meilleure performance de l'érable à sucre en matière de production de sève par rapport à l'érable rouge.
Sur la base des connaissances actuelles et des résultats de cette étude, la gestion forestière des érablières devrait être principalement guidée par des critères liés à l'écologie des espèces et à leur capacité à s'adapter aux conditions locales, plutôt que sur leurs performances potentielles en matière de production de sève. La présence d'érables à sucre et d'érables rouges au sein d'une même érablière pourrait maintenir la diversité une meilleure résistance du peuplement aux perturbations naturelles.
Mots-clés: production de sève; moment de la saison des sucres; teneur en sucre; propriétés physicochimiques.
Jessica Bao
Étudiant.e à la maîtrise
UQAR
Bloc 9 -
Session Conservation (présentée par la SEPAQ)
Conservation (présentée par la SEPAQ) - 11h20
Les perturbations découlant d'activités récréatives peuvent induire des réponses anti-prédatrices variées chez les grands mammifères, modulant leur répartition spatio-temporelle. Plusieurs études ont révélé que les prédateurs évitent les milieux près des sentiers récréatifs par « peur » des humains, tandis que les espèces proies utilisent la proximité à ces infrastructures comme refuge contre la prédation. Dans le but d’évaluer les impacts des activités récréatives sur la répartition spatiale de grands mammifères, nous avons estimé l’occurrence de grands mammifères et la fréquentation humaine à l’aide de 518 caméras à détection automatique distribuées à proximité de sentiers récréatifs dans quatre parcs nationaux (Mont-Orford, Grands-Jardins, de la Jacques-Cartier et des Monts-Valin). Ces parcs se distribuent le long d’un gradient de superficie et de fréquentation humaine et couvrent différents domaines bioclimatiques. Nous avons traité ~5 millions d'images à l'aide d’un algorithme d’intelligence artificielle pour caractériser les liens entre l'intensité d’utilisation d’un milieu par nos espèces cibles et le niveau de fréquentation humaine, la distance aux sentiers et plusieurs covariables (p. ex. couverture de forêt, TPI, occurrence de compétiteurs). Dans ces analyses, nous avons distingué les phases de jour et de nuit. Nos résultats révèlent des réponses contrastées. À titre d’exemple, au Mont-Orford, le cerf de Virginie fréquente les zones achalandées à des distances intermédiaires des sentiers le jour alors que la nuit, il reste à proximité des sentiers en l'absence de randonneurs. Quant à l’orignal, il évite fortement les sentiers et les zones perturbées par les activités récréatives. Nos résultats permettront d’aider à atténuer les impacts du dérangement anthropique sur plusieurs espèces de grands mammifères de manière à harmoniser la récréation et la conservation dans les parcs nationaux au Québec.
Mots-clés: parcs nationaux, grands mammifères, activités récréatives, pièges photographiques, dérangement anthropique
Marion Blache
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Adam Ali (Université de Montpellier)
- Dorian Gaboriau (UQAT)
- Sébastien Joannin (Université de Montpellier)
- Mathis Jean-Sepet (UQAT - UM)
- Martin-Philippe Girardin (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Pierre Richard (Professeur retraité, Université de Montréal)
- Yves Bergeron (UQAT)
- Hugo Asselin (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Feux de forêts
Feux de forêts - 11h20
Dans les forêts tempérées d'Amérique du Nord, le pin blanc et le pin rouge s’installent sur des sites nouvellement défrichés à la suite de feux de couronne peu fréquents et de grande sévérité, et persistent lorsque des feux de surface fréquents et de faible sévérité dégagent le sous-étage et exposent les lits de semences minérales. La diminution considérable de l'abondance des pins blanc et rouge au cours des deux derniers siècles, due à la surexploitation et à la suppression des feux, a conduit à des expériences de brûlage dirigé. Dans le parc national de la Mauricie (PNML ; sud du Québec), tous les feux naturels ont été activement supprimés depuis les années 1970, et seuls des brûlages dirigés (de surface) ont eu lieu depuis les années 1990.
Nous avons profité de ce cadre unique pour quantifier les particules de charbon dans les sédiments de trois lacs du PNML afin de comparer le signal laissé par le régime actuel de feux de surface avec ceux d'autres périodes de l'Holocène. Sur la base de nos analyses, nous proposons un seuil d'accumulation de charbon pour différencier les feux de surface des feux de couronne dans les enregistrements de sédiments lacustres.
Nous avons montré que les pins blancs et rouges étaient les plus abondants pendant le maximum thermique de l'Holocène (environ 8 400-4 500 ans cal. yr BP), sous un régime mixte de feux de surface fréquents et de faible sévérité, ainsi que de feux de couronne peu fréquents, mais de grande sévérité. La dominance d’un régime de feux de surface au début du Néoglaciaire (environ 4 500-1 500 ans cal. yr BP) ou d’un régime de feux de couronne au début de l'Holocène (avant 8 400 ans cal. yr BP) était moins propice à l'établissement et à la persistance des pins blanc et rouge. Plutôt que de supprimer systématiquement les feux de couronne naturels, il faudrait les laisser brûler tout en protégeant les infrastructures.
Mots-clés: Pinus strobus, Pinus resinosa, régime de feux, feux de surface, feux de couronne, brûlages dirigés
Nia Sigrun Perron
Postdoctorant.e
UQO
Autres auteurs
- Pierrick Arnault (UQO)
- Gabriel Bastien-Beaudet (UQO)
- Tristan Monette (UQO)
- Audrey Maheu (UQO)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Stress hydrique
Stress hydrique - 11h20
Climate change is projected to exacerbate soil water deficits and increase atmospheric water demand, raising concerns for the health and function of temperate species, particularly sugar maple (Acer saccharum). Tree responses to water stress are highly variable, influenced by water-use strategies, tree size, and water availability. Notably, larger trees have exhibited higher mortality rates under drought conditions, suggesting a size-dependent relationship with water stress. However, research on how tree size affects water relations in response to soil water limitations and atmospheric demand remains limited. This study investigates the influence of tree size on water storage, water use, and tree water balance in ~ 30 sugar maple using sap flow sensors and point dendrometers. By leveraging data from a rainfall exclusion experiment, we explored whether the effects of tree size are mediated by soil water availability or atmospheric water demand. Our findings reveal that larger trees—characterized by greater height, crown area, and stem diameter—were more sensitive to vapor pressure deficit (VPD), exhibiting higher sap flux density and smaller fluctuations in daily water balance. However, under high soil water availability, the daily water balance of smaller trees was more responsive to VPD. Stem water content did not differ significantly between large and small trees and both size classes showed limited responses to soil water availability. These results suggest that while larger trees sustain greater water loss under drier atmospheric conditions, this loss is supported by higher water uptake. By contrast, smaller trees are more dependent on surface soil water availability to offset water use as atmospheric drying intensifies. This work helps advance our understanding of tree water relations, offering perspectives on how temperate forests may respond to future climate conditions, where increased atmospheric water demand and soil water deficits are expected.
Mots-clés: water stress, tree size, vapor pressure deficit (VPD,) soil water availability, sugar maple (Acer saccharum)
Charles Gignac
Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Conservation (présentée par la SEPAQ)
Conservation (présentée par la SEPAQ) - 11h40
Depuis 2016, la Station Uapishka, cofondée par le Conseil des Innus de Pessamit, et la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU), joue un rôle clé en recherche scientifique, conservation et écotourisme au nord du 51e parallèle. Située au pied des monts Uapishka (Groulx) et aux abords du réservoir Manicouagan, elle facilite l’acquisition de connaissances sur les dynamiques écosystémiques, les impacts des changements climatiques et l’équilibre entre conservation et activités humaines dans un territoire protégé.
Plus spécifiquement, la Station appuie la recherche en facilitant l’accès au territoire et en offrant un soutien logistique aux chercheurs. L’installation d’infrastructures, telles qu’un réseau de stations météorologiques, un système de communication radio, un abri-refuge et un héliport, renforce le suivi environnemental et la collecte de données essentielles à divers projets scientifiques. Ces initiatives s’inscrivent dans une approche de recherche collaborative qui conjugue les savoirs scientifiques et innus.
En tant que plateforme d’apprentissage et de transmission des connaissances, la Station Uapishka contribue également à l’occupation contemporaine du Nitassinan par la création d’emplois pour la communauté de Pessamit et la mise en place de programmes de formation pour les jeunes. De plus, elle soutient la surveillance territoriale par les agents territoriaux, renforçant ainsi la gestion adaptative des écosystèmes.
Membre du réseau INTERACT, la Station fait partie d’un cadre de collaboration international reliant plus de 80 stations de recherche nordique. Cette affiliation lui permet d’échanger des données, d’accueillir des chercheurs internationaux et de canaliser un savoir avancé vers l’arrière-pays de la Manicouagan.
En combinant science, conservation et ancrage territorial, la Station Uapishka se positionne comme un modèle unique en milieu nordique, favorisant l’innovation en gestion durable et la mise en valeur d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel.
Mots-clés: Station Uapishka, Recherche collaborative, Infrastructures de recherche, Soutien logistique aux chercheurs
Oloruntobi Gideon Olugbadieye
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Étienne Boucher (UQAM)
- Yves Bergeron (UQAT)
- Annie Deslauriers (UQAC)
- Marc-André Lemay (UQAT)
- Fabio Gennaretti (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Stress hydrique
Stress hydrique - 11h40
Pinus banksiana exhibits remarkable ecological adaptability, thriving across diverse environments in the Canadian boreal zone, including clay deposits, fast-draining glacial tills, and rocky outcrops. However, projected rising temperature and increasing vapor pressure deficit (VPD), could heighten the species’ vulnerability, particularly in drier regions that may serve as sentinels of future climate change impacts. In this study, we examined tree growth, measured as basal area increment (BAI), and physiological responses from isotopic fractionations across one soil gradient including three sites in the boreal mixed wood of western Quebec, Canada. The site types were a clay-rich soil (CLY, a humid site), an esker base (ESB, an intermediate site), and an esker top (EST, a sandy, water drain, dry site). Using tree-ring analysis and dual stable isotopes (δ13C and δ18O), we evaluated intrinsic water-use efficiency (iWUE) and leaf water enrichment (Δ18Olw). Correlation analyses and regression models identified key environmental drivers influencing tree growth and physiological responses. Our results revealed a significant correlation between Δ18Olw and VPD, indicating that stomatal regulation is the crucial physiological mechanism controlling P. banksiana’s response to environmental stress across the sites. This effect was most pronounced at the dry EST site, where higher iWUE and less negative δ13C values suggest greater stomatal limitation of CO2 uptake. We observe increased iWUE was associated with enhanced BAI in the humid CLY site, no significant growth response was observed at ESB, and a negative iWUE-BAI relationship emerged at EST, suggesting carbon assimilation constraints under drier conditions. With anticipated temperature increases of up to 6°C by the end of the century, our results highlight how P. banksiana at drier sites may experience heightened physiological stress, reduced growth, and greater drought susceptibility. In contrast, trees at well-watered sites like CLY may sustain productivity, while intermediate sites like ESB may exhibit variable responses. These findings highlight the complex interactions between climate, soil properties, and physiological processes in shaping boreal tree species growth under future climate scenarios, emphasizing the need for site-specific forest management strategies to enhance resilience.
Mots-clés: Climate change, P. banksiana, iWUE, Tree rings, Stable isotopes, Stomata conductance.
Sara Yumi Sassamoto Kurokawa
Étudiant.e au doctorat
UQAC
Autres auteurs
- Roberto Silvestro (UQAC)
- Afsheen Khan (UQAC)
- Gian de Lima Santos (UQAC)
- Sylvain Delagrange (UQO)
- Sergio Rossi (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 9 -
Session Acériculture
Salle C0420 - 11h40
Les changements climatiques soulèvent des préoccupations pour l’industrie du sirop d’érable, principalement en ce qui concerne les changements prévus dans le calendrier de la saison sucrière et l’incertitude qui s’ensuit quant au rendement de la sève. Cette étude étudie les relations temporelles entre les facteurs environnementaux et la phénologie de la sève ( les délais d’apparition et de fin de la saison de sève) dans l’érable à sucre (Acer saccharum Marsh.) au cours des années 2018-2022 à la limite nord de l’espèce au Québec, Canada, et prévoit l’impact du réchauffement selon les scénarios d’émission de gaz à effet de serre (RCP 2.6, 4.5 et 8.5). Les températures de mars et d’avril sont corrélées au début et à la fin de l’exsudation de sève, se produisant en moyenne le DOY (jour de l’année) 86 et 133, respectivement. L’exsudation de sève correspond au début de la fonte des neiges et à l’augmentation conséquente de la teneur en eau du sol. La fonte complète des neiges et l’augmentation de la température du sol coïncident avec la fin de l’exsudation de la sève. Nos régressions partielles des moindres carrés estiment un avancement de 20 jours pour le début et 26 jours pour la fin de la production de sève d’ici 2100 à RCP 8.5. Les prédictions suggèrent une progression divergente du début et de la fin de la production de sève sous le réchauffement, ce qui se traduit par une durée plus courte de la saison sucrière. Le début de la saison de la sève représente un défi important pour les producteurs, qui devront adapter leurs activités dans les érablières afin de tenir compte des conditions plus chaudes prévues pour la fin de l’hiver et le début du printemps. Tout retard dans les entaillages augmentera le risque de pertes substantielles en production, surtout dans le contexte d’une saison plus courte.
Mots-clés: Acer saccharum, Exsudation de sève, changement climatique, température du sol, neige, teneur en eau du sol, système de gravité
Stelsa Fortin
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Bloc 9 -
Session Feux de forêts
Feux de forêts - 11h40
L’épinette noire est une espèce importante qui domine la forêt boréale de l’est du Canada. Nous avons très peu de connaissances sur les facteurs influençant la croissance juvénile de l’espèce après feu. Cette étude cherche à distinguer et à quantifier les différents groupes de facteurs environnementaux pouvant affecter la croissance en hauteur de l’épinette noire suite au passage de feu dans des peuplements réputés matures (>60 ans) avant feu. Pour ce faire, 536 placettes d’inventaires forestiers ont été établies dans 21 feux ayant brûlé entre 1995 et 2016, couvrant un territoire de plus 50 400 km2. Dans ses placettes, les conditions pré et post-feu ont été déterminées et des pédons de sol ont permis de déterminer la quantité des différents nutriments (C, N, P, K, Ca, Mg, Mn, Al, Fe, Na et S) disponibles dans le sol. Des données modélisées des propriétés du sol (i.e carte SIGSOL), ont aussi été utilisées. De plus, les conditions climatiques pré- et post-feu ont été extraites à partir des données mensuelles de ERA-5. Des analyses de régression par forêt aléatoire ont permis de distinguer l'importance de l’effet des différents facteurs sur la croissance post-feu de plus de 11 500 semis d’épinette noire et nous avons déterminé que les caractéristiques du peuplement pré et post feu ainsi que les données de la carte SIGSOL semble mieux expliquer la croissance en hauteur de l’épinette noire que les données climatiques et la disponibilité des nutriments dans le sol. Comprendre les facteurs environnementaux qui influencent la croissance post-feu de l’épinette noire, spécialement dans le contexte actuel d’une augmentation de l'activité des feux est crucial pour mieux estimer la croissance des peuplements et orienter la planification forestière des écosystèmes boréaux.
Mots-clés: Productivité, éléments chimiques, sphaigne, fertilité du sol, Changements globaux, dynamique forestière
Résumés des affiches (par ordre du numéro d'affiche)
Sauter à la section présentations orales | Retour à la page du Colloque
Angela Moreras
Postdoctorant.e
Université Laval
Autres auteurs
- Junior A. Tremblay (Environnement Canada)
- Steven G. Cumming (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Species distribution models (SDMs) are widely used to explain spatial and temporal variation in species distribution and abundances, with applications to population and habitat management. For more than 20 years, the Boreal Avian Modelling Project (BAM) has developed statistical methodologies for national-scale SDMs for landbirds, fitting boosted regression trees (BRTs) models with a broad set of biophysical covariates. However, these covariate sets are not regionally specific. We adapted BAM’s workflow to study the regional ecological phenomena, specifically the effects of forestry roads, and spruce budworm and forest tent caterpillar outbreaks in eastern Canada. We selected two bird species, the Bay-breasted Warbler (Setophaga castanea) and the Scarlet Tanager (Piranga olivacea), as specialists on mature coniferous and mature deciduous forests, respectively. The region-specific variables selected ranked among the most influential for the Bay-breasted Warbler, whereas the Scarlet Tanager showed no sensitivity to forestry roads or forest tent caterpillar outbreaks. These differences reflect the distinct life histories of the forest landbirds species. Yet, by incorporating regional variables, it is possible to improve SDMs predictive accuracy, leading to a better understanding of the factors driving species abundances and distribution. Our findings highlight the importance of accounting for local ecological processes when assessing certain landbird species, which may be crucial for precise conservation planning. Work to expand the list of modeled species and the regional covariates is ongoing.
Mots-clés: Species distribution, species abundance, boosted regression trees, coniferous, deciduous
Aurélie Chalumeau
Professionnel.le de recherche
UQAM
Autres auteurs
- Catherine Périé (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Julie Godbout (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Martin Perron (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Guillaume Otis Prudhomme (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Clémentine Pernot (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Marc-Antoine Lambert (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Marie-Claude Lambert (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Daniel Kneeshaw (UQAM)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Face aux changements climatiques, l’une des stratégies pour favoriser l’adaptation des forêts du sud du Québec est la migration assistée des espèces. Certaines espèces indigènes risquent de devenir mésadaptées aux nouvelles conditions climatiques, ce qui pourrait compromettre la résilience des écosystèmes forestiers et la fourniture des biens et services qu’ils procurent. Pour pallier cette problématique, l’introduction d’espèces mieux adaptées aux conditions futures est une piste à explorer. Cependant, cette démarche soulève de nombreux enjeux écologiques, économiques et opérationnels.
Dans cette étude, nous avons évalué le potentiel d’introduction de nouvelles espèces dans une région forestière ciblée. Nos analyses s’appuient sur des modèles climatiques et écologiques permettant d’identifier les espèces susceptibles de prospérer dans ces environnements futurs, en tenant compte de leur devenir d’habitat favorable (Périé et Lambert, 2023), de leur intérêt économique (valeur marchande, productivité) et écologique (résilience, rôle dans l’écosystème). Nous avons également étudié les zones sources potentielles de récolte de semences en nous basant sur les analogues climatiques, c’est-à-dire des régions où les conditions climatiques actuelles sont similaires à celles projetées pour le sud du Québec. Cette analyse a été menée selon deux scénarios d’émission de gaz à effet de serre (ssp2-4.5 et ssp3-7.0) et trois horizons temporels : 2011-2040, 2041-2070 et 2071-2100.
Enfin, nous abordons les principaux défis associés à la migration assistée d’espèces, notamment la réglementation sur l’import de nouvelles espèces, les risques écologiques liés à l’invasivité ou l’introduction de pathogènes, ainsi que les contraintes imposées par les certifications environnementales (FSC et SFI). Ces résultats visent à fournir des bases scientifiques solides pour guider les décisions en matière d’aménagement forestier et de reboisement dans un contexte de changement climatique.
Mots-clés: migration assistée d?espèces, changement climatique, devenir d?habitat, analogues climatiques
Florian Jordan
Professionnel.le de recherche
Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL)
Autres auteurs
- David Paré (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Charlotte Norris (RNCan-CFP)
- Kara Webster (RNCan-CFGL)
- Jérôme Laganière (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Le Canada possède l’une des plus vastes couvertures forestières au monde, s’étendant sur environ 367 millions d’hectares, soit près de 9 % des forêts mondiales. Ces forêts regroupent des forêts boréales, tempérées et mixtes, réparties sur douze écozones. Les sols forestiers jouent un rôle essentiel dans le maintien des services écosystémiques, notamment la production de bois, le stockage du carbone, la régulation des flux hydriques, fournisseur d’eau propre et l’offre d’habitats pour de nombreuses espèces. Cependant, ces sols sont de plus en plus exposés à des perturbations d’origine naturelle et anthropique, menaçant leur résilience et leur capacité à remplir ces fonctions essentielles. Dans le cadre du projet ForSite, cette revue de littérature dresse un état des connaissances sur la dégradation des sols forestiers au Canada. Elle explore les différentes définitions de la dégradation des sols, identifie les principales menaces pesant sur ces sols, et recense les indicateurs existants permettant d’évaluer leur dégradation. L’étude intègre non seulement des recherches menées sur les sols forestiers au Canada, mais aussi en Europe et en Amérique, et également en contexte agricole, afin d’évaluer leur pertinence pour le contexte forestier canadien. L’objectif est d’analyser comment les indicateurs de dégradation des sols, classés en trois catégories : physique, chimique et biologique, présents dans la littérature scientifique peuvent être intégrés aux stratégies de gestion et de conservation des sols forestiers canadiens, en considérant les perturbations anthropiques comme un facteur clé de leur dégradation. En identifiant les connaissances et les indicateurs les plus pertinents pour le suivi de la dégradation des sols forestiers au Canada, cette synthèse va contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques de dégradation des sols forestiers et constituer une base solide pour la mise en place d’un suivi à long terme.
Mots-clés: Sols forestiers, dégradation, santé des sols, indicateurs, Canada, perturbations
Jérôme Laganière
Chercheur.e associé.e
Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL)
Autres auteurs
- Charlotte Norris (RNCan-CFP)
- David Paré (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Kara Webster (RNCan-CFGL)
- Catlan Dallaire (RNCan-CFP)
- Xavier Giroux-Bougard (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Florian Jordan (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Xavier Malet (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Stephanie Nelson (RNCan-CFGL)
- Shelagh Yanni (RNCan-CFGL)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Le programme d’amélioration de l’information et de la technologie des systèmes forestiers (ForSITE) du Service Canadien des Forêts vise à améliorer notre compréhension et notre reddition de compte sur les changements dans les écosystèmes forestiers, en lien avec l’analyse du carbone forestier et la dégradation des forêts. Notre projet de recherche s’inscrit dans ce programme et a pour objectif de développer un cadre pour évaluer et faire le suivi de la dégradation des sols forestiers au Canada. La nature unique des sols et leur développement distinctif, qui résulte de l'influence combinée de la géologie, topographie, végétation, du climat et du temps, représente un défi de taille dans l’établissement de conditions de référence. En effet, il faut parfois des milliers d'années pour qu'un sol se développe et des années, voire des décennies, pour qu'il se stabilise à la suite d'une perturbation. En outre, certaines propriétés de sol peuvent aussi varier en fonction du stade de développement du peuplement. Les perturbations directes telles que la récolte forestière, l’urbanisation, le déboisement, les dépositions atmosphériques ou les changements climatiques, ne produisent pas nécessairement une réponse commune à tous les sols. Pour réaliser notre objectif, nous faisons progresser deux volets complémentaires de façon simultanée. Dans le volet 1, nous identifions les menaces et les vulnérabilités à l’aide de consultations avec des experts et une revue de la littérature scientifique et professionnelle. Nous développons aussi une architecture informatique pour une base de données nationale des données géoréférencées d’analyse des sols forestiers. Ces informations permettront d'identifier les lacunes en matière de connaissances et de données. Pour le volet 2, nous rééchantillonnons 17 dispositifs de suivi à long terme à travers le Canada pour tester la pertinence de l’utilisation de multiples propriétés de sol comme indicateurs de dégradation des sols. Nous testons également la performance d’outils de télédétection pour détecter et suivre la dégradation du sol après récolte forestière.
Mots-clés: sols forestiers, dégradation des forêts, perturbations, services de l'écosystème, santé du sol, indicateurs
Léa Darquié
Postdoctorant.e
UQAM
Autres auteurs
- Nelson Thiffault (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Nicole Fenton (UQAT)
- Alain Leduc (UQAM)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
La préparation mécanique du sol (PMS) et la plantation sont des pratiques courantes dans les forêts boréales canadiennes pour augmenter la productivité, en particulier dans les zones sensibles à la paludification. Ces opérations peuvent être adaptées pour atteindre les objectifs d'aménagement, mais leurs effets combinés sur l'écosystème restent rarement étudiés. Nous avons cherché à étudier l'effet de trois traitements de PMS (hersage, scarifiage à disque ou aucune préparation) et de deux densités de plantation de semis d'épicéa noir (Picea mariana [Mill.] BSP) (faible densité de plantation à 1100 semis ha-1 et forte densité de plantation à 2500 semis ha-1). Suite à une coupe avec protection de la régénération et des sols , le site a été divisé en neuf parcelles, chacune recevant l'un des trois traitements, qui ont à leur tour été divisées en deux densités de plantation. Après douze ans, nous avons mesuré la croissance et la survie de l'épinette noire, ainsi que le compactage du sol, et fait l'inventaire de la végétation du sous-bois. Les autres arbres ont également été mesurés et considérés comme de la compétition. Les résultats préliminaires ont montré une surface terrière de l'épinette plus élevée et un compactage du sol plus faible dans les parcelles traitées par hersage et avec une densité de plantation élevée. Ni la PMS ni la densité de plantation n'ont à elles seules augmenté la croissance ou la survie de l'épinette. Le hersage a augmenté la concurrence des feuillus, tandis que la densité de plantation élevée a réduit la concurrence des résineux. Nos premiers résultats suggèrent qu'une densité de plantation élevée et une préparation intensive du site sont nécessaires pour augmenter la productivité. Ils apportent des preuves supplémentaires de la nécessité de stratégies sylvicoles adaptées pour une gestion efficace des forêts paludifiées.
Mots-clés: Épinette noire, préparation mécanique du sol, densité de plantation, forêt boréale
Marc-André Lemay
Professionnel.le de recherche
UQAT
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les changements climatiques entraîneront des sécheresses de plus en plus fréquentes dans le biome boréal. Ces sécheresses auront un impact sur la survie des arbres, leur croissance, et leur capacité à effectuer la photosynthèse. L’effet de ces événements sur la physiologie des arbres doit être étudié afin de prévoir comment les écosystèmes boréaux évolueront en réponse aux changements climatiques.
À l’été 2024, nous avons mis en place une forêt connectée à la Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet (FERLD), en Abitibi-Ouest. Dans un premier temps, un dispositif d’exclusion de pluie sera installé afin de simuler l’effet d’une sécheresse sur des épinettes noires et des bouleaux à papier. Quatre arbres de chaque espèce seront soumis à une sécheresse induite alors que quatre autres serviront de témoins. Des capteurs à haute résolution temporelle (mesures aux 10 à 30 minutes) ont été installés sur les arbres afin de mesurer leur statut hydrique et leur croissance (dendromètres) ainsi que leur flux de transpiration (capteurs de flux de sève). De plus, 16 capteurs d’humidité du sol ont été installés pour mesurer l’influence du traitement d’exclusion de pluie sur la disponibilité en eau pour les arbres.
En parallèle, une tour instrumentée mesurant les flux écosystémiques par la méthode de covariance des turbulences (eddy covariance) sera mise en fonction au même site à l’été 2025. Cet équipement mesurera la production primaire ainsi que la respiration et l’évapotranspiration à l’échelle de l’écosystème et permettra de lier ces flux aux conditions météorologiques. Ces données seront communiquées en temps réel à une plate-forme web afin de diffuser les résultats de recherche auprès du public. Combinée aux données de suivi à l’échelle des arbres, l’étude de la covariance des turbulences nous permettra de dresser un portrait exhaustif du fonctionnement de la forêt étudiée.
Mots-clés: covariance des turbulences, dendromètres, sécheresse induite, flux de sève
Nicole Marques
Stagiaire de recherche
UQAC
Autres auteurs
- Sara Yumi Sassamoto Kurokawa (UQAC)
- Roberto Silvestro (UQAC)
- Sergio Rossi (UQAC)
- Mauricio Mercado (Universidad de Cartagena)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Climate change can affect the dynamics of maple syrup production, creating uncertainty for producers regarding the future of this iconic product. The aim of the study is to examine the effects of climate and forecast the evolution of syrup yield in a context of global warming. We collected annual data of maple syrup yield, categorized into 8 productive regions across Quebec, during 2001-2023. Temperature and precipitation data were generated by CMIP6 model, under scenarios SSP2 and SSP3. We fitted a negative exponential model to remove the trend of the syrup yield series. Subsequently, it was applied a mixed model for longitudinal data to forecast the influence of temperature and precipitation on syrup yield. On average, syrup yield ranged from 0.58 in 2001 to 0.89 L/tap in 2023. Whereas, with the trend removed to observe the pattern through years, the average of liters per tap is 0.968 for 2001 and 0.738 in 2023. These results allow to observe an increase in variability of production between regions, which Montérégie with the steepest growth curve in production and Mauricie, the flattest. Spring temperatures and extreme snow fall in winter were negatively correlated with syrup yield. For the forecast model, in scenario SSP2, the predicted average syrup yield has a significative fall from 1.01 to 0.96 L/tap for 2100. In scenario SSP3, there is a not significative growth from 0.994 to 0.997 L/tap. These findings underscore the potential long-term consequences of climate change on maple syrup production, and suggest a growth in the variability of yield, between years, that could threaten the economic stability of maple syrup industry in Quebec.
Mots-clés: Climate change, Maple syrup production, Syrup yield
Pierre-Alexis Herrault
Université de Strasbourg
Autres auteurs
- David Grenier-Héon (UQAM)
- Vanessa Poirier (UQAM)
- Alain Paquette (UQAM)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les dendro microhabitats permettent d'accueillir une diversité d'espèces spécifiques à travers la disponibilité de singularités morphologiques ou de bois décomposés. En milieu urbain, la gestion complexe du parc arborée peut faire varier significativement leur présence laissant place à de fortes concentrations sur quelques arbres ou d’îlots isolés au sein de la matrice. Parmi ces derniers, les gros arbres sont particulièrement visés puisque la continuité de présence et les grands volumes sont corrélés positivement à l'accumulation de micro-habitats. Le LiDAR terrestre, grâce à sa capacité à scanner l’intégralité de l’arbre (du système racinaire à la canopée) offre une perspective de mesure intéressante pour capturer les dendro microhabitats des arbres urbains. Nous proposons de l’exploiter en s’intéressant spécifiquement aux gros arbres et avec l'objetcif de proposer un cadre explicatif à la présence de biodiversité. 40 arbres de la ville de Montreal présentant des valeurs de traits morphologiques supérieurs à la moyenne (Diamètre à Hauteur de Poitrine, Hauteur) et appartenant aux espèces les plus fréquemment observées (Erable argenté, Erable de Norvège, Peuplier) sont scannés en période hors-feuille. Deuxièmement, après avoir extrait le tronc et les branches principales situées sous la couronne de l’arbre, une variable de micro-relief a été calculé à la surface de ces branches. Celle-ci s’appuie sur les résidus d’un modèle non-paramétrique local reliant la distance des retours LiDAR à la ligne centrale de chaque branche et la valeur de hauteur de chaque retour, projetée sur cette ligne centrale. Troisièmement, une collection d'indicateurs basé sur cette dernière variable ainsi que l'intensité de retour a été déterminé et permet de s'intéresser à trois grands types de traits structurels des arbres : la rugosité de l'écorce, sa composition (présence d'épiphytes, bois morts) et la quantité de déformations (cavités, excroissances).
Mots-clés: Dendro micro-habitats, LiDAR terrestre, grands et vieux arbres, milieu urbain
Zackary Shakeri
Postdoctorant.e
University of Toronto
Autres auteurs
- Patrick James (University of Toronto)
- Jonathan Boucher (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Climate change is intensifying insect outbreaks and wildfire disturbances in the boreal forest, creating complex interactions between these disturbances. In Ontario, native defoliator insects impact approximately 2 million hectares of forest each year, yet their effects on fuel dynamics and fire behavior remain largely unexplored, particularly in the context of a changing climate. This study examines fuel accumulation and fire behavior across a chronosequence of jack pine-dominated stands at different stages of defoliation, providing insights into how jack pine budworm (JPBW) defoliation influences wildfire activity over time. We selected 12 sites in Northern Ontario, including two control sites and ten defoliated sites, and conducted fuel measurements across 32 plots following Canadian Forest Service protocols. Results show a significant increase in surface fuels over time, while ladder and crown fuels remained relatively unchanged. The partial mortality of dominant jack pine trees allowed understory expansion, increasing surface and ladder fuels but with minimal impact on canopy fuel loads. Using the Conifer Pyrometric Model, fire behavior analysis shows that defoliation lowers the wind speed required for active crown fire development. In C-3 fuel type, active crown fires initiate at 22 km/h, while control and 1-year post-defoliation stands require higher wind speeds (23–27 km/h). By 3- and 5-years post-defoliation, active crown fires occur at lower wind speeds (20 and 17 km/h, respectively), driven by increased surface fuel accumulation despite a higher fuel strata gap (FSG). These findings suggest that defoliated stands become more fire-prone over time, requiring lower wind speeds to sustain crown fires, which complicates fire spread prediction and increases risks for firefighter safety and suppression efforts.
Mots-clés: Boreal forest, Choristoneura pinus, defoliation, fire behavior, fuel build up, Pinus banksiana, wildfire
Élise Deschenes
Professionnel.le de recherche
RNCan-CFGL
Autres auteurs
- Chris Macquarrie (RNCan-CFGL)
- Craig Zimmerman (RNCan-CFGL)
- Laura Scott (RNCan-CFGL)
- Isabelle Aubin (RNCan-CFGL)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Depuis son introduction en Amérique du Nord dans les années 1990, l'agrile du frêne a tué des millions d’arbres, devenant l’un des insectes exotiques ravageurs les plus destructeurs du continent. Un programme de suivi à long terme a été mis en place dans des peuplements de frênes blanc et rouge en Ontario depuis 2010, et dans des peuplements de frênes noirs depuis 2020. Des inventaires ont été effectuées avant et après l’infestation, permettant de suivre la mortalité des arbres, la régénération ainsi que le taux d'infestation des jeunes tiges. Dans nos 46 sites, aucun arbre mature n’a survécu à l’infestation, mais une forte régénération persiste présente jusqu’à 20 ans après l’infestation. Plus de 40% des jeunes tiges disséquées ont été infestées par au moins une larve d’agrile, tandis que 14 % ont subi plus de cinq épisodes d’infestation au cours de leur vie tout en conservant une bonne vigueur. Des taux d’infestation plus élevés étaient associés à une vigueur réduite et à un âge plus avancé, et les taux d’infestation s’avérait généralement plus élevés en milieu agricole qu’en milieu urbain. L’analyse chronologique des infestations a révélé que l’agrile colonise d’abord les frênes matures, et ne s’attaque aux jeunes tiges qu’après la mortalité de la canopée. Ces résultats nous permettent de mieux comprendre les impacts écologiques de l’agrile sur l’intégrité des frênaies.
Mots-clés: régénération, taux d'infestation, insectes exotiques ravageurs, frêne blanc, frêne rouge,
Deisy Marcela Angarita Ospina
Étudiant.e à la maîtrise
UQAR
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Human-induced climate warming is driving species range shifts. However, the velocity of climate change might surpass the migration speed of natural populations, threatening biodiversity. Picea glauca is expanding north along the eastern coast of Hudson Bay. My research will assess how spatial sorting eco-evolutionary dynamics influence colonization rates at the leading edge. The main objective is to estimate the realized colonization rate at the expansion front of a white spruce treeline population along the eastern coast of Hudson Bay and assess how expansion drive patterns of genetic diversity at the colonisation front.
Starting from the northernmost P. glauca individual I will proceed south for c. 20 km to sample all white spruce individuals. I will record the geographic coordinates and take pictures, dendrometric features, sample twigs for genetic analysis, and sample inorganic soil to confirm the absence of Holocene fire activity, and ascertain primary post-glacial colonization. To estimate the minimum age of establishment for each spruce individual, increment cores will be sampled on all trees using a Pressler borer as close as possible to the root collar or the yearly scars will be counted along the stem of saplings and seedlings. Increment cores will be sanded, and tree rings will be counted at the lab to assess age. DNA will be extracted and genotyped using DArTseq technology to establish relatedness among spruce individuals. Soils will be wet-sieved and the presence of macrofossil charcoal will be assessed using standard protocol.
I expect to quantify the realized colonization rate of Picea glauca at its northern expansion front along Hudson Bay's eastern coast. This study will reveal how spatial sorting eco-evolutionary dynamics influence migration rates and assess the species’ ability to adapt to rapid climate change. The findings will provide critical insights for conservation and management strategies under global warming scenarios.
Mots-clés: Climate change - Treeline dynamics - Tree-ring analysis - Hudson Bay
Zlatko Blazeski
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
La planification des chemins forestiers est un processus complexe qui nécessite la prise en compte de plusieurs variables dans son élaboration car ils constituent un coût important pour l’industrie forestière. Un des principaux défis de la voirie forestière est la recherche et l’extraction de matériaux granulaires, majoritairement composés de sable et de gravier, qui sont prélevés à partir de bancs d’emprunt près du réseau routier existant ou celui à développer lors des opérations forestières. La composition du sol des matériaux granulaires est influencée par les types de dépôts de surface et leur origine. Dans la région de l’Abitibi, la déglaciation et des événements post-glaciaires ont créé un paysage dominé par des plaines d’argiles où les dépôts de surface ont une géomorphologie particulière, notamment ceux qui sont riches en sable et en gravier. Les données de télédétection, tel que le LIDAR et ses produits dérivés, permettent de détecter des caractéristiques détallées de la topologie du terrain, rendant possible l’identification des types de dépôts de surface, grâce à une résolution spatiale fine. Mon projet consiste à développer un modèle prédictif qui sera capable de délimiter les types de dépôts de surface qui présentent des potentiels de bancs d’emprunt dans la région d’Abitibi, en détectant automatiquement les caractéristiques géomorphologiques de ceux-ci. Ce produit permettra de guider la planification des chemins forestiers et améliorer le développement du réseau routier en forêt.
Mots-clés: bancs d?emprunt, chemins forestiers, géomorphologie, dépôts de surface, télédétection, modèle prédictif
Magalie Bossé
Étudiant.e à la maîtrise
UQAR
Autres auteurs
- Guillaume de Lafontaine (UQAR)
- Pierre-Luc Couillard (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
La strate inférieure de plusieurs érablières du Québec est grandement colonisée par des gaules de hêtres à grandes feuilles, d’où leur appellation d’érablière à hêtres. Toutefois, ces écosystèmes semblent peu enclins à se développer en hêtraies lors de la succession écologique. De plus, les gaules semblent nuire grandement à la régénération de ces peuplements forestiers. Dans le cadre de mon projet de maîtrise, j’évaluerai si les érablières se font effectivement envahir par le hêtre dans un nouvel état alternatif ou s’il s’agit plutôt d’un retour à une situation qui a déjà prévalu au cours de l’Holocène, alors que les hêtraies étaient un type de peuplement plus commun. Il visera donc à évaluer si les érablières à hêtres ont un potentiel de se développer en hêtraies. À cette fin, mon projet se base sur l’identification et la datation 14C de particules de charbon de bois extraits des sols forestiers. Ils serviront à mieux comprendre la dynamique du hêtre à travers les millénaires dans les différents domaines bioclimatiques du Québec (de l’érablière à caryer à la sapinière à bouleau jaune), le long d’un gradient entre la Montérégie et la Gaspésie. Cela afin d’avoir une représentation la plus fidèle possible de l’évolution des populations de hêtre dans le contexte bioclimatique. Il vise aussi à étudier les changements de l’abondance du hêtre au cours des variations climatiques des derniers plurimillénaires. Ceci permettra de mieux estimer les distributions potentielles futures du hêtre dans le Québec et le rôle que cette espèce aura tendance à prendre dans nos forêts.
Mots-clés: Fagus grandifolia, Acer saccharum, paléoécologie, sud du Québec, migration nordique
Laurie Boulerice
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Autres auteurs
- Jeremy Kirchman (New York State Museum)
- Junior A. Tremblay (Environnement Canada)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
La famille de pics boréaux Picoides pourrait être une des familles les plus affectées par les changements climatiques et anthropiques de la forêt boréale. Cette famille comprend le Pic à dos noir (Picoides arcticus) et le Pic à dos rayé (Picoides dorsalis) qui habitent le biome boréal de l’Amérique du Nord et le Pic tridactyle (Picoides tridactylus) qui habite les régions de l’Eurasie. Bien que P. arcticus et P. dorsalis soient étroitement liés taxonomiquement par un ancêtre commun, ils ont évolué séparément avant de se retrouver en sympatrie. De leur côté, P. dorsalis et P. tridactylus partagent un ancêtre commun récent, mais ont été isolés géographiquement depuis des milliers d'années, ce qui soulève la question de savoir s'ils représentent deux espèces distinctes ou s’ils doivent être considérées encore comme une seule entité. Les objectifs de ce projet sont de (1) Examiner l’étendue de l’introgression génétique entre le Pic à dos noir (P. arcticus) et le Pic à dos rayé (P. dorsalis) ainsi que quantifier le chevauchement de niches (2) Prédire l’évolution spatio-temporelle de l’introgression génétique de P. dorsalis et P. articus en considérant les changements prévus dans les prochaines décennies en termes de changements globaux et de modification anthropique de la forêt boréale, afin de de pouvoir estimer la situation future possible de ces deux espèces et (3) Déterminer si P. tridactylus et P. dorsalis devraient être considérés comme une seule espèce plutôt que deux espèces distinctes. Pour ce faire, nous allons faire des analyses Isolation-with-Migration pour construire un modèle de co-alignement, et construire des modèles de niches. Ces résultats fourniront des connaissances jusqu’ici peu explorées sur la structure génétique des pics boréaux, ce qui est nécessaire à l’évaluation de la liste rouge des espèces (COSEPAC) ainsi que sur la santé globale de la forêt boréale.
Mots-clés: Flux génétique, Pics boréaux, Dynamique des populations, Niche écologique
Juliette Bourgeois
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Claire Depardieu (Université Laval)
- Simon Nadeau (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Sébastien Gérardi (Université Laval)
- Maddie Clark (Agence d'évaluation d'impact du Canada)
- Patrick Lenz (RNCaN-CFL)
- Jean Bousquet (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
L’épinette rouge (Picea rubens Sarg.) est un conifère indigène des forêts tempérées nord-américaines dont le déclin marqué des populations depuis les années 1960 est attribué aux effets combinés du réchauffement climatique, de la pollution atmosphérique et de l’exploitation forestière. La sensibilité de l’épinette rouge aux conditions climatiques sévères soulève des interrogations quant à sa capacité d’adaptation dans le contexte actuel des changements environnementaux rapides. Mon projet de recherche vise à évaluer la résilience de l’épinette rouge aux conditions climatiques actuelles, en analysant ses réponses physiologiques aux événements météorologiques sévères, comme les épisodes de sécheresse ou les gels hâtifs et tardifs, ainsi qu’en estimant la variabilité génétique intraspécifique influençant ces réponses, y compris le degré d’introgression des arbres avec l’épinette noire. Pour ce faire, près de 1700 épinettes rouges issues de tests polycross biparentaux établis il y a une trentaine d’années dans 16 sites de jardins communs en Nouvelle-Écosse, ont été carottées et génotypées pour des milliers de SNPs. L’analyse des données dendrochronologiques, qui sera réalisée dans le cadre de cette recherche, permettra de corréler les caractéristiques des cernes annuels de croissance avec les événements météorologiques sévères propres à chaque site d’étude. Elle contribuera également à estimer l’héritabilité des traits phénotypiques liés à la résilience aux anomalies climatiques. En fournissant des connaissances nouvelles sur la diversité génétique et les mécanismes de résilience et d’adaptation de l’épinette rouge, cette recherche contribuera à l’élaboration de stratégies de gestion durable des forêts d’épinette rouge de l’Est du Canada dans le contexte des changements climatiques.
Mots-clés: Picea rubens, dendroécologie, tests génécologiques, stress climatiques, résilience
Ambre Burnou
Étudiant.e à la maîtrise
UQAM
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Mon projet propose de développer différents scénarios de planification des forêts urbaines en intégrant des indicateurs écologiques, socio-environnementaux et les perceptions des usagers, à l'échelle de Montréal. La présentation portera sur la méthodologie du projet, qui se décompose en trois volets :
Recherche des indicateursLa première étape consiste en une revue bibliographique approfondie complétée par des échanges avec mes co-directeurs afin d’identifier des indicateurs pertinents pour évaluer l’état et le potentiel des forêts urbaines. Analyse des perceptions des usagersLa deuxième phase repose sur la collecte des perceptions via des questionnaires. Nous utilisons : La méthodologie Q pour évaluer la sensibilité environnementale des participants, Une échelle de Likert pour recueillir l’ordre de priorité attribué aux différents indicateurs. Cartographie des scénarios de plantationEnfin, nous élaborons une cartographie basée sur un indice de priorité résultant de l’agrégation des indicateurs, lequel est pondéré en fonction des priorités exprimées par les usagers. Cette démarche vise à créer des scénarios de plantation en fonction des usagers pour la ville de Montréal
Mots-clés: forêts urbaines, perception des usagers, cartographie, planification
Jonathan Cazabonne
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Mélanie Roy (Université Paul Sabatier Toulouse III, IRL IFAECI Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y sus Impactos)
- Maxence Martin (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les vieilles forêts boréales sont réputées être un point-chaud de biodiversité pour les champignons ectomycorhiziens, où ils occupent une place centrale dans la dynamique du carbone. Cependant, la forte hétérogénéité de structure et de composition de ces écosystèmes complexifie l’identification des facteurs structurant les communautés fongiques du sol ainsi que leur implication dans le stockage du carbone. De plus, les connaissances actuelles sur la biodiversité des sols basées sur l’ADNe sont difficiles à appliquer sur le terrain par les forestiers. Des outils récents décrivant la structure forestière, tels que l’Indice de Biodiversité Potentielle et le LiDAR aéroporté, présentent un fort potentiel afin de prédire la fonge du sol, potentiel qui reste toutefois à être testé. À l’aide d’une chronoséquence de vieilles forêts boréales post-feu s’étalant sur 264 ans au Québec, nous souhaitons explorer les facteurs façonnant la diversité fongique du sol dans les vieilles forêts boréales, les fonctions écologiques qu’elle fournit et comment la prédire à fine et large échelle au travers d’indicateurs accessibles aux gestionnaires. Premièrement, l’ADNe fongique et les propriétés chimiques du sol ont été obtenus afin de caractériser les patrons d’hétérogénéité souterrains. Les dendromicrohabitats et le bois mort ont été inventoriés afin de tester les liens entre les communautés fongiques du sol, l’hétérogénéité de l’habitat et la maturité forestière. Deuxièmement, les stocks de carbone seront mesurés afin d’examiner leur association avec les guildes fongiques du sol et leur activité transcriptomique. Troisièmement, nous évaluerons les corrélations entre la diversité fongique du sol décrite par l’ADNe avec des données terrain d’Indice de Biodiversité Potentielle et de LiDAR aéroporté. Cette thèse apportera une nouvelle perspective sur la richesse interne des vieilles forêts boréales et le développement d’outils essentiels pour l’intégration de la fonge du sol dans les stratégies de conservation de la biodiversité au Canada.
Mots-clés: Aménagement forestier durable, biodiversité du sol, carbone, conservation de la biodiversité, habitat, metabarcoding, mycologie, télédétection
Lucas Chambon
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Autres auteurs
- Maxence Martin (UQAT)
- Osvaldo Valeria (UQAT)
- Patricia Raymond (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Au cours des dernières années, le recours à la télédétection pour inventorier les forêts a connu une véritable expansion. Toutefois, les avancées se sont focalisées sur les aspects économiques de la forêt. L’aspect écologique a été moins considéré alors qu’il est vital pour la conservation de la biodiversité forestière. Le bois mort et les dendromicrohabitats, sont d’importants indicateurs indirects de la biodiversité et ont la particularité d’être fortement liés à la variabilité de la structure tridimensionnelle des forêts. Les données LiDAR aéroportées ont le potentiel de prédire l’abondance et la diversité de ces indicateurs en analysant la structure des forêts. Notre objectif est donc de développer des modèles de télédétection pour prédire l’abondance et la diversité des dendromicrohabitats et du bois mort des vieilles forêts boréales mixtes au Québec. Les 175 placettes de 400 m² ont été visités à l’été 2024 dans la Forêt d’Enseignement et de Recherche du Lac Duparquet. Dans chaque placette, des variables à prédire issues des inventaires terrain et des variables prédictives issues des données aéroportées ont été calculées. A l’aide de modèles d’apprentissage automatique, nous avons prédit les variables d’abondance et de diversité des dendromicrohabitats et du bois mort. Malgré le bruit naturel des vieilles forêts, les modèles prédisent bien l’abondance et la diversité des indicateurs de biodiversité (r² = 0.41-0.29), avec une précision moindre pour la diversité du bois mort (r² = 0.19). Les variables horizontales influencent peu le bois mort et les dendromicrohabitats, tandis que la hauteur dominante et la diversité verticale les impactent fortement. La complexité a une importance faible à modérée. Enfin, la pente est déterminante pour les dendromicrohabitats. Ces modèles permettront de créer une cartographie des zones clés pour la biodiversité. Il sera alors possible de proposer des approches d’aménagement innovantes dans la recherche d’un compromis entre récolte et protection de la biodiversité.
Mots-clés: vieille forêt boréale mixte, biodiversité, habitats, télédétection, LiDAR, prédiction
Kim Couture
Étudiant.e à la maîtrise
UQAM
Autres auteurs
- Maikel Rosabal (UQAM)
- Daniel Kneeshaw (UQAM)
- François Fabianek (WavX Inc & Groupe Chiroptères du Québec)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les chauves souris insectivores se nourrissant des insectes nuisibles sont particulièrement vulnérables aux pesticides dans les milieux agricoles et les contaminants des milieux urbains. Une exposition accrue aux contaminants pourrait entraîner un poids réduit à la naissance, une charge parasitaire accrue et un taux de recrutement plus faible, compromettant ainsi la viabilité des populations. Cependant, les études toxicologiques sur des espèces de chauves souris sont rares, et aucune n’évalue simultanément l’impact des pesticides et des éléments traces métalliques (ETM), malgré le risque d’effets additifs ou synergiques.
Ce projet vise à comparer l’exposition aux pesticides et ETM chez deux espèces de chauves souris : la grande chauve-souris brune (Eptesicus fuscus), tolérante aux environnements anthropisés, et la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), une espèce menacée et sensible aux perturbations environnementales. L’objectif est d’examiner la relation entre leur état de santé et leur profil de contamination selon leur habitat (agricole, forestier, urbain).
Lors de l’été 2024, 95 individus ont été capturés dans 11 colonies (5 agricoles industriels, 4 forestiers, 1 agricole biologique, 1 urbain). Des prélèvements de guano, fourrure et peau ont été réalisés, ainsi que des mesures morphologiques (poids, taille, âge) et sanitaires (charge ectoparasitaire). Une deuxième campagne d’échantillonnage est prévue en 2025 afin d’obtenir des données complémentaires.
Les analyses par modèles linéaires généralisés exploreront les liens entre contamination, morphologie et état de santé. La littérature signale la présence de plomb, fer, aluminium, zinc et mercure dans les chauves-souris, et nos analyses préliminaires suggèrent aussi du platine, arsenic et cadmium, renforçant l’hypothèse d’une contamination multiple aux impacts sous-estimés.
À court terme, ces résultats orienteront les recherches sur d'autres espèces de chauves-souris québécoises. À long terme, ils guideront les stratégies de conservation et la restauration des habitats en tenant compte des sources de contamination identifiées.
Mots-clés: chauves-souris, écotoxicologie, contaminants inorganiques, contaminants organiques, pesticides, grande chauve-souris brune, petite-chauve-souris brune, agriculture industrielle,
Gabriel Davidson-Roy
Étudiant.e à la maîtrise
UQAC
Autres auteurs
- Victor Danneyrolles (UQAC)
- Martin Barrette (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Yan Boucher (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les changements climatiques entraînent une augmentation de l’activité des feux. En 2023, plus de 4,5 millions d’hectares (ha) de forêts ont brûlé au Québec, dont 1,3 million dans le territoire aménagé. Parmi ceux-ci, on prévoit que près de 400 000 ha ne soient pas en mesure de se régénérer adéquatement et deviennent donc des landes forestières. Ces phénomènes, qu’on qualifie “'échec de régénération”, sont observés quand les feux affectent des peuplements jeunes (<50 ans) d’épinette noire (Picea mariana), qui ne peuvent se régénérer naturellement dû à leur incapacité à produire suffisamment de graines viables. La plantation manuelle est la méthode la plus utilisée pour le reboisement mais est coûteuse et exige une main-d’œuvre importante. L’utilisation de technologies innovantes telles que l’ ’ensemencement par drone, pourraient offrir des alternatives plus efficaces et économiques. Cette étude vise à évaluer l'efficacité de l’ensemencement par drone en mesurant au sein de différentes stations forestières (types écologiques du MRNF), l'abondance, la densité et la composition des semis, leur origine (naturelle ou ensemencée) et les conditions des microsites d’établissement. L’étude se déroulera à l’intérieur du Parc Assinica, au Nord-du-Québec. Notre dispositif expérimental comportera 400 placettes qui seront installées sur un territoire de 50 ha et couvriront les cinq principaux types écologiques représentatif du territoire. Chaque placette ensemencée par drone sera appariée à une placette témoin où les capsules larguées par les drones seront retirées pour tenir compte de l’établissement des semis d’origine naturelle. Un relevé de la végétation sera effectué en été 2025, et la germination et la hauteur des plants seront observées à l’automne 2025. Les types écologiques contenant un sol minéral accessible devrait avoir un taux de germination plus élevé. Cette étude validera l’utilisation des drones comme alternative pour restaurer efficacement les forêts brûlées tout en réduisant les coûts.
Mots-clés: Écologie forestière, Sylviculture, Feu de forêt, Échec de régénération, Ensemencement aérien
Elsa Dejoie
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Annie DesRochers (UQAT)
- Nicole Fenton (UQAT)
- Fabio Gennaretti (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les isotopes stables de l’azote (mesurés par le δ15N) sont des traceurs précieux pour comprendre les interactions contamination-nutrition-organismes. Les valeurs δ¹?N sont influencées par les émissions acidifiantes industrielles. Nous avons exploré le potentiel du δ15N pour détecter les variations liées à la pollution en menant des expériences contrôlées en serre avec des épinettes noires semées dans des sols acidifiés et/ou contaminés au plomb. La croissance des plantules, la diversité microbienne et le δ¹5N dans leurs tiges et le sol ont été mesurées, puis comparés aux variations de δ15N observées naturellement dans les cernes de croissance d’épinette noire autour de la fonderie Horne, Rouyn-Noranda, Canada. Le projet voulait tester l’hypothèse que les arbres exposés à des sols acides et contaminés au plomb présentent une croissance réduite, et que l’effet combiné acidification-plomb exacerbe cette situation. Cela serait associé à une diminution de la diversité microbiennes dans les sols pollués, réduisant l’absorption de 15N par ces organismes, entrainant une augmentation du δ15N dans les sols pollués, ainsi qu’une diminution du δ15N dans le bois des plantules. Nos résultats montrent cependant que les plantes peuvent s’acclimater à des conditions acides et contaminées, retrouvant des niveaux de croissance normaux après une saison de croissance. En revanche, nos résultats confirment que les valeurs de δ15N suivent les tendances attendues, avec une augmentation dans le sol et une diminution dans les épinettes en serre et en forêt. Cette recherche apporte une meilleure compréhension des interactions entre la pollution industrielle et les variations isotopiques du δ15N dans les sols et les plantes, en offrant pour la première fois un suivi détaillé en milieu contrôlé. Elle est donc essentielle pour évaluer le véritable potentiel du δ15N en tant qu’indicateur des perturbations biogéochimiques.
Mots-clés: Isotopes; azote; pollution; fonderie; microbiome
Pierrick Arnault
Étudiant.e au doctorat
UQO
Autres auteurs
- Christoforos Pappas (University of Patras)
- Nia Sigrun Perron (UQO)
- Tristan Monette (UQO)
- Gabriel Bastien-Beaudet (UQO)
- Philippe Nolet (UQO)
- Audrey Maheu (UQO)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Des augmentations de durée et de sévérité des déficits hydriques au niveau du sol dans les écosystèmes forestiers tempérés d'Amérique du Nord sont à prévoir dans les années à venir. En parallèle, un phénomène de prolifération du hêtre est observable dans les érablières du sud du Québec. L’objectif de cette étude est de caractériser par différentes méthodes les stratégies foliaires d’utilisation de l’eau de l’érable et du hêtre lorsque les deux espèces sont soumises à un déficit hydrique au niveau du sol. L'étude s'est déroulée dans des érablières situées dans la réserve privée de Kenauk, dans le sud du Canada. Le plan expérimental était composé de trois sites touchés par la prolifération et trois témoins. Chaque site comportait deux parcelles de 400 m2, une avec un traitement d'exclusion des précipitations et une témoin. Nous avons caractérisé les stratégies de nos espèces en utilisant des méthodes basées sur la conductance de la canopée et sur des potentiels hydriques foliaires. Afin d’estimer les conductances de la canopée des individus, nous avons mesuré les densités de flux de sève de 43 érables à deux stades ontogénétiques et de 13 gaules de hêtre de début juin à la mi-septembre en 2023 et 2024 à l'aide de capteurs de flux de sève à vitesse d'impulsion thermique. La réserve en eau relative du sol (REW) des sites d’exclusion des précipitations était plus faible que celle des sites témoins, valant respectivement 0,36 et 0,61 pour les trois semaines les plus sèches de l’été 2024. Les résultats préliminaires suggèrent que les deux espèces vont tendre vers l’anisohydrie, avec un degré plus fort pour le hêtre. Les conclusions de notre étude permettront de mieux comprendre comment ces espèces vont réagir aux changements climatiques, donc de mieux comprendre les changements de compositions forestières à venir.
Mots-clés: Conductance de la canopée, Déficit hydrique du sol, Hêtre à grandes feuilles, Érable à sucre, Stade ontogénique, Stratégies d?utilisation de l?eau.
Mégane Déziel
Étudiant.e au doctorat
UQAM
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les changements climatiques modifient la répartition spatiale des espèces d’arbres, entraînant un réassemblage des communautés forestières et des changements dans les services écosystémiques qu’elles assurent. Comprendre les facteurs qui gouvernent la migration des arbres est essentiel pour prédire leur distribution géographique future. Les traits fonctionnels associés à la tolérance, à l’adaptation, ainsi qu’aux capacités de reproduction et de dispersion pourraient influencer les capacités migratoires des arbres en réponse au climat.
Nous avons évalué les liens entre les traits fonctionnels des arbres et leurs vitesses de migration sur 40 ans. À partir des inventaires forestiers du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et du nord-est des États-Unis, nous avons modélisé la répartition spatiale de 90 espèces d’arbres à deux périodes (1980-1989 et 2010-2019) en utilisant des modèles Random Forest basés sur des variables environnementales. Ces modèles nous ont permis de produire des cartes de répartition des espèces sur l’ensemble du nord-est de l’Amérique du Nord à 40 ans d’intervalle.
À partir de ces cartes, nous avons calculé la vélocité de migration vers le nord ainsi que les variations de l’aire de distribution totale pour chaque espèce entre les deux périodes. Nous avons ensuite utilisé des modèles additifs généralisés mixtes (GAMM) afin d’évaluer l’influence des traits fonctionnels des arbres et de la vélocité du climat sur ces dynamiques de migration.
Nos résultats permettent d’identifier les traits fonctionnels qui favorisent l’expansion ou limitent la migration des espèces d’arbres dans un contexte de réchauffement climatique. Ils soulignent l’importance de considérer ces traits pour mieux anticiper les trajectoires futures des communautés forestières face aux changements globaux.
Mots-clés: Écologie fonctionnelle, Migration des arbres, Dynamique des communautés, Random Forest, Changements climatiques
Marie-Pier Dubé
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Evelyne Thiffault (Université Laval)
- Osvaldo Valeria (UQAT)
- Guillaume Cyr (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Cette étude vise à déterminer les possibilités d'atténuation des GES dans l'atmosphère par la gestion forestière en termes d'utilisation des procédés de récolte tel que la récolte par arbres entiers ou tronc entiers, ainsi que la gestion des résidus forestiers tel que la mise en andain et la récupération des résidus pour la production de bioénergie. Nous traitons alors du bilan carbone des processus de récolte forestière et des pratiques de gestion des résidus d'exploitation. Le bilan carbone de ce projet sera la somme nette des émissions provenant de l'énergie fossile et des résidus forestiers, ainsi que de la séquestration due à la croissance des arbres et à la substitution de l'énergie fossile par la biomasse forestière résiduelle. Les objectifs de cette étude sont:1. Documenter les pratiques de gestion des résidus d'exploitation forestière au niveau régional, dans l'est du Canada.2. Analyser les liens statistiques entre les pratiques de gestion des résidus forestiers et les caractéristiques forestières régionales. 3. Quantifier les flux de carbone biogénique et fossile associés aux différentes pratiques de gestion des résidus forestiers à l'échelle régionale et estimer l'empreinte carbone de ces pratiques à l'échelle provinciale. Le résultat préliminaire pour le premier objectif est qu'il y a une utilisation majoritaire du procédé par tronc entiers pour la province du Québec. Le procédé de récolte par arbre entier est uniquement utilisé en majorité dans la région de la Côte-Nord. Les résultats préliminaires du deuxième objectif ont été obtenu par une analyse de machine learning algorithm : Random forest. Cette analyse nous permet de constater que la position géographique des coupes est ce qui influence le plus l'utilisation d'un procédé de récolte ou l'autre. Finalement, les travaux pour faire le bilan carbone des procédés de récolte et des pratiques de gestion des résidus de coupe est en cours.
Mots-clés: carbone, résidus de coupe, changements climatiques, GES
Anne-Marie Dubois
Étudiant.e à la maîtrise
Université de Montréal
Autres auteurs
- François Girard (Université de Montréal)
- Jérôme Théau (Université de Sherbrooke)
- Mathieu Varin (CERFO)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Autour de 400 000 d’hectares sont aménagés annuellement dans les forêts québécoises. Ces zones perturbées par l’activité humaine représentent une voie d’entrée de choix pour les espèces exotiques envahissantes, dont le nerprun bourdaine (Frangula alnus Mill.). Cet arbuste, reconnu pour coloniser de façon agressive les sous-bois à la suite d’une ouverture dans la canopée, menace notamment la régénération naturelle des milieux forestiers, particulièrement dans le sud du Québec. Malgré l’ampleur de ses répercussions, il n’y a pas de portrait complet sur la distribution actuelle du nerprun bourdaine, puisque cette espèce arbustive n’est pas réputée d’intérêt commercial et n’est donc pas recensée de façon systématique dans les inventaires forestiers.
Traditionnellement, les études qui permettent d’obtenir un portrait de la répartition d’une espèce végétale sont basées sur des jeux de données issues d’inventaires terrain ou d’efforts de photo-interprétation. Ces démarches, souvent onéreuses et chronophages, peuvent être difficiles à exécuter, surtout si le territoire à couvrir est vaste ou difficile d’accès. L’utilisation d’imagerie acquise par télédétection pour cartographier les espèces exotiques envahissantes s’est néanmoins avérée un succès dans plusieurs études. Dans le cas du nerprun bourdaine, la détection continue cependant de poser un problème lorsque sa densité est faible ou lorsque la canopée en surplomb est dense.
Mon projet de recherche de maîtrise explore comment la fusion d’imagerie multispectrale et de données lidar acquises par drone, combinée aux récentes techniques de classification automatisée orientée objet et d’apprentissage profond, peut permettre de développer une approche cartographique fiable et robuste du nerprun bourdaine. Un tel portrait représente un outil important pour la planification d’interventions et la modélisation de la propagation de cet envahisseur, notamment dans un contexte de changements climatiques.
Mots-clés: nerprun bourdaine, espèce exotique envahissante, fusion de données, classification orientée objet, apprentissage profond
Morgane Enea
Étudiant.e au doctorat
Université de Sherbrooke
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Alors que nous assistons à l’accélération des changements climatiques, un effort global est déployé afin d’anticiper l’adaptation future, dont la distribution, des espèces végétales et notamment arborées pour minimiser les répercussions de ces changements, notamment pour les espèces d’importance écologique et économique. Malheureusement, nous ignorons quel sera l’impact des interactions arbres-microbes dans la modification de l’aire de distribution des espèces arborescentes. Bien qu’il soit évident que les microbes jouent des rôles clés, ils sont rarement pris en compte dans les modèles prédictifs. Ce projet porte sur les facteurs microbiotiques influant la croissance de l’érable à sucre. Ce géant emblématique en déclin montre une forte dépendance aux interactions biotiques, notamment avec les champignons mycorhiziens à arbuscules. Afin de mesurer et d’isoler l’impact des bactéries et des champignons racinaires sur la croissance de leur hôte, nous conduisons des expériences de croissance en serres durant quatre mois, notamment en appliquant des traitements à la néomycine (antibiotique) et à la cycloheximide (antifongique). Les sols des inocula, représentant 7% du pot, ont été collectés à Sutton et au mont Mégantic. Des échantillons ont été prélevés à plusieurs stades de l’expérience pour réaliser des séquençages 16S et ITS, identifiant alors la communauté microbienne des origines du sol et des traitements appliqués. Après 70 jours de culture, la croissance des érables (0,44 cm par jour) en présence de la communauté microbienne intacte est 1,2 fois plus élevée qu’en son absence (p<0,001), quelle que soit l’origine du sol. De plus, la croissance du diamètre basal de nos semis à ce stade est inférieure en absence de bactéries (p<0,001). Cela suggère l’importance cruciale de ces dernières même si les champignons mycorhiziens sont présents. Les différences évoluant avec le temps montrent aussi l’importance d’effectuer des expériences sur plusieurs mois comme celle-ci et les résultats des séquençages préciseront rapidement nos résultats.
Mots-clés: érable à sucre, interactions arbre-microbes, rhizosphère, croissance, expérience en serre
Alexandre Ethier
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Junior A. Tremblay (Environnement Canada)
- Marc Mazerolle (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les suivis acoustiques passifs sont utilisés pour étudier les populations d’espèces aviaires. L’activité vocale fréquente des oiseaux offre une opportunité de suivre les populations via l’utilisation d’unités d’enregistrement autonomes (UEA). L’utilisation de ces appareils, jumelée à des algorithmes d’identification automatique, s'avère être plus efficace que les méthodes traditionnelles d’inventaires. Les UEA permettent un effort d’échantillonnage constant selon un horaire défini et ne nécessitent pas les compétences d’un observateur expérimenté sur le terrain. De plus, cette méthode permet d’offrir des renseignements sur l’écologie d’espèces cryptiques dont l’habitat est difficile d’accès. C’est le cas notamment de la Grive de Bicknell (Catharus bicknelli), une espèce spécialiste menacée au Canada, dont la majorité de son aire de nidification se trouve au Québec. Cette espèce nécessite des conditions d’habitat particulières, soit une densité importante (>20 000 tiges/ha) de Sapin baumier (Abies balsamea) en altitude (>750 m). Cette grive chante au crépuscule ou à l’aube et est généralement très discrète, ce qui réduit grandement la probabilité qu’elle soit détectée pendant un inventaire. Le protocole utilisé par le Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les Changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) exige des visites périodiques par des ornithologues dans l’habitat de la Grive de Bicknell, aux heures propices d’activité de l’espèce. Les contraintes logistiques et de sécurité associés à la difficulté d’accès de son habitat rendent la méthode actuelle dangereuse, inefficace et coûteuse. Le présent projet vise à établir un protocole standardisé de suivi acoustique passif de la Grive de Bicknell couplé au logiciel CallSeeker pour l’analyse des enregistrements sonores recueillis. L’objectif est d’établir des directives concises pour optimiser le suivi de cette espèce tel que l’établissement des fenêtres d’activités vocales ainsi qu’une utilisation optimale et facilitée du classificateur CallSeeker, spécialement conçu pour reconnaître les signatures vocales de la Grive de Bicknell.
Mots-clés: Oiseau, spécialiste, automatisation, méthode, enregistrement
Juliane Fisette
Étudiant.e à la maîtrise
UQAR
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les régions montagneuses abritent une diversité floristique remarquable, avec des sommets alpins présentant plusieurs analogies avec les systèmes insulaires. Certains auteurs considèrent donc que la richesse floristique des îlots alpins, héritée de la toundra périglaciaire, est influencée par leur superficie et leur isolement, comme le prédit la théorie de la biogéographie insulaire. Cependant, l’hétérogénéité topographique et géologique altère cette prédiction en favorisant la coexistence des espèces.
Au nord des Appalaches, le massif gaspésien illustre bien cette dynamique. Le territoire abrite des espèces arctiques-alpines, disjointes et endémiques (ci-après « flore particulière »). La déglaciation aurait procédé d’ouest en est dans le massif, créant des avant-postes de colonisation végétale dans l’ouest.
L’objectif est d’évaluer l’influence des facteurs susceptibles de déterminer la répartition géographique de la flore particulière du massif gaspésien incluant l’étendue et l’isolement des habitats, l’hétérogénéité environnementale et l’histoire post-glaciaire. L’étude comparera les trois régions géologiques du massif : le chaînon méta-sédimentaire des Chic-Chocs à l’ouest, le plateau serpentineux du Mont-Albert au centre et le batholite granitique des McGerrigle à l’est.
La richesse spécifique pourrait être supérieure dans les monts McGerrigle en raison de leur complexité topographique et de leur surface alpine supérieure. Alternativement, la richesse floristique pourrait être supérieure dans les Chic-Chocs en raison d’une colonisation végétale hâtive. Les sols dérivés de roches méta-sédimentaires des Chic-Chocs seraient également plus favorables à la croissance végétale que les sols granitiques des McGerrigle, alors que les sols ultramafiques du Mont Albert devraient supporter un taux élevé d’endémisme.
Une base de données des occurrences de la flore particulière sur le territoire a été montée en combinant des données d’herbier à une campagne d’échantillonnage. La datation radiocarbone des premiers sédiments postglaciaires dans des lacs du territoire a permis de confirmer le patron de déglaciation. Éventuellement, les occurrences floristiques seront superposées aux données géologiques, historiques et environnementales.
Mots-clés: Biogéographie insulaire, colonisation postglaciaire, hétérogénéité environnementale, région montagneuse
Jovanie Fodom
Étudiant.e à la maîtrise
UQAM
Autres auteurs
- Kaysandra Waldron (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Daniel Kneeshaw (UQAM)
- Martina Sánchez-Pinillos (UQAM)
- Amandine Hermann (UQAM)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Une mortalité accrue, mais inexpliquée de l’épinette noire (EPN) a débuté à partir de 2020 dans les pessières sur la Côte-Nord au Québec. Bien que l’EPN ait été considérée comme une espèce moins susceptible et vulnérable à la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE), elle subit désormais un dépérissement et une mortalité sans précédent dans une épidémie qui sévit depuis 2006 dans la région. Même si de nombreuses études ont évalué les effets de la TBE dans la mortalité de l’EPN à l’échelle du peuplement, elles n’ont pas réussi à identifier tous les facteurs impliqués dans le processus dans cette région. En plus des effets directs causés par la TBE, nous nous demandons comment des facteurs forestiers et environnementaux à l’échelle du paysage pourraient affecter le développement et la sévérité de l’épidémie et, indirectement, la mortalité de l’EPN. Plus précisément, notre projet de recherche examine comment la mortalité à l’échelle des peuplements est amplifiée par les variables des forêts avoisinantes, la défoliation et la topographie à l’échelle du paysage. Il est attendu que la mortalité des EPN au sein des peuplements varie en fonction de la composition des peuplements avoisinants et aussi de la perméabilité du paysage à la dispersion de l’insecte. Les inventaires réalisés dans 78 peuplements circulaires de 400m2 ont permis de mesurer la mortalité des EPN. Dans un rayon de 1km (paysage) autour de chaque peuplement, nous avons caractérisé les variables forestières, les variables topographiques, ainsi que le patron de défoliation. L’analyse des données, réalisée à l’aide du modèle d’équations structurelles, évalue comment les variables des forêts avoisinantes permettent de comprendre la mortalité des EPN au sein des pessières. Cette recherche permettra d’avancer les connaissances sur le fonctionnement des épidémies de TBE chez les peuplements d’EPN, afin de contribuer éventuellement à rendre cet écosystème plus résilient.
Mots-clés: Dynamique forestière, perturbations naturelles, résilience, modélisation
Cassandre Fournier
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les changements climatiques affectent la distribution des espèces forestières, notamment celle de l'érable à sucre qui pourrait potentiellement migrer vers le nord. Cependant, les impacts spécifiques de l’acériculture dans les érablières nordiques, constituées de conifères à la différence des peuplements plus au sud, restent peu étudiés. Cette étude vise à obtenir une meilleure compréhension des effets que l’acériculture pourrait avoir sur la biodiversité en sous-bois, notamment sur les plantes vasculaires ainsi que les lichens et bryophytes épiphytes des érablières nordiques. Une approche comparative entre des érablières exploitées et non exploitées, à l’extrémité nordique ou plus au sud de la distribution de l’érable à sucre sera employée. Elle se concentrera sur la diversité et composition en espèces des plantes vasculaires, bryophytes et lichens épiphytes en sous-bois. Les résultats contribueront à une meilleure compréhension de l’impact de l’acériculture sur la biodiversité des érablières nordiques et des réactions des différents groupes face aux perturbations associées. Ils contribueront également à développer des pratiques de gestion acéricole compatibles avec la préservation de cette biodiversité.
Mots-clés: érable à sucre, acériculture, limite de distribution, bryophytes, lichens
Jérémy Fraysse
Étudiant.e au doctorat
Université de Sherbrooke
Autres auteurs
- Isabelle Laforest-Lapointe (Université de Sherbrooke)
- Alain Paquette (UQAM)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
L’aménagement des forêts urbaines est aux cœurs des enjeux pour rendre nos villes plus résilientes et inclusives. Les insectes, par leur petite taille et leur grande diversité fonctionnelle, offrent une perspective unique pour améliorer la conception des espaces urbains avec des solutions adaptées à des échelles plus fines. La prise en compte des besoins des insectes peut ainsi favoriser une biodiversité urbaine plus riche et une meilleure qualité de vie pour les habitants.
Mon affiche aborde plusieurs éléments essentiels à l’aménagement des rues et des forêts urbaines, incluant la diversité végétale, la connectivité écologique et l’adaptation aux contraintes anthropiques. Une attention particulière est aussi portée à la biodiversité sous toutes ses formes – richesse spécifique, diversité fonctionnelle, diversité génétique et complexité structurelle – afin d’aborder les interactions écologiques bénéfiques aux insectes. En parallèle, l’impact positif de ces aménagements sur la population est examiné, notamment par la régulation du climat urbain, l’amélioration de la qualité de l’air et l’augmentation des espaces de bien-être et de mobilité douce.
À travers une approche interdisciplinaire, mon affiche met en avant l’importance de considérer les insectes comme des bioindicateurs dans la construction de nos villes de demain. Elle souligne que la mise en place de structures vertes comme des corridors écologiques et une gestion respectueuse de la faune entomologique contribuent non seulement à la conservation de la biodiversité, mais aussi à l’amélioration du cadre de vie urbain. Cette approche pourrait inspirer à l’avenir de nouvelles stratégies de planification urbaine intégrant la biodiversité entomologique, ses besoins et ses interactions à différentes échelles.
Mots-clés: Forêt urbaine - Insectes - Aménagement - Bénéfices - Résilience
Stéphanie Frégeau
Étudiant.e à la maîtrise
UQO
Autres auteurs
- Frédérik Doyon (UQO)
- Patricia Raymond (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Ayant déjà considérablement accru son abondance dans son aire de répartition actuelle durant le siècle dernier, il est prédit que l’érable rouge (Acer rubrum) continuera cette progression vers le nord, stimulé par les changements climatiques. L’érablière rouge mixte est déjà parmi les types de peuplements les plus fréquents dans les Basses-Terres du Saint-Laurent et les Appalaches. La sylviculture de ces peuplements implique généralement des systèmes faisant intervenir des coupes partielles. Cependant, on connait peu leurs effets sur la végétation du sous-bois forestier. Cette étude vise à comprendre la réponse en identité (i.e. composition d’espèces) et en diversité (i.e. richesse et équitabilité en espèces) des communautés de la végétation du sous-bois cinq ans après l’application de coupes partielles d’intensité variable. Ce projet de recherche est réalisé au sein du dispositif SylvAdapt, un dispositif BACI (Before, After, Control, Impact), dans 14 sites répartis équitablement en Chaudière-Appalaches et au Centre-du-Québec. Chaque site se compose de quatre parcelles de 2 500 m2, dont trois ont été éclaircies selon différents seuils de surface terrière résiduelle (6 m2/ha, 12 m2/ha et 20 m2/ha) et une parcelle témoin. Pour chaque parcelle, le recouvrement des espèces végétales du sous-bois a été évalué dans 16 microplacettes de 4 m2, un an avant et cinq ans après les éclaircies. Des données supplémentaires sur les microsites (lumière, humidité du sol, rocaillosité et microrelief) seront collectées à l’été 2025. À partir du modèle LiDAR 3D des parcelles, la lumière disponible au sol sera estimée à l’aide du module Samsara Light. Une retombée importante de ce projet sera la capacité de prédire le risque de compétition à la régénération forestière causée par la végétation récalcitrante (i.e. à croissance rapide et persistante) selon l'intensité de l’éclaircie de la coupe partielle.
Mots-clés: Végétation du sous-bois, Communautés, Succession végétale, Hétérogénéité spatiale, Modélisation de la lumière, Végétation concurrente à la régénération forestière, Dispositif BACI
Johanna Arnet
Étudiant.e à la maîtrise
UQAM
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Avec l’augmentation des tempe?ratures mondiales, l’exposition humaine a? la chaleur extre?me devient de plus en plus re?pandue. Ces tempe?ratures extre?mes sont amplifie?es dans les milieux urbains en raison de l’abondance de surfaces imperme?ables et du manque de ve?ge?tation. Ce phe?nome?ne, appele? i?lot de chaleur urbain (ICU), peut avoir de nombreux effets ne?fastes sur la sante? physique et mentale des personnes, et me?me des affections potentiellement mortelles tels que les coups de chaleur et l’exacerbation des symptômes associés aux troubles de sante? mentale. Par conse?quent, les villes cherchent des moyens de s’adapter et de rendre les villes habitables pour des populations en constante augmentation. De nombreuses études soutiennent les initiatives de plantation d’arbres comme un outil prometteur, en raison de leurs effets de refroidissement par l’ombrage et l’évapotranspiration. Cependant, les villes sont hétérogènes dans leur forme, avec des diffe?rences de densite? de construction et de hauteur des ba?timents, ce qui entrai?ne, par conséquent, des variations climatiques a? l’e?chelle micro. De plus, la structure de la canopée varie en fonction des arbres qui la compose. Étant donné que le microclimat et les caractéristiques morphologiques et physiologiques des arbres sont liés à leur capacité de refroidissement, considérer uniquement la relation entre la couverture totale de la canopée et la réduction de la température pourrait constituer une simplification excessive. Pour investiguer l’impact de la forme urbaine et de la composition de la canopée sur le potentiel de refroidissement des arbres, mon étude utilise un capteur de température monté sur vélo. Nous avons conçu 5 trajets concentrés autour du centre-ville de Montréal qui nous avons ensuite parcouru à plusieurs reprises pendant l’été de 2025, de jour comme de nuit. Cette étude aidera les villes du monde entier à optimiser le choix et l’emplacement des arbres afin d’obtenir un effet de refroidissement maximal.
Mots-clés: forêt urbaine, îlot de chaleur, forme urbaine
Maria Lucia Gonzalez Torres
Étudiant.e à la maîtrise
Université de Sherbrooke
Autres auteurs
- Isabelle Laforest-Lapointe (Université de Sherbrooke)
- Mélanie Jean (Université de Moncton)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les mousses sont une composante essentielle des écosystèmes forestiers, en particulier dans la zone boréale, où elles contribuent à la séquestration du carbone, au cycle des nutriments et à la régénération des plantes vasculaires. De plus, ces fonctions écologiques et la santé des mousses sont influencées par leur microbiome. Nous savons que les champignons associés aux mousses, leur mycobiome, comprennent divers taxons qui peuvent varier de parasitaires à mutualistes. Cependant, la manière dont ces communautés s'assemblent à travers les forêts d’Amérique du Nord reste peu connue. Alors que les études métagénomiques de la bryosphère se sont majoritairement concentrées sur les taxons bactériens en utilisant le séquençage à lecture courte, l’étude des mycobiomes est particulièrement complexe en raison de la variabilité de la longueur du marqueur ADN couramment utilisé pour discriminer les espèces fongiques (la région ITS) : cela complique alors l’attribution précise des séquences courtes aux bases de données de référence, elles-mêmes limitées. Toutefois, les progrès récents des technologies de séquençage à lecture longue ont permis d’améliorer l'efficacité et la résolution de l’identification taxonomique des microorganismes, une avancée prometteuse pour caractériser les communautés fongiques. Ce projet vise ainsi à caractériser les mycobiomes associés aux mousses, et ce, le long d’un gradient latitudinal de la forêt tempérée à boréale du Québec, en utilisant le séquençage à lecture longue et en identifiant les facteurs qui structurent ces communautés. Nous anticipons que la spécificité des communautés fongiques aux mousses hôtes sera faible, mais que les groupes fonctionnels différeront entre les gamétophytes verts et bruns. Nous prévoyons également d'observer un changement de la diversité des mycobiomes à travers les domaines bioclimatiques, puisque des facteurs tels que les précipitations, la température, ainsi que le type de litière et de sol pourraient avoir un effet sur la composition et la structure des communautés fongiques.
Mots-clés: Bryophytes, mycobiome, dynamique des communautés, interactions, métagénomique, forêt boréale, forêt tempérée
Isabelle Grenier
Étudiant.e à la maîtrise
UQO
Autres auteurs
- David Rivest (UQO)
- Marc-Olivier Martin-Guay (UQO)
- Antoine Mathieu (UQO)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Au Québec, on dénombre près de 19 000 hectares de coulées agricoles qui pourraient être aménagées par des plantations d’arbres, notamment pour améliorer la biodiversité et le stockage du carbone dans les agroécosystèmes. Ces terres agricoles abandonnées sont des terres en forte pente qui peuvent présenter plusieurs contraintes au succès des plantations dont une concurrence herbacée intense à maîtriser, des sols lourds et compactés et une forte pression d'herbivorie par les cerfs de Virginie. Dans le contexte de l’engouement récent pour la valorisation des coulées agricoles par le boisement, l’objectif général de cette étude est de déterminer le succès d’établissement de différentes espèces d’arbres qui y ont été plantées et d’explorer le rôle que peuvent jouer différents facteurs biotiques, abiotiques et techniques dans ce succès. Je vais échantillonner entre 25 et 30 coulées agricoles qui ont été plantées dans les basses-terres du St-Laurent au Québec au cours des 10 dernières années. Différentes variables seront mesurées pour déterminer le succès d’établissement des espèces plantées dont le taux de survie, la taille des arbres et les signes d’herbivorie. Parmi les facteurs de succès qui seront analysés, soulignons les suivants : pH, texture et classe de drainage du sol, conditions climatiques à l’année de plantation, densité de plantation, abondance et composition de la végétation herbacée, et présence ou absence de pratiques de répression de la végétation concurrente et de protection des plants contre la faune. Les résultats de ce projet de maîtrise pourront contribuer à formuler des recommandations concernant les meilleures pratiques à adopter pour assurer le succès d’établissement des plantations en coulée agricole.
Mots-clés: Biodiversité, Sylviculture, Plantation, Boisement, Valorisation, Herbivories
Benjamin Guillon
Étudiant.e à la maîtrise
UQAC
Autres auteurs
- Nita Dyola (UQAC)
- Kaysandra Waldron (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Sergio Rossi (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Depuis quelques années sur la Côte-Nord (Québec), on observe un grand nombre de peuplements d’épinette noire (Picea mariana) en proie au dépérissement et à de forts taux de mortalité. La tordeuse des bourgeons de l’épinette (Choristoneura fumiferana) ayant habituellement une appétence pour le sapin baumier (Abies balsamea), est en partie à l’origine de ces évènements, accompagnée de divers stress climatiques. Ces forêts jouant des rôles primordiaux sur les plans économiques et culturels, des questions sur l’avenir de ces peuplements ont rapidement germées. La résilience de cet écosystème face à ces phénomènes est à l’étude à travers deux volets : la diversité spécifique du sous-bois et la régénération des arbres. Ainsi, nous cherchons à évaluer les tendances de diversité floristiques et de l’installation de la régénération en fonction de différents degrés de défoliation et de dépérissement des pessières noires. Ce type de perturbation peut changer drastiquement la structure et les conditions de lumière pour les espèces végétales présentent en sous-bois. Ici, nous étudions la réponse de cette flore à de telles conditions et nos données seront partagées avec la communauté Innue de Pessamit, nos travaux ayant lieu sur leur territoire ancestral. Pour ce faire, un dispositif de 36 placettes sont échantillonnées, entre Baie-Comeau et le lac Manicouagan. Nous nous attendons à observer une diversité spécifique plus faible dans les peuplements plus affectés, avec une forte dominance de certains végétaux sur d’autres espèces inféodées aux pessières noires. Quant à la régénération, des densités suffisantes pour assurer la survie des peuplements d’épinette sont attendues, bien que des relations de compétition resteront à explorer avec les espèces prédominantes dans le sous-bois. Les résultats serviront à mieux cerner l'ampleur de ces évènements au niveau du sous-bois, avoir une idée du succès de régénération de ces peuplements et faire des liens avec les pratiques culturelles innues.
Mots-clés: Épinette noire, défoliation, dépérissement, tordeuse, sous-bois, diversité spécifique, régénération, Nitassinan de Pessamit
Léa Hellegouarch
Étudiant.e au doctorat
UQAC
Autres auteurs
- Yan Boucher (UQAC)
- Alexandre Morin-Bernard (Université Laval)
- Patrick Faubert (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Depuis les années 1960, on a replanté plus de 2,5 millions d'hectares de forêt au Québec pour pallier une mauvaise régénération de la forêt après coupe forestière, ou à la suite de perturbations successives, ou pour la sylviculture intensive. Malgré les grandes superficies occupées par les plantations au Québec, il subsiste un manque de suivi et de connaissance sur la croissance et le rendement de ces plantations. Le premier objectif principal de cette thèse sera donc de suivre la croissance et le rendement des plantations dans la région boréale nordique après une mauvaise régénération causée par des feux successifs. (landes forestières). Toutefois, le suivi de ces plantations en milieu nordique présente plusieurs contraintes logistiques et économiques, rendant les inventaires terrestres difficiles à réaliser. Pour pallier ces limitations, nous utiliserons des approches de télédétection, notamment les drones et le LiDAR aéroporté, afin d’obtenir des données précises sur la structure des peuplements. L’analyse de ces données, combinée à des modèles de croissance, permettra d’estimer la production de biomasse aérienne en lien avec différents facteurs abiotiques (climat, perturbations naturelles, traitements sylvicoles, conditions topo-édaphiques). Cette recherche aidera à mieux comprendre comment les plantations croissent et quels sont les facteurs qui influencent leur développement. Notre deuxième objectif principal est de créer un profil de plus de 2,5 millions d'hectares de plantations plantées depuis les années 1960. Nous voulons comprendre comment elles ont évolué jusqu'à aujourd'hui et comment. Les résultats attendus sont notamment l'apparition de feuillus au sein des plantations, une baisse de la croissance notamment à la suite de perturbations naturelles (feux, épidémies, …) ou bien différentes coupes (éclaircissement, totale, partielle, …). L'étude aidera à comprendre les facteurs importants pour planifier les plantations. Elle permettra aussi d'évaluer la croissance et prévoir comment le changement climatique et les perturbations vont affecter l'avenir de ces plantations.
Mots-clés: plantation, croissance, télédétection, perturbations, modèle
Renée Hudon
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les cours d’eau de tête, bien que souvent de petites tailles, remplissent de nombreux services et fonctions écologiques fondamentales. Ainsi, une cartographie précise est indispensable pour l’application des lois et règlements protégeant les milieux hydriques et assure une gestion efficace de l’aménagement du territoire forestier (Freeman et al., 2007). Les lits d’écoulements potentiels (LEP), issus d’un modèle numérique de terrain (MNT), sont un produit cartographique qui détermine le chemin que devrait emprunter un écoulement de surface en fonction de la topographie. Ce modèle améliore significativement la précision des réseaux hydrographiques modélisés comparativement à la Géobase du réseau hydrographique du Québec. Suite aux travaux de Lessard (2020), un seuillage des LEP a été réalisé à partir des données de terrain collectées dans la région des Laurentides méridionales. Les seuils appliqués indiquent au modèle la superficie minimale de bassin versant, soit le drainage minimal nécessaire à la génération d’un lit de cours d’eau. Ainsi, dans le but de bien représenter les processus naturels de formation des cours d’eau de tête, un ajustement des seuils à la variabilité du territoire québécois est nécessaire.
Un inventaire des cours d’eau de tête, débutés à l’été 2024, a pour objectif de valider la modélisation actuelle des LEP dans les Appalaches, les Laurentides méridionales et dans les Basses-Terres du Saint-Laurent afin d’ajuster les seuils en fonction des composantes topographiques, physiographiques et géomorphologiques susceptibles d’influencer les aires de drainage. Plusieurs cours d’eau de tête ont également été instrumentés à l’aide de capteurs de mesures d’intermittence d’écoulement, qui détermine la présence ou absence d’eau dans les lits de cours d'eau (Chapin et al., 2014; Jensen et al., 2019). Ils permettront de comparer les conditions hydrologiques de différentes provinces naturelles et d’évaluer la contribution des composantes topographiques et géomorphologiques à la génération des débits de base (Jensen et al., 2019).
Mots-clés: Cours d'eau de tête, Modélisation des lits d'écoulements potentiels, seuils, conditions hydrologiques, Formation des lits de cours d'eau
Alberto Jean Baptiste
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Xavier Cavard (UQAT)
- Kaysandra Waldron (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Résumé. La forêt boréale occupe une place prépondérante dans le bilan carbone (C) mondial. Ses sols sont riches en matières organiques et contiennent 43 % du C du sol mondial, mais ces stocks sont affectés par des perturbations naturelles et anthropiques. La tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) est l'insecte ravageur le plus prévalent des forêts boréales de l'est de l'Amérique du Nord, s’attaquant notamment au sapin baumier et à l’épinette noire. Les réductions de croissance des arbres sur plusieurs années réduisent le stock du C dans la végétation et le transfert de C vers les réservoirs de matière organique morte, après le pic initial dû à la mortalité des tiges. Au Québec, les coupes de récupération sont des pratiques courantes effectuées pour réduire les pertes économiques liées aux perturbations naturelles, mais ses effets sur la dynamique du C forestier en comparaison avec la dynamique naturelle post-épidémique sont méconnus. Ainsi, l’objectif général de cette étude est d’évaluer les effets de la TBE et des coupes de récupération sur la dynamique du carbone organique du sol et le microbiote des sols. L’étude est réalisée sur la Côte Nord, au Québec. Des parcelles ont été sélectionnées parmi des sapinières traitées à l’aide de l’insecticide biologique Bacillus thuringiensis var kurstaki par la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies, ainsi que parmi des pessières présentant naturellement différents degrés de mortalité et des peuplements coupés après les premières défoliations. Les sols seront analysés pour déterminer la concentration en C et éléments nutritifs ainsi que la biomasse microbienne, alors que les arbres morts seront dénombrés et mesurés afin d’estimer le C dans la nécromasse. Ces résultats devraient améliorer nos connaissances sur les effets de la TBE et des coupes de récupération sur la dynamique du C dans la matière morte en forêt boréale.
Mots-clés: dynamique du carbone organique, coupe de récupération, bois mort, biomasse microbienne, TBE.
Ari Kainelainen
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Fabio Gennaretti (UQAT)
- Igor Drobyshev (Swedish University of Agricultural Sciences)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
We explored climate-growth analysis in the context of low-intensity (33-40% removal) partial cutting, carried over two decades ago, in boreal mixedwoods balsam fir-trembling aspen stands (Abies balsamea and Populus tremuloides). We modelled tree growth responses using XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) open-source machine learning library. The effects of seasonal climate variability on the growth of residual balsam fir originating from control and partial cutting (PC) treatments were disentangled. For interpretability of XGBoost model results, we used Shapley values - a game theory tecnhinque. The machine learning techinque allowd for highlighting that PC has had positive contribution on the growth of residual trees during the first period of around a decade. This effect was stronger than the effects of any of the climate variables for most years within the decade. In the following decade the effects of PC dwindled, resulting in weaker effect than individual climate variables. Th explored technique appear to have high potential for climate-growth-related studies in the context of biotic and abiotic disturbances. Our preliminary results call for additional research on the utility of modern machine-learning tools, particularly, in the context of climate change and sustainable forest management.
Mots-clés: Climate-growth analysis, partial cutting, boreal mixedwoods, XGBoost model, Shapley values, machine learning
Natalie Kennedy
Étudiant.e au doctorat
UQAM
Autres auteurs
- Marla Schwarzfeld (Agriculture and Agri-Food Canada)
- Christian Messier (UQO-UQAM)
- Annick St-Denis (UQAM)
- Tanya Handa (UQAM)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Soil mesofauna are tiny invertebrates such as mites and springtails that contribute to important ecosystem functions such as organic matter decomposition and nutrient cycling. Despite their abundance in urban soils, little is known about the influence of various urban forest management practices on these animals. We studied the effect of tree planting context and species selection on soil mesofaunal communities, hypothesizing that stressors (such as elevated salinity and compaction) will negatively affect soil mesofaunal abundance. Soil cores from below street median and grassy park trees were sampled in three municipalities of the Montreal Metropolitan Area (Le Plateau Mont-Royal, St. Lambert and St. Bruno-de-Montarville), and additional sidewalk tree pits were sampled from Le Plateau. Samples were collected from below three species: Acer saccharinum, Gleditsia triacanthos, and Celtis occidentalis. Two additional species (Picea pungens, Pinus sylvestris) and an additional planting context (planted woodland) were sampled in St. Lambert. Soil abiotic conditions (compaction, pH, and salinity) were recorded and mesofaunal abundances are currently being counted. Salinity was the highest in sidewalk tree pits and the pH was lowest in the planted woodland. Preliminary results suggest that in the most urbanized site (Le Plateau Mont-Royal), higher mesofaunal abundance were found in soils under trees planted in sidewalks and medians than in the grassy park, but that this difference was not observed in the two suburban sites. Overall tree species identity had no influence on abundance of mesofauna. Future work will assess mesofaunal community composition and diversity using molecular and morphological techniques to further elucidate effects of urban forest management practices on these communities.
Mots-clés: Urban forestry, soil biodiversity, soil mesofauna
Nataliia Kryvda
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Autres auteurs
- Annie DesRochers (UQAT)
- Mebarek Lamara (UQAT)
- Ilga Porth (Université Laval)
- Alain Leduc (UQAM)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides Michx.) est l'espèce d'arbre clonale la plus répandue en Amérique du Nord. Le peuplier se reproduit en majorité végétativement après une perturbation en produisant des drageons issus des racines parentales. Au cours de leur cycle de vie, les drageons ne deviennent pas indépendants de la racine mère, mais celle-ci est incluse dans son propre système racinaire et continue de relier les arbres entre eux. L'intégration physiologique entre les arbres augmente même avec le temps par la formation de greffes racinaires (anastomoses) entre arbres d’un même ou de génotypes différents. Bien que la reproduction végétative soit prédominante, le peuplier conserve une grande diversité clonale, avec plusieurs génotypes représentés par un seul ramet. Cette étude examine le rôle des connexions racinaires dans le maintien de la diversité génétique du peuplier, notamment dans le contexte de la régénération après perturbation. On propose l'hypothèse selon laquelle les systèmes racinaires des peupliers forment une réserve de génotypes, permettant de régénérer des génotypes disparus du peuplement grâce aux connexions racinaires entre les arbres de différents génotypes et à la survie des racines des arbres morts. Trois peuplements naturels de peupliers matures ont été sélectionnés et échantillonnés pour une analyse génétique par séquençage à haut débit. Après avoir coupé les arbres pour stimuler le drageonnement, le système racinaire a été excavé l'année suivante à l'aide d'un jet d'eau à haute pression. Cela a permis de génotyper les drageons et d'analyser les profils génétiques des racines connectées, ainsi que l'apparition de nouveaux génotypes. Cette étude permettra de mieux comprendre comment les connexions racinaires pourraient contribuer au maintien pour une longue période d’une grande diversité génétique du peuplier faux-tremble malgré un mode de régénération essentiellement végétatif.
Mots-clés: peuplier faux-tremble; diversité clonale; greffes racinaires naturelles; système racinaire; régénération végétative
Aude Laforest
Étudiant.e au doctorat
UQAC
Autres auteurs
- Yan Boucher (UQAC)
- Victor Danneyrolles (UQAC)
- Marie-Hélène Brice (Université de Montréal)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les forêts tempérées et boréales de l’Est du Canada subissent aujourd’hui les effets des changements climatiques directs (e.g., changements physiologiques dûs à l’augmentation des températures) et indirects par modification des régimes de perturbation (e.g., augmentation des superficies brûlées), auquels se rajoute l’impact généralisé des coupes forestières. La combinaison des perturbations naturelles, des coupes et des changements climatiques sur ces territoires inquiètent quant à leur impact sur la capacité de résilience des forêts, d’où la nécessité d’examiner leurs trajectoires historiques à long-terme. Ce projet en démarrage vise à reconstituer les changements dans la composition et la structure des forêts boréales et tempérées de 1950 à aujourd’hui, en réponse aux perturbations (i.e., feux et coupes) et aux changements climatiques. Les analyses se baseront principalement sur les archives historiques de la compagnie forestière Consolidated-Bathurst Inc., qui contiennent des inventaires forestiers (cartes et inventaires terrain) remontant jusqu’aux années 1950 et couvrent plus de 3 millions d’hectares de forêts en Mauricie et au Lac Saint Jean. Dans un premier temps, nous utiliserons les cartes recensant les feux et les coupes entre la fin du 19e siècle et les années 1950, en complément avec les données d’inventaires modernes (1970-2025), pour reconstituer l’historique à long-terme des perturbations de ces territoires. Notre second objectif sera ensuite de modéliser l’impact de ces perturbations et des changements climatiques sur les trajectoires de structure et de composition des forêts entre 1950 et aujourd’hui. Des inventaires historiques permettront d’évaluer ces variables dans les années 1950, puis les données récoltées seront comparées aux inventaires modernes afin d’estimer les changements survenus depuis. Les résultats obtenus permettront de mieux comprendre les trajectoires historiques et d'anticiper les trajectoires futures des forêts, fournissant ainsi des informations cruciales pour la gestion forestière durable des forêts de l'est du Canada.
Mots-clés: forêts boréales, forêts tempérées, inventaires forestiers, feux, coupes, changement climatique, Est du Canada
Dominic Bartolacci
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les zones urbaines, soumises à une hausse des températures liée au changement climatique et à la formation d'îlots de chaleur, cherchent des solutions. L'intégration stratégique d'arbres émerge comme une réponse cruciale, offrant ombre et avantages variés. Néanmoins, la santé des arbres est menacée par les impacts anthropogéniques, accentués par les contraintes de conception urbaine. Ma recherche, fusionnant génie civil et foresterie urbaine, évalue l'influence de la conception des fosses d'arbre sur leur santé. Dirigée par la professeure Janani Sivarajah à l'Université Laval, en collaboration avec la Chaire de recherche sur l’arbre urbain et son milieu ainsi que la Ville de Québec, mon projet de maitrise va se concentrer sur la collecte de données indicateurs de la santé des arbres. Sur l'avenue Maguire et trois autres sites dans la ville de Québec, six modèles de fosses de plantations répartis sur 55 arbres, une première au Canada, ont été installés. L'objectif est d'élargir cette recherche à différents sites urbains pour optimiser les pratiques de plantation et atténuer les impacts anthropiques. En foresterie urbaine, des fosses bien conçues, adaptées aux besoins spécifiques des arbres, améliorent significativement leur survie. Cette étude évalue divers modèles de fosses, optimisant les pratiques de plantation. Les résultats préliminaires soulignent l'efficacité de traitements spécifiques et l'importance de pratiques adaptées par espèce, renforçant l'endurance et la résilience des arbres urbains.
Mots-clés: arbres urbains, fosse de plantation, santé des arbres.?
Aymen Lamloum
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les milieux humides (MH) assurent des fonctions écologiques essentielles, notamment la régulation hydrologique et le maintien de la biodiversité. Leur capacité à remplir ces rôles est influencée par leurs attributs géospatiaux (taille, forme, arrangement spatial), qui sont considérés comme des indicateurs d’intégrité écologique. Cependant, la manière dont ces attributs influencent la répartition spatiale des MH demeure peu étudiée, en particulier face aux perturbations anthropiques. En Abitibi, l’exploitation forestière, l’agriculture, les infrastructures routières et minières exercent des pressions croissantes sur ces écosystèmes. Ces perturbations pourraient modifier leur répartition spatiale, mais leur effet sur les attributs des MH et leur distribution selon les paysages reste à approfondir. Ce projet vise à analyser les patrons de répartition des MH et à évaluer leur proximité aux perturbations anthropiques, en intégrant une approche multi-échelle.
À l’échelle locale, des zones tampons (100 à 250 m) seront appliquées autour des MH individuels ou complexes fonctionnels pour quantifier leur proximité aux perturbations. À l’échelle du paysage, une analyse des bassins versants des quatre grandes régions naturelles de l’Abitibi permettra d’évaluer la distribution des MH selon différents contextes paysagers. Les métriques spatiales seront calculées avec FRAGSTATS, et une analyse de partitionnement identifiera des groupes fonctionnels de MH selon leurs attributs géospatiaux. Une superposition SIG des perturbations anthropiques sera réalisée pour analyser leur coïncidence spatiale avec ces groupes.
Les résultats attendus permettront d’identifier les types de MH les plus exposés aux perturbations et de vérifier si les MH isolés et de petite taille sont plus fréquents dans des paysages anthropisés. Cette étude fournira des indicateurs spatiaux robustes pour optimiser la gestion et la conservation des MH en contexte boréal.
Mots-clés: Milieux humides, perturbations anthropiques, patrons spatiaux, FRAGSTATS, approche multi-échelle.
Laurence-May Lévesque
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Julie-Anne Daumas (Université Laval)
- Gilbert Éthier (Centre de recherche et d'innovation sur les végétaux)
- Catherine Périé (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Morgane Urli (UQAM)
- Steeve Pepin (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les changements climatiques devraient intensifier les sécheresses édaphiques et atmosphériques, menaçant la survie des espèces reboisées dans le sud du Québec. Une forte mortalité a été observée en Outaouais après la sécheresse de 2012. Avec plus de 122 millions de plants reboisés chaque année au Québec, il est crucial d’évaluer la tolérance au stress hydrique, la croissance et la survie des plants après plantation afin d’adapter les pratiques sylvicoles. Les réponses physiologiques de plants (2+0) de quatre espèces clés (Picea glauca, Picea mariana, Pinus strobus, Pinus banksiana) à une sécheresse prolongée ont été étudiées sous deux scénarios climatiques (en serre) : (i) un climat actuel simulant les conditions quotidiennes de l’année 2012 en Outaouais ou (ii) un climat futur avec température haussée de ~4,5°C, humidité relative réduite, et concentration de CO2 atmosphérique accrue (~785 ppm). Une sécheresse graduelle fut induite du 16 juillet au 15 août, suivie d’un arrêt total d’irrigation jusqu’au 8 septembre 2024. Le potentiel hydrique du sol (Ψsol) atteint sous ces conditions a fortement varié selon l’espèce et le climat. Le climat futur a entraîné une diminution considérable du Ψsol, du potentiel hydrique de tige (Ψtige) et du taux de survie chez toutes les espèces, sauf P. strobus, où Ψsol est demeuré plus élevé, Ψtige fut similaire à celui sous climat actuel et le taux de survie a dépassé 90%. La croissance aérienne et souterraine fut réduite chez toutes les espèces, à l’exception de P. strobus. Sous climat futur, seuls les survivants de P. mariana ont dépassé leur seuil critique de cavitation (P12 = -2.83 MPa), atteignant un Ψtige de -3.44 MPa malgré un Ψsol élevé (-0.55 MPa). Enfin, les Ψtige pré-aube étaient jusqu’à six fois inférieurs au Ψsol, suggérant une discontinuité hydraulique marquée entre le sol et la plante. En somme, les conditions climatiques futures réduisent la survie et la croissance des plants de reboisement en stress hydrique, sauf chez P. strobus, dont la tolérance à la sécheresse fut accrue.
Mots-clés: Changements climatiques, Outaouais, Stress hydriques, Conifères, Reboisement, Tolérance à la sécheresse,
Rowena Ligalig
Étudiant.e au doctorat
UQAM
Autres auteurs
- Maddie Clark (Agence d'évaluation d'impact du Canada)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Climate change could increase the frequency and intensity of forest disturbances, threatening the ecosystem's carbon sequestration capacity and other services. Spruce budworm (SBW) outbreaks can significantly impact carbon dynamics due to the defoliation and mortality of affected trees. This study aims to improve carbon dynamics estimates by better understanding how SBW outbreaks interact with other disturbances and climate change at both stand and landscape levels. We used a forest landscape simulation model known as LANDIS-II in conjunction with its Forest Carbon Succession (ForCS) and Biological Disturbance Agent (BDA) extensions that we parameterized for SBW. Previous modeling studies have assumed that SBW outbreaks led to high forest mortality rates, which may not fully capture the complex dynamics of disturbances in Mixedwood forests. We carried out a local sensitivity analysis (LSA) to identify the most sensitive parameters and calibrated the model against empirical data based on repeatedly measured inventory plots to examine the effects of SBW on forest C. We then simulated the effects of disturbances using an experimental landscape within the forest management unit 042-51 (Mauricie, Quebec). Simulations were conducted over 100 years under three climate scenarios (baseline, RCP 4.5, RCP 8.5) and four disturbances (wind, SBW outbreak, fire, and logging). Our calibration efforts allowed the model to nearly match the disturbance severity and cumulative affected area observed in the field. Simulation results showed a decline in both belowground and aboveground carbon stocks under intense climate forcing, with multiple disturbances exacerbating these losses. As disturbances intensified, carbon storage was further compromised, leading to significant biomass fluctuations, accelerated biomass decline, increased respiration, and reduced net ecosystem productivity, ultimately shifting the forest towards becoming a net carbon source over time. This study provides insights on understanding how multiple factors interact to influence the forest carbon dynamics under the projected impact of climate change.
Mots-clés: Climate Change, Spruce budworm outbreak , LANDIS-II
Fionna Lilie
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Steven G. Cumming (Université Laval)
- Thierry Duchesne
- Tatiane Micheletti Ribeiro Silva (UBC)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Canada's temperate and boreal biomes face imminent transformation due to climate change, as evidenced by projections indicating shifts in landscape structure, pattern, and species composition. These changes are anticipated to profoundly impact fire regimes across the country, with potentially devastating consequences for wildlife populations. For instance, climate change-induced weather variability is expected to escalate the frequency and severity of wildfires, posing a possible threat to caribou survival. To address these challenges, this research project seeks to develop a comprehensive statistical model to further understand and characterize fire regimes, and their implications for caribou survival. More precisely, our objectives encompass the adaptation of existing simulation tools to better replicate inter-annual variability in fire occurrence, conducting simulation experiments across diverse Canadian sites, by integrating fire risks into standardized simulation models. In fact, current simulation models tend to underestimate the inter-annual variability in fire sizes and the annual area burned by using a Poisson distribution. As an alternative, we hypothesize that a negative binomial distribution may better capture this variability. Methodologically, the project will make use of an existing caribou population model to assess the probability of population persistence under varying fire regimes, employing fire counts information sourced from the Canadian Wildland Fire Information System. Anticipated outcomes include more precise predictions of fire regimes and enhanced understanding of fire-caribou interactions. Moreover, the project's positive impacts are expected to extend beyond the immediate objectives, influencing fire simulation models and fostering advancements in scientific research. In other words, by developing our understanding of fire ecology and its ecological implications, the project shall improve ecosystem resilience and sustainability measures in Canada's fire-prone regions, thus by facilitating informed decision-making and conservation efforts.
Mots-clés: climate change, boreal caribou, fire regimes, simulation modeling, negative binomial
Laima Liulevicius
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Autres auteurs
- Nicole Fenton (UQAT)
- Katherine Stewart (University of Saskatchewan)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Avec le réchauffement de l'Arctique, de nouvelles possibilités d'extraction de ressources naturelles apparaissent, entraînant une augmentation de l’exploitation de minéraux, de gaz et de pétrole. Les impacts environnementaux des forages exploratoires sont souvent négligés, mais des événements tels que les déversements de saumure de forage peuvent entraîner des conséquences importantes sur les écosystèmes de la toundra. Les déversements de saumure, une solution fortement saline, entraînent une mortalité importante de la végétation et requièrent souvent une revégétalisation assistée pour restaurer la couverture végétale indigène. Cependant, la plupart des efforts de revégétalisation dans la toundra se concentrent sur la réintroduction de plantes vasculaires malgré la dominance de la végétation non vasculaire comme les lichens et les bryophytes. Les bryophytes ont une forte capacité de régénération qui pourrait être exploitée pour la revégétalisation des sites affectés par le sel. Cependant, on sait peu de choses sur la tolérance des bryophytes arctiques indigènes à la salinité et sur la façon dont elle interagit avec d'autres facteurs de stress comme la sécheresse.
Nous évaluerons les capacités de régénération de Tomentypnum nitens, une bryophyte arctique commune, dans des conditions salines telles que celles des sites contaminés par la saumure. Des fragments de T. nitens seront cultivés sur des milieux de cultures gélosés à des conductivités électriques de <1dS/m, 3dS/m, et 8dS/m. Après 2 semaines de croissance, les fragments seront exposés à un traitement de sécheresse consistant à ne pas les arroser pendant une semaine, puis à les laisser se rétablir. Après 6 semaines, des mesures de photosynthèse seront effectuées sur les fragments de mousse et les changements de biomasse seront mesurés. Si la régénération de T. nitens est réussie, il pourrait s'agir d'une bonne espèce candidate à la restauration après un déversement de saumure.
Mots-clés: bryophytes, toundra, arctique, impacts de l'exploitation minière, revégétalisation, stress salin
Haley Elizabeth Magee
Étudiant.e à la maîtrise
UNB
Autres auteurs
- Rafaella Mayrinck (UNB)
- Barry Levi Shaw (UNB)
- Gaetan Pelletier (Northern Hardwoods Research Institute Inc.)
- Loïc D'Orangeville (Université Laval)
- James Farrell (RNCan)
- Nelson Thiffault (RNCan-Centre canadien sur la fibre de bois)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Silviculture, in New Brunswick, has traditionally concentrated on producing high-quality trees for timber at an accelerated rate. However, increasing demands for forest products in a changing climate requires a shift toward promoting forest adaptation. While research has largely emphasized softwood species due to their commercial importance, this study examines stand density management as a silvicultural tool to enhance both the resilience and productivity of hardwood forests. Leveraging a legacy spacing trial in New Brunswick, Canada, we aim to: a) examine the stand-level effects of pre-commercial thinning on hardwood tree growth and tree grading, assessing how different thinning intensities have influenced plot-level dynamics over 45 years in a hardwood dominated stand regenerated through clearcut harvest and b) assess the impact of increased competition on the growth and quality of individual hardwood trees, emphasizing tree-level responses to competitive pressure . Using both newly collected and historical inventory data, we will perform stand-level analyzes to explore relationships between growth, density, and stand characteristics, and tree-level analyzes that incorporate Hegyi's competition index to quantify the effect of competition on tree growth over time. We expect our results to advance the understanding of how silviculture can be further optimized to improve tree quality and stand yield, as well as northern hardwood resilience and resistance.
Mots-clés: Silviculture, stand density management, hardwood management, competition, tree quality
Annie-Claude Malenfant
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Autres auteurs
- Xavier Cavard (UQAT)
- Fabio Gennaretti (UQAT)
- Jérôme Laganière (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Dans un contexte de changements climatiques, le rôle de la forêt boréale en tant que puits de carbone revêt une importance cruciale. Toutefois, ces conditions climatiques nouvelles favorisent l’intensification des événements extrêmes, comme la saison exceptionnelle de feux de forêt de l’été 2023 au Québec. Ces épisodes de feu, souvent intenses et de grande étendue, entraînent d’importantes pertes de carbone, tant par la mortalité de la végétation que par la combustion de la matière organique des sols, qui constituent des réservoirs essentiels de carbone. Les feux de forêt, caractérisés par des sévérités variables, génèrent des impacts hétérogènes sur les peuplements forestiers. L’objectif principal de ce projet est de mieux comprendre comment la variabilité spatiale liée à la sévérité des feux influence les stocks de carbone, la respiration du sol et la régénération après feu au sein d’une même région incendiée. Un incendie complexe de l’été 2023, composé de 19 feux distincts dans les régions de Lebel-sur-Quévillon et de Senneterre (Québec), offre une occasion d’étudier cette hétérogénéité. De plus, le projet étudie l’impact des coupes de récupération comme perturbation additionnelle sur le cycle du carbone organique du sol et sur la régénération. Ces travaux contribueront à enrichir les connaissances sur la relation entre la sévérité des feux, le cycle du carbone et la régénération en forêt naturelle, tout en étudiant les impacts d’une perturbation anthropique additionnelle. Les résultats apporteront des perspectives pour améliorer les pratiques de gestion forestière durable suite à des perturbations majeures qui pourraient devenir de plus en plus fréquentes avec les changements climatiques.
Mots-clés: carbone, feux de forêt, coupes de récupération, régénération, carbone du sol, été 2023, respiration du sol, stock de carbone, perturbations combinées
Marie-Pier Ménard
Université de Montréal
Autres auteurs
- Julie Talbot (Université de Montréal)
- Evelyne Thiffault (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les tourbières forestières sont des écosystèmes très répandus dans le biome de la forêt boréale. Elles pourraient représenter jusqu'à la moitié de la superficie des tourbières dans ces régions et constituent des composantes importantes du cycle du carbone boréal. Elles peuvent toutefois être difficiles à identifier, car leur canopée n'est pas totalement distincte de celle des autres écosystèmes forestiers. Bien qu'elles soient de plus en plus reconnues comme des réservoirs de carbone importants, la quantité totale de carbone qu'elles stockent reste mal documentée et probablement sous-estimée. Ce projet vise à évaluer l’étendue des tourbières forestières de la forêt publique du Québec et à fournir une estimation préliminaire de la quantité de carbone séquestrée dans ces écosystèmes. Nous combinons échantillonnage sur le terrain, analyses spatiales et modélisation empirique pour créer une base de données géospatiale. Celle-ci permet de développer des modèles prédictifs en intégrant divers indicateurs de la présence des tourbières forestières et de leur capacité de stockage du carbone. Pour enrichir la base de données, nous avons également recueilli des données sur le terrain dans les tourbières forestières de la Côte-Nord du Québec, où leurs caractéristiques sont encore peu documentées. Jusqu'à présent, les données d'inventaires forestiers, comparées à une cartographie existante des tourbières forestières, suggèrent une sous-estimation de leur étendue ainsi qu’une confusion avec d’autres milieux humides dotés d’un couvert forestier dense, comme les marécages. Ces observations sont considérées dans le développement du modèle prédictif et pourraient permettre de mieux évaluer l’étendue des tourbières forestières ainsi que l'importance de leur réservoir de carbone. Nos résultats contribueront à éclairer les futures politiques de conservation concernant ces milieux souvent négligés.
Mots-clés: Tourbières forestières, cycle du carbone, cartographie, forêt boréale
Étienne Morissette
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Olivier Villemaire-Côté (Université Laval)
- Christian Messier (UQO-UQAM)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les forêts canadiennes sont immensément importantes, fournissant une grande variété de services écosystémiques. Toutefois, il est anticipé que les changements globaux modifieront considérablement les régimes de perturbations auxquelles elles sont exposées, ce qui pourrait engendrer une forte mortalité et des échecs de régénération. De plus, ces forêts font l’objet depuis longtemps d’aménagements forestiers qui peuvent agir de façon interactive avec les perturbations naturelles et fortement influencer les écosystèmes. Bien que de nombreuses études se soient attardées à contraster les effets des perturbations naturelles et anthropiques en forêt boréale et boréale mixte, peu se sont intéressées à l’angle de la diversité taxonomique et fonctionnelle des arbres. J’évaluerai donc celle-ci à l’aide des placettes-échantillon permanentes québécoises au cours des 50 dernières années, et l’utilisation conjointe de ces deux facettes de la diversité permettra de mieux comprendre les phénomènes en jeu.
Les traits fonctionnels retenus seront sélectionnés en fonction de leur influence sur la résistance des arbres face aux perturbations historiques et futures de la région, ainsi que sur leur capacité de régénération à la suite de ces évènements. Cette approche permettra également d’évaluer l’évolution de la redondance fonctionnelle de ces peuplements forestiers, une métrique particulièrement pertinente compte tenu de son lien théorique avec la résilience des écosystèmes forestiers.
Mots-clés: Perturbations, changements globaux, diversité taxonomique, diversité fonctionnelle, écologie forestière
Noé Moroy
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Adam Ali (Université de Montpellier)
- Hugo Asselin (UQAT)
- Dorian Gaboriau (UQAT)
- Martin-Philippe Girardin (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les processus d'ouverture des paysages forestiers boréaux sont principalement contrôlés par l'interaction complexe entre le climat, les feux de forêt et la végétation. Face aux changements climatiques actuels, ces phénomènes d'ouverture sont susceptibles de s'intensifier avec le temps, créant des enjeux complexes quant à la gestion durable de ces écosystèmes. Afin de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à ces transformations et leurs trajectoires possibles, une étude chronologique sur des séquences de sédiments lacustres est réalisée sur l'évolution temporelle dans le secteur du réservoir Caniapiscau au cours de l'Holocène en suivant un gradient topographique allant de la forêt commerciale à la toundra forestière. Ce gradient comprend six lacs situés dans deux types d'écosystèmes forestiers distincts : les pessières à mousses (milieux fermés) et les pessières à lichens (milieux ouverts), considérés comme deux états d'équilibre alternatifs. Les utilisateurs des forêts et les autorités s'inquiètent quant à l’impacts potentiels de cette déforestation, qui pourrait modifier la structure et la composition des paysages, altérer la biodiversité boréale, et réduire les surfaces exploitables. Cette étude s’articule autour de plusieurs objectif : (1) Analyser la dynamique temporelle des feux à l’échelle locale et régionale dans la zone d’étude durant l’Holocène. Une analyse approfondie du nombre et de la surface des restes carbonisés présents dans l’ensemble des séquences prélevées sera menée. (2) Reconstituer l’évolution temporelle de la couverture végétale à travers une analyses palynologiques. (3) Réaliser une reconstitution paléoclimatique de la zone d’étude en analysant les rests de chironomides. L’objectif générale de ce projet de recherche vise à caractériser l’ouverture des paysages à l'interface entre la toundra forestière et la forêt commerciale actuelle, afin d'analyser l'évolution du climat, des feux de forêt et de la composition végétale au cours de l'Holocène, et de comprendre leur interaction ayant conduit à la réduction de la couverture végétale dans cette zone.
Mots-clés: Forêt boréale, Changement climatique, Régimes de feux, Végétation, Sédiments lacustres, Analyse multimarqueurs
Catherine Beaulieu
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Autres auteurs
- Alexandre Morin-Bernard (Université Laval)
- Nicholas Coops (UBC)
- Steeve Coté (Université Laval)
- Alexis Achim (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
La biomasse de lichens est un élément clé des habitats hivernaux du caribou boréal, car elle constitue son principal aliment pendant une saison critique où la couverture neigeuse limite l'accès à la nourriture. Une planification efficace de la conservation de cette espèce menacée nécessite des cartes précises de la biomasse lichénique. Les approches précédentes d'estimation de la biomasse lichénique par télédétection ont montré leurs limites dans des paysages hétérogènes comme celui de Terre-Neuve, où coexistent à la fois des forêts à couvert fermé et des habitats ouverts.
Cette étude a utilisé des modèles linéaires généralisés (GLM) pour estimer la biomasse des lichens dans les aires de répartition annuelles du caribou boréal de Terre-Neuve. À partir d'une série d’images Landsat couvrant la période de 1984 à 2022, nous avons extrait des bandes spectrales (ex. : vert, SWIR) et des indices dérivés (ex. : TCW, NDWI) pour développer des modèles spécifiques à chaque classe de végétation définie selon le Système national de surveillance des écosystèmes terrestres (NTEMS). Les modèles ont été calibrés et validés à l'aide de données de terrain sur le volume de lichen collectées dans les différentes classes de végétation.
Nos résultats montrent que les GLM permettent d'estimer la biomasse des lichens avec une précision satisfaisante, les prédictions étant en accord avec les observations de terrain. De plus, cette approche a permis de cartographier l’évolution spatio-temporelle de la biomasse lichénique sur près de quatre décennies, offrant ainsi un outil précieux pour identifier les habitats d’hiver essentiels du caribou et suivre les tendances de disponibilité du lichen au fil du temps. Ces informations sont essentielles pour orienter les stratégies de conservation et adapter la gestion des habitats du caribou boréal.
Mots-clés: Télédétection, Lichen, Caribou boréal, Conservation
Mahsa Mozaffari
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Autres auteurs
- Osvaldo Valeria (UQAT)
- Jean-Daniel Sylvain (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF)))
- Maxence Martin (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Soils play a crucial role in agriculture, forestry, and environmental planning, providing essential ecosystem services. However, existing soil maps often lack the spatial resolution needed for local applications, limiting their effectiveness in supporting informed decision-making. Digital Soil Mapping (DSM) uses remote sensing, climate, and topographic data to model soil properties. Large-scale DSM products provide broad spatial coverage but typically rely on low to moderate-resolution data, which limits their effectiveness for local applications. In contrast, local-scale models based on high-resolution data capture fine-scale variability but may lack generalizability. A hierarchical approach integrating large-scale predictions with high-resolution data in a local-scale model offers a promising solution to the limitations of the previous two model types. This study aims to evaluate how high-resolution remote sensing data contribute to soil texture predictions and to assess whether integrating SIIGSOL predictions improves model accuracy. To achieve this, we integrate Sentinel-1 (radar), Sentinel-2 (optical), and LiDAR-derived terrain indices with soil texture predictions from SIIGSOL, a 100m resolution digital soil mapping system for Quebec, Canada. The analysis focuses on a single depth level in three study areas in Quebec. The study areas were chosen for their diverse soil and geological characteristics, providing the necessary range of conditions to evaluate the methodology effectively. A Random Forest model is used to predict soil texture, first based solely on high-resolution remote sensing data, and then incorporating the SIIGSOL map to assess the benefits of integrating large-scale soil predictions within a local modeling framework. Preliminary results indicate that integrating high-resolution remote sensing data with SIIGSOL predictions enhances the accuracy of soil texture predictions. These findings suggest that multi-scale data integration will enhance land management measures, contributing to sustainable development and environmental planning in Quebec.
Mots-clés: Digital Soil Mapping, Remote Sensing, Soil Texture, LiDAR, Random Forest
Cyprien Nicolleau-Perkisn
Étudiant.e au baccalauréat
UQAR
Autres auteurs
- Guillaume de Lafontaine (UQAR)
- Pierre Grondin (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les charbons de bois enfouis dans le sol permettent d’identifier les essences forestières passées et de reconstruire l’historique des feux. La cédrière à sapin baumier du Lac-des-Baies, un assemblage forestier ancien du Bas-Saint-Laurent, s’est développée naturellement depuis plus de deux siècles en l’absence de perturbations majeures. Ce site exceptionnel, où dominent le thuya occidental, l’épinette noire, le sapin baumier et le pin blanc s’est établi après un feu datant de plus de 250 ans. Comprendre la dynamique de succession de cette forêt pourrait permettre d’évaluer l’impact de la rareté des cycles de feux et des changements environnementaux sur la persistance des forêts conifériennes du Bas-Saint-Laurent.
Pour ce faire, un transect de 50 m a été établi sur le site, où 10 échantillons de sol (750 cm³) ont été prélevés tous les 5 m à partir de la couche minérale. Après un traitement au NaOH (1 %), les charbons ont été extraits par flottaison, tamisés sous eau courante (2 et 4 mm), triés sous binoculaire et identifiés selon leurs caractéristiques anatomiques. Certains fragments ont été soumis à une datation par radiocarbone (C14) afin d’établir une chronologie des incendies et de reconstituer la succession des espèces.
Les résultats attendus permettront de mieux comprendre les processus ayant conduit à l’établissement de cette forêt et les conditions nécessaires à sa persistance, contribuant ainsi à l’étude des dynamiques forestières et au développement de stratégies de conservation adaptées aux forêts du Québec. En identifiant les conditions propices au maintien de ces écosystèmes anciens, cette recherche pourrait également mettre en valeur les efforts de restauration et d’aménagement durable des forêts boréales.
Mots-clés: Thuja occidentalis, histoire des feux, Holocène, forêt boréale, charbon de bois
Collins Ashianga Orlando
Étudiant.e à la maîtrise
UQAR
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les plantations d’épinette blanche (Picea glauca [Moench] Voss) jouent un rôle clé dans la gestion des forêts du Québec. Il est important d’optimiser les scénarios sylvicoles afin de maximiser les rendements économiques, tout en assurant une production continue de bois et en favorisant la séquestration du carbone et l’atténuation des impacts des changements climatiques. Toutefois, la prise de décision peut être limitée par l’absence d’outils intégrant une évaluation économique à l’estimation du rendement ligneux des scénarios. Notre projet a pour objectif de développer un module économique pour le simulateur de Croissance des Épinettes en Plantation (CEP), afin d’évaluer la rentabilité financière de différents scénarios sylvicoles, en intégrant les revenus du bois et des crédits de carbone. Ce projet vise à comparer différents scénarios sylvicoles en examinant les types et intensités d’éclaircies. Il analyse leurs impacts sur les propriétés du bois, comme la densité et sur la croissance des épinettes blanches, afin d’évaluer les différences entre les scénarios en termes d’accumulation de biomasse et de stockage du carbone. Une analyse financière comparera les principaux indicateurs économiques - valeur actualisée nette (VAN), taux de rendement interne (TRI), et rapport bénéfices-coûts - entre les scénarios étudiés. Nos résultats contribueront au développement et à l'intégration d'un module économique dans le simulateur CEP, afin d'évaluer la rentabilité financière de différents scénarios d'éclaircie commerciale. À l'aide de modèles de croissance et d'analyses économiques, cette approche permettra de déterminer les stratégies optimales pour maximiser la viabilité économique de ces plantations.
Mots-clés: Picea glauca, scénarios sylvicoles, séquestration du carbone, économie forestière, simulateur CEP, Bas-Saint-Laurent
Lydia Ouellet
Étudiant.e à la maîtrise
UQAC
Autres auteurs
- Charles Marty (UQAC)
- Victor Danneyrolles (UQAC)
- Patrick Faubert (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
La récente augmentation des incendies s’inscrit dans un contexte où les jeunes forêts sont prépondérantes dans de nombreux territoires du Québec, conséquence directe de l’exploitation forestière des dernières décennies. La succession de ces perturbations (coupes et feux) sur des courts laps de temps augmente ainsi le risque d'échec de la régénération. Dans ce contexte, la plantation d'arbres devient une solution inévitable pour assurer le maintien des écosystèmes forestiers. Cependant, il existe un risque que les plantations soient également affectées par les feux, et il s’avère donc essentiel de comprendre l’impact des feux de forêt sur la régénération des plantations boréales. En 2023, près de 80 000 hectares de plantations ont été touchés au Québec. Parmi cette superficie brûlée, deux jeunes plantations de pin gris et d’épinette noire (âgés de 13 et de 22 ans) étudiées et suivies par l’infrastructure de recherche Carbone Boréal ont été affectées, ce qui offre une occasion unique d’étudier les impacts des feux sur les plantations boréales. Notre projet vise donc à analyser deux aspects essentiels : l’impact des feux sur la régénération naturelle des jeunes plantations et sur la composition de la communauté végétale du sous-étage. On prévoit que les plantations de pin gris, espèce qui atteint très rapidement la maturité sexuelle, régénèrent mieux que les plantations d’épinette noire. On prévoit également que la sévérité des feux influence la régénération des plantations puisque des feux très sévères pourraient réduire la quantité et la viabilité des semences. Nous prévoyons finalement que la vitesse de recolonisation soit plus grande pour les plantes clonales par rapport aux autres espèces de sous-bois. Les retombées de notre projet contribueront à une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents à la régénération naturelle des plantations et permettront d’anticiper plus efficacement les échecs de régénération face à l’augmentation de la fréquence des incendies.
Mots-clés: Feux de forêt, plantations, régénération naturelle, scarifiage, dénudés secs, forêt boréale
Malek Ouichka
Étudiant.e à la maîtrise
UQAC
Autres auteurs
- Julie Élize Guérin (Rio Tinto)
- Marie Cote (Rio Tinto)
- Sergio Rossi (UQAC)
- Véronique Savard (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
La restauration écologique des sites de disposition impactés par l’enfouissement des résidus de bauxite, un sous-produit de la production d'aluminium, vise à neutraliser l'alcalinité élevée de ces résidus empêchant la croissance des plantes, afin de revitaliser les sites dégradés.
Dans le cadre de ce projet, une approche innovante d'économie circulaire est utilisée pour développer un substrat à base de résidu de bauxite en utilisant des déchets provenant d'autres productions industrielles régionales. En effet, un flux de rejet acide provenant d’une mine de niobium est utilisé pour neutraliser les résidus alcalins, tandis qu'un déchet de l'industrie papetière est ajouté pour enrichir le substrat en matière organique essentielle à la revitalisation des sols.
L’objectif du projet est d’évaluer l'efficacité du rejet acide pour neutraliser les résidus de bauxite en mesurant des paramètres tels que le pH, la conductivité et la concentration de différents contaminants. Les réactions chimiques mises en jeu lors de la neutralisation seront ensuite identifiées à l’aide d’analyses chimiques du terreau et de son lixiviat. Finalement, l’effet du rejet acide sur la croissance des plantes sera étudié.
Des résultats préliminaires seront présentés sur le meilleur ratio résidu de bauxite : rejet acide permettant de réduire l'alcalinité du mélange et d'atteindre un pH optimal (pH?8) pour la croissance des plantes. Les résultats des tests préliminaires de germination des semences seront également présentés.
Ces premiers résultats constituent un point de départ prometteur pour nos recherches futures et ouvrent des voies pour créer des substrats propices à la croissance des plantes pour la restauration écologique des sites de disposition de résidus de bauxite.
Mots-clés: Résidu de bauxite, site de disposition, neutralisation, économie circulaire
Nicolas Perrault
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Autres auteurs
- Émilie Champagne (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Mathieu Bouchard (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les arbres morts et les débris ligneux grossiers tombés au sol représentent des habitats essentiels pour une grande diversité d’organismes, dits saproxyliques, qui participent au recyclage des nutriments et occupent une part importante du réseau trophique des forêts. Ce projet vise à comprendre les effets du climat, de l’espèce d’arbre hôte et de l’interaction entre ces deux facteurs sur les coléoptères saproxyliques. Pour étudier la composition de ces communautés associées aux bois mort de gros diamètre, des bûches d’épinette noire, de pin blanc, de pruche du Canada et de sapin baumier ont été placées le long d’un gradient climatique, allant du 45°N au 52°N dans la province de Québec. Après deux années sur le terrain, les bûches ont été installées dans des dispositifs d’émergence afin d’identifier les communautés ayant colonisé le bois mort. Au total, 20 240 spécimens de coléoptères ont émergé des bûches du dispositif et 14 343 spécimens appartenant à 101 espèces furent identifiés. Parmi celles-ci, 35 espèces provenaient exclusivement de l’épinette, 15 du sapin baumier, 22 du pin et 2 de la pruche. Seulement 27% des espèces étaient associées à plus d’une espèce d’arbre. Au niveau du climat, 33 espèces étaient uniques aux sites expérimentaux du sud (46.11 ± 0.33°N), 22 aux sites du centre (48.11 ± 0.36°N) et 14 aux sites du nord (51.46 ± 0.21°N). Les résultats indiquent que l’espèce d’arbre et le climat influencent fortement ces communautés d’insectes, et qu’ils devraient donc être pris en compte dans la mise en place de pratiques forestières visant à conserver la biodiversité dans un contexte de changements climatiques.
Mots-clés: Climat, biodiversité, insectes, débris ligneux, aménagement écosystémique
Clémence Pierrard
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Geneviève Lajoie (INRS)
- Maxence Martin (UQAT)
- Yves Bergeron (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les changements climatiques imposent des pressions croissantes sur les écosystèmes forestiers, obligeant les espèces végétales à s’adapter, migrer ou décliner face aux altérations rapides de leur niche climatique. Si de nombreuses études se concentrent sur la capacité des arbres à suivre leur niche climatique à travers la migration des populations, le rôle des facteurs édaphiques, en particulier les interactions avec les communautés microbiennes et mycorhiziennes, demeure largement méconnu dans le processus d’établissement des semis.
Ce projet de thèse explore ces dynamiques à travers trois chapitres :
1. Détermination des facteurs abiotiques et biotiques qui limitent l’établissement de l’érable rouge hors de son aire de répartition.
2. Étude des paramètres qui influencent la formation et l’efficacité d’une symbiose mycorhizienne qui limitent l’aire de répartition de l’espèce (érable à sucre, érable rouge ou bouleau jaune) qui la réalise.
3. Mise en évidence des micro-organismes présents chez l’érable rouge et du bouleau jaune qui facilitent l’établissement de l’érable à sucre à la limite de son aire de répartition.
En combinant une approche écophysiologique et microbiologique, cette étude contribue à une meilleure compréhension des mécanismes déterminants dans la migration des populations marginales d’érable rouge, d’érable à sucre et de bouleau jaune face aux changements climatiques, en mettant en évidence le rôle souvent négligé des interactions plantes-sol.
Mots-clés: Changements climatiques ; Migration ; Aire de répartition ; Association mycorhizienne ; Etablissement ; Acer saccharum ; Acer rubrum ; Betula Betula alleghaniensis
Vanessa Poirier
Étudiant.e au doctorat
UQAM
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les arbres urbains fournissent des services écosystémiques essentiels face aux changements climatiques. Cependant, ces services dépendent de la taille, de l’état de santé et de l’espèce des arbres. Toutefois, les inventaires réalisés par les villes utilisent généralement des relevés de terrain, une méthode chronophage et coûteuse. Par conséquent, de nombreuses villes disposent d’inventaires incomplets ou obsolètes. Les technologies de télédétection peuvent offrir une solution à ce problème en capturant la localisation et la structure des arbres, facilitant ainsi l’inventaire des forêts urbaines. Grâce à une collaboration avec la compagnie Jakarto, qui utilise le LiDAR monté sur des véhicules pour cartographier les villes en 3D, nous avons obtenu plus de 10 000 scans d'arbres provenant de Montréal, Laval, Trois-Rivières et Québec. À partir de ces nuages de points, nous avons extrait 61 variables, incluant des mesures d’intensité des retours laser, la distribution des points, ainsi que des caractéristiques structurelles issues des modèles structurels quantitatifs (QSM), permettant de quantifier la forme de la couronne par rapport au tronc, et l’angle et la distribution des branches. Ces variables ont ensuite été intégrées à un modèle de classification Random Forest pour distinguer 16 espèces/genres et 5 groupes fonctionnels dominants dans les milieux urbains québécois. Les groupes fonctionnels, qui distinguent les arbres selon leurs stratégies fondamentales, sont utilisés par les gestionnaires pour augmenter la résilience de la forêt urbaine et nous pensons qu’ils présentent des caractères communs reconnaissables par l’IA. Les résultats préliminaires montrent une classification prometteuse d’au moins un groupe, et le modèle sera optimisé davantage à l’aide de l’apprentissage profond. L’intégration des données LiDAR à un tel modèle permettra aux gestionnaires municipaux de mieux quantifier leurs forêts urbaines, d’identifier les groupes d’arbres sur- ou sous-représentés et ainsi de favoriser des forêts diversifiées et résilientes face aux changements climatiques.
Mots-clés: forêt urbaine, arbres urbains, télédétection, LiDAR, machine learning
David Querry
Étudiant.e à la maîtrise
UQAR
Autres auteurs
- Dominique Arseneault (UQAR)
- Étienne Boucher (UQAM)
- Fabio Gennaretti (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
La structure, la composition et la dynamique des forêts sont influencées par les perturbations comme les incendies forestiers. La plupart des forêts subissent des perturbations récurrentes et leur capacité à se rétablir dépend de plusieurs facteurs, comme leur potentiel de régénération et les conditions climatiques. Mon projet étudie le mauvais rétablissement après-feu des forêts lors des périodes froides du dernier millénaire dans le nord de la forêt boréale au Québec. Notre hypothèse principale est que l’ouverture des forêts a été favorisé lors les périodes climatiques avec une somme thermique sous 800 degrés-jour de croissance, le seuil qui permet la maturation des graines dans les cônes d’épinette noire. Étant donné que le climat des deux derniers millénaires s’est continuellement refroidi avant le début du XXe siècle, nous posons l’hypothèse que plus le dernier feu est ancien, moins la forêt est ouverte pour une même position topographique. Selon les observations faites sur le terrain, nous avons de bonnes raisons de croire que le phénomène d’ouverture du paysage est récent (moins de 500 ans) dans la région de Caniapiscau. Avec ce projet sous la direction de Dominique Arseneault (UQÀR), avec la collaboration d'Étienne Boucher (UQÀM) et de Fabio Gennaretti (UQÀT), j’espère améliorer nos connaissances sur le rôle du climat dans la dynamique d’ouverture du paysage boréal par le feu.
Mots-clés: forêt boréale, feux, régénération, épinette noire
Diary Orimbato Rabearimanana
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les exploitations minières perturbent la biodiversité et les écosystèmes forestiers boréaux. L’empreinte minière s’étend au-delà des limites du site à travers les dépôts de poussières provenant du site, l’ouverture du paysage et les modifications des patrons de drainage associées aux différents aménagements. Les travaux antérieurs ont observé des diminutions de la diversité et de la composition des communautés de sous-bois et des accumulations des métaux lourds dans les zones périphériques des sites miniers, ainsi que l’importance du stade d’exploitation sur l’empreinte minière. Les sites miniers fermés présentaient des empreintes réduites par rapport aux sites en exploitation. Cependant, la variabilité de l’empreinte minière en fonction des différents scénarios post-exploitation reste à approfondir, surtout avec les enjeux de restauration des parcs à résidus et de l’abondance des sites non restaurés dans le paysage boréal de l’Abitibi-Témiscamingue, qui est l’une des principales régions minières du Québec. L’objectif principal de cette étude est d’analyser l’influence des stratégies de restauration des parcs à résidus sur l’empreinte minière (hors site) en quantifiant la richesse spécifique et le recouvrement en bryophytes terricoles, le recouvrement en lichens et les concentrations en métaux dans les bryophytes et dans le sol. La collecte des données a été effectué autours de 13 parcs à résidus présentant différentes caractéristiques de restauration (ex : restaurés ou non, méthodes de contrôle du drainage minier acide variées) dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Des modèles statistiques permettront d’analyser les variabilités entre les sites restaurés et non restaurés ainsi qu’entre les différents types de restaurations, et ce, en fonction de différents paramètres comme la méthode de restauration appliquée, la topographie et structure des parcs, la distance au site, ainsi que le type de peuplement dans le paysage hors site. Cette étude permettra d’améliorer les connaissances sur les pratiques minières et leurs impacts sur les écosystèmes forestiers boréaux.
Mots-clés: Biodiversité, Empreinte, Restauration, Parcs à Résidus, Mine
Félicia Beaulieu
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Marc Mazerolle (Université Laval)
- Geneviève Bourget (Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les populations de tortue des bois (Glyptemys insculpta) connaissent un déclin marqué sur l’ensemble de l’aire de répartition. L’espèce est désignée comme espèce vulnérable au Québec et menacée au Canada. Plusieurs mesures de conservation ont été mises en place au cours de la dernière décennie pour contrer cette tendance. L’une de ces approches consiste à élever des juvéniles en captivité et à les réintroduire dans les populations naturelles. Une telle approche a été réalisée par le Ministère de l’environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs (MELCCFP) au Témiscouata. Ces efforts ont permis d’intégrer 298 juvéniles à la population depuis 2013. Pour y arriver, le MELCCFP a effectué des inventaires, permettant le marquage de 117 individus et la pose de 85 radio-émetteurs. Le suivi des femelles a permis de localiser leurs nids et de récolter les œufs qui ont été incubés. Les jeunes ont été élevés en captivité au Biodôme de Montréal durant une ou deux années avant d’être remis en liberté au Témiscouata. Notre étude vise à évaluer la probabilité de survie des individus élevés en captivité et relâchés dans la population en comparaison à la survie des individus sauvages. L’analyse de capture-marquage-recapture indique que les tortues élevées pendant 1 an ont une probabilité de survie de 0,93 (IC 95 % [0,83-1,00]), relativement plus faible que les tortues élevées 2 ans avant la remise en liberté (0,98; IC 95 % : [0,92-1,00]) En comparaison, les probabilités de survie des tortues sauvages immature et mature sexuellement sont respectivement de 0,96 (IC 95 % [0,90-1,00]) et de 0,99 (IC 95 % [0,95-1,00]). Afin d’améliorer ces estimations, nous prévoyons intégrer des variables morphométriques ainsi que des données provenant d’autres populations de tortues au Québec.
Mots-clés: Tortues des bois, réintroduction, conservation, capture-marquage-recapture, inférence bayésienne
Ravosoa Tianarinoro Ramaroson
Étudiant.e à la maîtrise
Université Laval
Autres auteurs
- Ian Major (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
- Ilga Porth (Université Laval)
- Sivajanani Sivarajah (Université Laval)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les travaux de construction en milieu urbain impliquent souvent les coupes des racines des arbres, pouvant compromettre leur stabilité et perturber leurs processus écophysiologiques. Bien que des directives existent pour délimiter les zones de protection des arbres pendant les travaux, les impacts des tranchées sur la physiologie des arbres demeurent peu documentés pour assurer leur préservation. Cette étude avait pour objectif de quantifier les réponses écophysiologiques de deux espèces d'arbres, Tilia cordata et Acer platanoides, après des coupes racinaires, dans six parcs municipaux de la ville de Québec. Les arbres ont été soumis à divers traitements de tranchées, appliqués à différents niveaux de sévérité en fonction de la distance par rapport au tronc, du nombre de tranchées et de leur disposition. Le même nombre d’arbres à racines intactes ont servi de témoins. Les échanges gazeux, la fluorescence chlorophyllienne et le potentiel hydrique avant l’aube ont été mesurés sur les feuilles à l’aide d’un système de photosynthèse portable et d’une chambre de pression de type Scholander. Parallèlement, les traits foliaires ont été évalués, dont la surface foliaire spécifique, la teneur en matière sèche de la feuille, la densité foliaire fraiche et la densité stomatique. L’analyse préliminaire révèle un effet significatif de l’espèce, suggérant une variation marquée de la conductance stomatique entre les deux espèces étudiées. Des analyses complémentaires sont en cours afin d’affiner le modèle et d’évaluer l’effet des traitements sur les variables clés de la photosynthèse. Ces résultats permettront de définir les niveaux de stress que les arbres pourraient tolérer et de suggérer des recommandations pratiques pour la gestion des arbres en milieu urbain, notamment lors des travaux d'excavation.
Mots-clés: foresterie urbaine, dommages racinaires, photosynthèse, stress hydrique
Rindra Fanomezana Ranaivomanana
Étudiant.e au doctorat
UQAM
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les épidémies de tordeuses des bourgeons de l'épinette (Choristoneura fumiferana Clem., TBE) sont l'une des perturbations naturelles les plus courantes au Québec avec des millions d'hectares de forêts défoliées. La défoliation des hôtes peut conduire à la mortalité du sapin baumier et, dans une moindre mesure, des épinettes blanches et noires, entraînant d'importantes conséquences écologiques et économiques. Le changement climatique pourrait accroître la durée et la sévérité des épidémies et favoriser une extension des défoliations sévères vers le nord. Cependant, peu d’études ont exploré comment ces impacts potentiellement sévères seront atténués ou amplifiés par les interactions avec d’autres types de perturbations telles que la récolte ou les feux. L'objectif de cette étude est d'évaluer comment le changement climatique affectera les épidémies en utilisant le Quebec Landscape Dynamic Model (QLDM), un modèle spatial basé sur des processus simulant la dynamique de la végétation avec des perturbations (feux et récoltes). Pour intégrer les épidémies de TBE dans le modèle, nous développons une fonction permettant de simuler la mortalité des hôtes en fonction des caractéristiques du peuplement et de son voisinage ainsi que des variables environnementales (y compris le climat). Pour examiner les interactions entre les scénarios climatiques, la vulnérabilité des hôtes et les régimes de perturbations, nous considérons (1) deux scénarios de mortalité de l'épinette noire : sévère et non sévère, (2) trois scénarios climatiques (2020-2100) basés sur les trajectoires socioéconomiques partagées (SSP1-2.6, SSP2-4.5 et SSP5-8.5) et (3) trois perturbations : épidémies de TBE, feux et récoltes pour un total de 18 scénarios de simulation. Avec cette approche, nous prévoyons que même si une hypothèse sur le déplacement vers le nord des épidémies a été émise, nous anticipons des variations dans les schémas de mortalité dues aux interactions entre les perturbations et la présence des hôtes.
Mots-clés: tordeuse des bourgeons de l'épinette, modélisation, changement climatique, mortalité
Gabriela Rincón Pinilla
Étudiant.e à la maîtrise
UQAR
Autres auteurs
- Guillaume de Lafontaine (UQAR)
- Luc Sirois (UQAR)
- Étienne Léveillé-Bourret (Université de Montréal)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les saules (Salix spp.) constituent un groupe très diversifié dont l'évolution a été fortement liée à l'hybridation. Par exemple, on pense actuellement que le saule à petits fruits (Salix brachycarpa Nutt.) s'hybride avec 10 espèces de saules différentes, une découverte basée sur des caractéristiques morphologiques, mais qui n'a jamais été validée par des données génomiques, à l'exception de son hybridation avec Salix chlorolepis. De plus, des données préliminaires acquises par la Chaire de recherche du Canada en biologie intégrative de la flore nordique suggèrent qu'il pourrait y avoir une différenciation génétique significative entre les populations de S. brachycarpa à travers l'Amérique du Nord. Ces données suggèrent également que l'espèce pourrait avoir acquis sa spécificité génétique locale par hybridation avec d'autres espèces locales, d'une manière similaire à celle attendue dans un syngameon. Le saule à petits fruits est une espèce largement répandue, présente dans tout le Canada et l'ouest des États-Unis, où il est possible de trouver des sites dans lesquels jusqu'à cinq espèces potentiellement capables de s'hybrider peuvent être en contact étroit. En outre, les espèces du genre Salix ont la capacité de se disperser sur de longues distances grâce à l'anémophilie et à l'anémochorie. De nombreux indices pourraient donc suggérer que Salix brachycarpa est susceptible d'être impliquée dans un syngameon, mais cette hypothèse doit encore être formellement testée. Ainsi, bien que reconnue comme une espèce transcontinentale commune, il est possible que la S. brachycarpa « pure » soit en fait plutôt rare. Mon projet vise à décrypter les patrons de diversité génétique et la structure génétique de Salix brachycarpa. Il s'agit plus particulièrement (1) d'évaluer sa structure génétique, (2) d'estimer sa variation génétique au sein des populations et entre elles, ainsi qu'entre congénères hybrides, (3) de tester l'hybridation locale de S. brachycarpa avec des autres espèces de saules et (4) d'évaluer les patrons d'hybridation qui pourraient indiquer l'existence d'un syngameon.
Mots-clés: Saule, syngaméon, génomique des populations
Caroline Rodrigues da Silva
Étudiant.e à la maîtrise
UQAC
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Defoliation by the eastern spruce budworm (SBW) (Choristoneura fumiferana) significantly alters boreal forests, with balsam fir (BF) (Abies balsamea) being the most affected, followed by black spruce (BS) (Picea mariana). These infestations reduce tree transpiration and growth, impacting the carbon cycle and may transforming boreal forests from carbon sinks to sources. However, their long-term effects on tree water absorption and physiological regulation remain understudied. We aim to develop analytical methods to evaluate SBW effects on seasonal cycles of tree transpiration and stem radius variation (SRV) from 2017 to the present. Data were collected from eight trees (four per species) in Monts-Valin National Park (QC, Canada). We employed point dendrometers to monitor SRV, obtain growth indices, and measure seasonal contraction-expansion amplitudes. Additionally, fluxmeters tracked sap flux density and transpiration from spring to autumn. These indices were analyzed alongside cumulative annual SBW-induced defoliation, monitored by the Canadian government, and in situ climate data. We developed a time-series modeling approach to identify annual physiological periods in SRV, distinguishing Winter Dehydration (1), Freezing (2), Spring Rehydration (3), Transpiration and Growth (4) and End of Transpiration and Growth (5). Dendrometer data indicate a negative correlation between the seasonal delta of Winter Dehydration and three other periods (3, 4, and 5), with stronger correlations in BF. We observed that the year following the most severe SBW-induced defoliation had the lowest seasonal delta (i.e., the lowest growth rate) during the 4th period for both species. Meanwhile, for BS, the same year marked an inflection point in the curve’s concavity, suggesting a shift in its physiological response during this period, as revealed by the seasonal delta trend analysis. This research enhances our ability to model boreal forest resilience and ecosystem responses to SBW outbreaks, providing critical insights for Canadian forest management, and a better understanding of defoliation impacts.
Mots-clés: defoliation, eastern spruce budworm, time series, sap flow, stem radius variation, balsam fir, black spruce
Sanjoy Roy
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Autres auteurs
- Evelyne Thiffault (Université Laval)
- Frédérik Doyon (UQO)
- Stéphane Tremblay (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Cette étude vise à comparer la dynamique du carbone forestier à l'échelle du peuplement entre la sylviculture régulière en futaie équienne et la sylviculture en couvert continu irrégulier dans les domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc et de la sapinière à bouleau jaune du Québec, dans un contexte de changements climatiques. Nous calibrons HETEROFOR, un modèle processuel, spatialement explicite et à l’échelle de l’arbre. Ce modèle intègre les principaux processus écophysiologiques des arbres — tels que la photosynthèse, l'évapotranspiration, la phénologie et l'allocation du carbone — qui influencent la dynamique de croissance. Nous avons utilisé 14 parcelles du Réseau de Surveillance des Écosystèmes Forestiers (RESEF) pour calibrer le modèle.Le modèle prédit efficacement la croissance en surface terrière à court terme (10 ans) des conifères (Abies balsamea, Picea glauca et Picea rubens). Pour les feuillus (Betula papyrifera et Betula alleghaniensis), l’ajustement du modèle est modéré et présente une surestimation de la croissance en surface terrière. Des ajustements seront requis aussi pour limiter la croissance des recrues puisque le modèle projette une augmentation de 10 à 80 % de la densité en sapin sur 10 ans par rapport aux données observées. En revanche, Betula papyrifera montre une diminution en densité de 10 à 30 % par rapport aux observations. Toutefois, l’accroissement en surface terrière du peuplement ne présente pas de changement significatif puisque les recrues contribuent peu à celle-ci sur la période de 10 ans. Les prochaines étapes viseront la calibration de la régénération, du recrutement et de la mortalité, ce qui devrait permettre de corriger les problèmes démographiques décelés pour le sapin et le bouleau blanc.
Mots-clés: sylviculture irrégulier, modèle processuel, sapinière à bouleau blanc, dynamique du carbone forestier
Gianluca Segalina
Étudiant.e au doctorat
UQAR
Autres auteurs
- Fiston Nininahazwe (CERFO)
- Anne-Marie Dubois (CERFO)
- Batistin Bour (CERFO)
- Emmanuel Duchateau (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Luc Sirois (UQAR)
- Robert Schneider (UQAR)
- Mathieu Varin (CERFO)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Dans la région du Bas-Saint-Laurent, après la Coupe avec protection de la régénération et du sol (CPRS), la régénération est évaluée par des relevés manuels. Cependant, la régénération est souvent hétérogène, rendant nécessaire une vue d’ensemble des parterres de coupe. Cette étude explore la possibilité d'utiliser des images de drone pour analyser la composition de la régénération.
À cette fin, nous avons survolé par drone 8 parterres de coupe dans la région en mai et en août 2024, en collectant des images multispectrales de haute résolution. Parallèlement, des points d’entraînement ont été relevés au sol à l’aide d’un GPS de haute précision. Nous appliquons actuellement une classification basée sur des objets en testant différents algorithmes. Les résultats, attendus en avril 2025, permettront d'évaluer la précision de cette méthode et d'identifier les défis liés à son application.
Mots-clés: Images multispectrales, CPRS, télédétection, régénération
Barry Levi Shaw
Étudiant.e à la maîtrise
UNB
Autres auteurs
- Haley Elizabeth Magee (UNB)
- Nelson Thiffault (RNCan-Centre canadien sur la fibre de bois)
- Rafaella Mayrinck (UNB)
- Gaetan Pelletier (Northern Hardwoods Research Institute Inc.)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Forests have long been managed primarily for high-value timber and biomass, reflecting the economic priorities of the forest industry. While these products remain in demand, forestry management priorities are shifting; values associated with forests are evolving toward more culturally focused perspectives. This shift is compounded by a changing climate, which is driving warmer temperatures northward. In New Brunswick, Canada, several economically and culturally significant hardwood species face threats from shifting species ranges and changing forest composition trends. These ecological and societal changes coincide, however, with rapid advancements in forest measurement technologies, such as LiDAR, which provide new opportunities to assess and predict the impacts of forest management on stem and stand attributes in these new contexts. While many studies have documented the effects of thinning intensity on stand responses, few have focused on hardwood-dominated stands. In particular, little is known about the impacts of thinning intensity in sugar maple (Acer saccharum) and birch (Betula spp.)-dominated stands concerning regeneration establishment, growth rates and rotation length, self-pruning and asymmetric growth, and the risk of windthrow. In this study, we will leverage a spacing experiment established in 1979 in a naturally regenerated hardwood-dominated forest to test the effects of precommercial thinning intensity (1.5 m, 2.1 m, and 2.7 m spacing, along with an unthinned control). We will combine high-density LiDAR point-cloud data with traditional forest measurements to evaluate how early density management has influenced stand growth and stem quality, as well as the establishment of a vigorous and diversified regeneration layer.
Mots-clés: LiDAR, Silviculture, Hardwood Management, Thinning, Precommercial Thinning, Tree Architecture
David Simard
Étudiant.e à la maîtrise
UQAC
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Vous seriez étonnés de savoir que les sols stockent environ 85 % du carbone de la forêt boréale et déterminent en partie le potentiel de croissance des forêts. Par ailleurs, les feux de forêt sont une importante cause de perturbation dans la forêt boréale. Ils produisent une grande quantité de gaz à effet de serre, tout en provoquant des modifications dans la structure et les cycles biogéochimiques des sols. En 2023, au Canada, c’est environ 15 millions d’hectares de forêt qui ont été brûlés à différentes sévérités, avec des émissions de carbone comparables à celles produites par l’énergie de sources fossiles de la Russie et de l’Inde. Cette occurrence de feux sera de plus en plus fréquente et les effets de la sévérité (changement apporté par le feu) sur le sol sont peu documentés. L’objectif de cette étude est de déterminer l’impact des feux sur les stocks et la dynamique du carbone et de l’azote du sol en plantation de forêt boréale. Situé au nord de Chibougamau, le dispositif est composé de 24 parcelles affectées par un feu en 2023 à des niveaux de sévérité allant de 0 (non brûlée) à 3 (sévère). Des échantillons de sols organiques et minéraux ont été prélevés en 2024 pour mesurer 1) les pertes de carbone et d’azote en comparant avec des échantillons de 2021; 2) l’impact du feu sur la minéralisation et la sensibilité à la température (Q10) du carbone et de l’azote organique du sol; et 3) la proportion de carbone associée aux fractions organiques particulaire (POM), minérale (MAOM) et pyrogénique. Dépendant de la sévérité, les résultats devraient montrer des changements au niveau des stocks, de la stabilité et de la composition du carbone dans le sol et, finalement, permettre d’améliorer notre compréhension de la manière dont les feux affectent les sols.
Mots-clés: Feu de forêt, sévérité, stock, carbone, azote, sol, forêt boréale.
Karan Kumar Singh
Étudiant.e à la maîtrise
UQAC
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Mechanical site preparation (MSP) is a forestry practice that disturbs the forest floor, creating furrows of exposed mineral soil and mounds of organic soil. While MSP enhances forest regeneration by promoting seedling recruitment, survival and growth, its effects on soil carbon dynamics in boreal lichen woodlands (LWs) remain poorly understood. LWs are ecosystems characterized by low soil productivity and sparse tree cover, often due to natural disturbances like wildfires. Understanding how MSP influences soil carbon content, composition, and stability is crucial for estimating the carbon debt associated with soil preparation and thus for accurately assessing the net carbon sequestration potential of afforestation in these ecosystems.
This study investigates the effects of MSP on soil carbon dynamics in LWs of Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada. The study sites, scarified in 2012 and 2020, each consists of three blocks with three plots per block. Soil samples were collected from mounds (M), furrows (F), and inter-furrows (IF). Previous research at these sites found reduced humus-layer carbon in disturbed areas, suggesting losses from surface layers, but the balance between CO2 emissions and transfer to mineral soil remains unclear. To address these fluxes, we will estimate carbon movement through the soil profile using C/N ratios and isotopic compositions (δ13C, δ15N). The stability, the mineralization rate and the temperature sensitivity (Q10) of the soil from the disturbed (M, F) and undisturbed (IF) sections will be evaluated through SOM fractionation (POM and MAOM) and laboratory incubations at 15, 22, and 32°C.
We hypothesize that MSP will promote carbon flux in the mounds and alter microbial decomposition processes, leading to increased respiration and temperature sensitivity in disturbed soils. Results will provide valuable insights into MSP’s impact on soil carbon dynamics and inform sustainable forest management strategies aimed at maximizing carbon sequestration in boreal ecosystems.
Mots-clés: Mechanical site preparation (MSP), soil carbon dynamics, boreal lichen woodlands (LWs), carbon flux and sequestration, soil organic matter (SOM) fractionation
Teodora Stan
Étudiant.e à la maîtrise
UQAM
Autres auteurs
- Daniel Kneeshaw (UQAM)
- François Fabianek (WavX Inc & Groupe Chiroptères du Québec)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les chauves-souris jouent un rôle écologique important en tant qu'espèces bioindicatrices de la santé des écosystèmes forestiers, donnant un indice de la résistance et de la résilience de ces derniers. Malheureusement, elles sont fragilisées par plusieurs menaces (syndrome du museau blanc, perte d'habitat, extermination, etc.). Le bruit provenant du réseau routier, en constant développement, constitue un stress supplémentaire particulièrement nocif. Toutefois, on connaît encore peu l’importance de son impact sur les chauves-souris insectivores dont la survie dépend notamment du paysage sonore.
L’objectif principal de cette recherche est d’identifier quelles caractéristiques de la route ont un impact sur l’activité des chauves-souris insectivores. La région de Pike River (Québec) est l’endroit idéal pour répondre à cette problématique : elle est habitée par plusieurs espèces de chauves-souris et contient des routes fréquentées ainsi qu’une autoroute en construction. Durant trois étés de 2021 à 2023, 15 stations d’enregistrements en lisières boisées ont été installées sur trois sites. 5 stations d’enregistrement le long de l'autoroute en construction (site traitement), 5 le long de routes fréquentées (site traitement) et 5 dans des milieux agricoles-forestiers (site référence). Les stations d’enregistrement des sites traitements étaient placées le long d’un gradient de fréquentations des routes. Ainsi, ces données acoustiques du paysage sonore et des signaux d’écholocalisation des chauves-souris permettront d’observer la résilience d’espèces sensibles aux perturbations de leur écosystème dans un monde en changement.
Mis à part les facteurs qui influencent généralement la présence des chauves-souris, comme la présence de l’eau et du couvert forestier, les résultats suggèrent de fortes corrélations positives entre l'activité nocturne des chauves-souris et la distance à la route ainsi qu’une corrélation négative avec le niveau de bruit.
L’étude contribuera à l’avancement des connaissances sur les effets du développement routier sur les chauves-souris insectivores et leur écosystème pour mieux diriger les efforts de conservation.
Mots-clés: Écosystème, Anthropisation, Chauves-souris, Bioacoustique, Pollution sonore, Corridor de transport, Fragmentation d'habitat
Audrey Bédard
Étudiant.e à la maîtrise
UQAM
Autres auteurs
- Catherine Périé (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Morgane Urli (UQAM)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Lors d'une sécheresse sévère, la cavitation entraîne l’embolie des conduits hydrauliques en raison de potentiels hydriques (Ψ) très négatifs, obstruant le transport de la sève et contribuant à la mortalité des arbres. Il est crucial d’évaluer leur sensibilité à la cavitation afin d’estimer leur risque de dépérissement et d’orienter les aménagistes forestiers vers l’utilisation d’espèces plus résistantes à ce phénomène. Les méthodes actuelles d’estimation de cette sensibilité via le pourcentage de perte de conductivité hydraulique (PLC) sont coûteuses et complexes, justifiant la nécessité d’alternatives plus accessibles. Chez les conifères, le Ψ induisant 25% (P25w) de la perte du contenu en eau des tissus (RWL), facilement mesurable, pourrait constituer un proxy pertinent du Ψ induisant 50% de PLC (P50). Ce projet teste cette hypothèse chez trois conifères d’importance écologique et économique du Québec : pin blanc, épinette blanche et épinette noire. Les objectifs spécifiques sont de mesurer leur P50 en établissant la relation entre la PLC et le Ψ, leur P25w en établissant la relation entre la RWL et le Ψ, ainsi que celle entre la P50 et le P25w des tiges, relation jamais établie pour ces espèces. 10 semis par espèce ont été soumis à une sécheresse par déshydratation sur paillasse. Ψ, PLC et RWL ont été mesurés à différents stades de sécheresse à l’aide respectivement d’une chambre à pression, d’un débitmètre et de pesées. Les résultats montrent que plus le Ψ diminue, plus le RWL et la PLC augmentent, et donc plus le RWL augmente, plus la PLC augmente également. Cette expérience préliminaire s’inscrit dans mon projet de maîtrise, une expérimentation sur 100 semis par espèce qui aura lieu à l’été 2025 pour augmenter l’effort d’échantillonnage et explorer si le contenu en eau d’autres organes peut estimer d’autres traits physiologiques liés aux stratégies d’adaptation des arbres à la sécheresse.
Mots-clés: Conifères, Contenu en eau, Résistance à la sécheresse, Stress hydrique, Traits fonctionnels, Sensibilité à la cavitation
Nesrine Tlili
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Autres auteurs
- Nicole Fenton (UQAT)
- Christine Martineau (Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie des Laurentides (CFL))
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Les modifications dans la composition végétale des écosystèmes, induites par les changements climatiques, sont particulièrement marquées dans le biome boréal. Par ailleurs, l’activité minière, en particulier l’émission de poussières, représente un défi anthropique majeur qui affecte les communautés végétales environnantes. Les mousses jouent un rôle crucial dans l'atténuation du réchauffement climatique en régulant la température et l'humidité du sol. Elles sont également des bioindicateurs pour les polluants tels que les métaux lourds. De plus, les mousses abritent divers microorganismes jouant des rôles clés dans le stockage du carbone et la fixation de l'azote. Cependant, les effets des activités minières sur les interactions entre les mousses et leur microbiote, leurs adaptations géographiques et leurs caractéristiques écologiques restent peu étudiés. Ce projet vise à évaluer les impacts de l'empreinte minière sur l’abondance, la richesse des mousses terricoles, la composition microbienne ainsi que l’accumulation des métaux dans différents dans deux domaines bioclimatiques distincts. Dix sites miniers ont été sélectionnés?: sur la faille de Cadillac (zones du sud) et hors de la faille (zones du Nord). L’objectif de cette étude est d’(1) analyser l’influence de la biogéographie sur l’empreinte spatiale des mines en étudiant l’abondance des mousses terricoles, l’accumulation de métaux chez Pleurozium schreberi et la diversité de son microbiote; (2) étudier l’impact de l’activité minière sur les bactéries diazotrophes associées aux mousses et leur capacité de fixation de l’azote; (3) examiner la réponse photosynthétique et transcriptionnelle des mousses face aux perturbations minières, en identifiant les gènes impliqués dans la réponse aux stress liés à la photosynthèse et la fixation de l’azote. Ce projet vise à approfondir la compréhension de l’évolution des interactions entre les mousses et leur microbiote, en mettant en lumière leurs effets sur la séquestration du carbone et la fixation de l'azote.
Mots-clés: Activité minière, mousses, microbiote, adaptations géographiques, métaux lourds, fixation de l?azote, gènes de réponse aux stress
Sewanou Marc Tovihessi
Étudiant.e au doctorat
UQAT
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h20
L'aménagement écosystémique vise à réduire les écarts entre les paysages aménagés et les paysages naturels en s?inspirant des régimes de perturbations naturelles. Si ses avantages pour la conservation de la biodiversité sont bien établis, son impact sur le bilan carbone des forêts boréales reste incertain. Ce projet de recherche cherche à étudier dans le contexte de l'aménagement écosystémique, le bilan carbone de paysages boréaux historiquement dominés par deux perturbations naturelles différentes : les incendies de forêt et les épidémies de la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE). Nous caractériserons les attributs clés de ces paysages notamment la structure spatiale, la composition en espèces, la structure des classes d'âges, la productivité primaire nette et la biomasse aérienne. Ensuite ces attributs inspireront les stratégies d'aménagement écosystémique susceptibles de les maintenir, qui seront définies et simulées avec l'extension Biomass Harvest sous le modèle paysager LANDIS-II. Enfin, le bilan carbone de la stratégie la plus conservatrice des attributs spécifiques à chaque paysage sera simulé et comparé à ceux de l'approche de conservation des forêts et de l'aménagement classique à l'aide de l'extension Forest Carbon Succession ? ForCS de LANDIS-II. L?objectif est de déterminer si un aménagement inspiré des attributs des paysages historiquement perturbés permet de mieux conserver le stock et la séquestration de carbone par rapport à un scénario de conservation sans exploitation forestière ou à un aménagement classique. Les résultats de cette étude permettront d'orienter les stratégies de gestion durable des forêts boréales en intégrant à la fois la résilience écologique et la séquestration du carbone.
Mots-clés: Aménagement écosystémique, bilan carbone, perturbations naturelles, attributs paysagers, Biomass Harvest, Forest Carbon Succession, LANDIS-II.
Tanjena Khatun Tuli
Étudiant.e au doctorat
UQAM
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Changing temperatures and precipitation patterns due to climate change are intensifying drought-induced plant mortality. Resistance to cavitation is a key indicator of a plant’s drought tolerance. However, how neighborhood community composition (i.e. growing in mixture or monoculture) and historical changes in water availability affect plant cavitation resistance remains poorly understood. In this study, we examined how neighborhood community and historical changes in water availability affect the cavitation resistance of three tree species (Betula papyrifera, Larix laricina, and Pinus strobus) in a tree diversity experiment in Sault Ste. Marie, Ontario. We investigated the influence of monoculture and mixture on cavitation resistance and the species-specific differences in cavitation resistance under historical high versus low water availability. The experimental tree communities were established in monoculture and mixtures of two to six species and experienced high and low water availability treatments from 2014 to 2023. Cavitation resistance was determined on at least 3 trees per combination using the Cavitron method. Our results showed monoculture or mixture did not have any effect on cavitation resistance regardless of the species and water availability treatment combinations. The effect of water availability on cavitation resistance varied across the species with B. papyrifera showing significantly lower P50 (water potential leading 50% embolism) under low water treatment (-1.83 MPa) than under high water treatment (-1.69 MPa) while L. laricina and P. strobus showed no significant variation. This suggests that L. laricina and P. strobus maintained their cavitation resistance despite historical changes in water availability, likely due to their enhanced hydraulic safety. In contrast, while B. papyrifera is sensitive to these changes, it has increased cavitation resistance under water-limited conditions. These findings highlight the importance of considering the long-term water conditions while selecting species as it may affect their resilience to water stress and future droughts.
Mots-clés: Cavitation resistance, drought, community composition, historical water availability,
Ariane Veillette-Lebrasseur
Étudiant.e à la maîtrise
UQO
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu de taille face aux événements météorologiques extrêmes dans les milieux urbains. La canopée des arbres urbains est connue pour avoir un effet sur l’interception des précipitations et contribue ainsi à réduire la quantité d’eau de ruissellement. Or, l’influence des méthodes d’entretien des arbres urbains sur l’interception des précipitations demeure peu connue. Ce projet a pour objectif de comprendre l’influence des techniques de contrôle précoce de la cime sur l’interception des précipitations en milieu urbain pour différentes espèces arbres. Dans le cadre de cette étude, un suivi des précipitations nettes sous la canopée a été fait pour six espèces d’arbres, soit l’érable argenté (Acer saccharinum), le févier d’Amérique (Gleditsia triacanthos var. inermis), le micocoulier occidental (Celtis occidentalis), l’orme « Accolade » (Ulmus japonica x wilsonia «Accolade»), le catalpa de l’Ouest (Catalpa speciosa) et le chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa), au sein d’une plantation expérimentale située à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec). Quatre différents traitements de contrôle de la cime des arbres ont été comparés : l’élagage, le placement d’un bonnet sur la flèche terminale, un tuteur et un témoin. Afin de mesurer les précipitations nettes au sol, des récipients de plastique ont été installés au sol sous la canopée des arbres et pesés après des événements de précipitation d’intensité variable à l’été 2024. Les résultats préliminaires suggèrent que les différentes techniques de contrôle de la cîme ont un effet négligeable sur l’interception des précipitations, nous observons toutefois des taux d’interception variables entre les six espèces à l’étude. Une meilleure quantification de l’interception des précipitations selon différentes espèces d’arbres permettra de guider l’aménagement des infrastructures vertes afin de favoriser l’adaptation des villes face aux événements météorologiques extrêmes.
Mots-clés: Foresterie urbaine, écohydrologie, traits morphologiques
Nickolas Viens
Étudiant.e à la maîtrise
UQO
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Mondialement, 35 % de la surface des milieux humides a été détruit depuis les années 70. Les implications écologiques sont grandes et engendrent des pertes de services écosystémiques offerts par les milieux humides. En parallèle, les besoins en ressource, tels que le bois d’œuvre, augmentent. Malgré une stabilisation de la déforestation en Amérique du Nord, les milieux humides et forêts naturelles sont tout de même à risque d’exploitation. Certaines entreprises privées, comme DOMTAR, démontrent une volonté d’accentuer la durabilité de leurs pratiques. Ainsi, il est pertinent de se questionner sur les solutions qui s’offrent à nous en termes d’optimisation de pratiques sylvicoles, afin de diminuer les impacts sur les milieux naturels. La compagnie forestière DOMTAR emploie une technique de plantation sur monticule (PSM), où l’espèce Populus x canadensis (peuplier hybride) est plantée en monoculture. Ces plantations présentent des caractéristiques cohérentes avec les milieux humides. Cependant, nous avons peu de connaissances sur les processus hydrologiques des dépressions contenant de l’eau retrouvées dans ces plantations. L’objectif de cette étude est de caractériser les processus hydrologiques pouvant mener à la création et au maintien des milieux humides potentiels dans les PSM, ainsi que de caractériser et de comparer la dynamique temporelle des dépressions dans les plantations à celle des milieux humides des forêts feuillues. Durant la saison estivale de 2024, 18 plantations et six forêts feuillues ont été échantillonnées. L'hydropériode est quantifiée par le dénombrement des dépressions remplies d’eau, le suivi de volume et du niveau d’eau. Nous mesurerons et analyserons les déterminants de l’hydropériode (sol, microtopographie et végétation). Ces données permettront de mieux comprendre les déterminants de l'hydropériode et de comparer les plantations aux milieux naturels. Les connaissances acquises pourront approfondir les connaissances portant sur la création et le maintien des milieux humides.
Mots-clés: Peuplier hybride, Milieu humide, Plantation, Microtopographie, Sol, Végétation, Hydrologie, Hydropériode
Élainie Voyer-Leblanc
Étudiant.e à la maîtrise
Université de Montréal
Autres auteurs
- François Girard (Université de Montréal)
- François Hébert (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF))
- Annie Deslauriers (UQAC)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Le Québec plante en moyenne 67 000 hectares de forêts annuellement. Cependant, les scénarios climatiques prévoient des périodes de sécheresses prolongées dans certaines régions du Québec, notamment l’Outaouais, ce qui risque d’accentuer le stress hydrique dans ces écosystèmes. Une solution envisagée pour atténuer ce stress consiste à réduire la densité des peuplements par des éclaircies commerciales. Cette intervention sylvicole permet de diminuer la compétition végétale et de favoriser la croissance des arbres résiduels en augmentant l’accès aux ressources (eau, nutriments, lumière). Toutefois, cette pratique demeure peu courante au Québec, et l’intensité optimale à appliquer reste à déterminer, celle-ci visant à maintenir une croissance radiale adéquate et à produire du bois de qualité. Cette recherche vise ainsi à évaluer comment les différentes intensités d’éclaircie commerciale modulent le stress hydrique dans les plantations de pin gris et d’épinette blanche. Pour ce faire, l’objectif principal est d’analyser les effets saisonniers d’un gradient d’intensité d’éclaircie sur les traits fonctionnels liés à la croissance et aux fonctions hydriques de ces espèces. L’étude est menée dans des plantations monospécifiques de l’Outaouais, où trois intensités d’éclaircie (30 %, 45 %, 60 %) ainsi qu’un témoin seront comparés. Les conditions de stress hydrique seront caractérisées à l’aide de mesures environnementales, tandis que des suivis en temps réel de la croissance radiale et des fonctions hydriques permettront d’évaluer la réponse physiologique des arbres tout au long de la saison de croissance. Ce projet approfondira notre compréhension des réponses physiologiques des arbres au stress hydrique, en mettant en évidence leur capacité d’adaptation aux changements climatiques. Les résultats fourniront des recommandations concrètes pour optimiser les pratiques de gestion forestière au Québec, bénéficiant ainsi aux divers acteurs du secteur. À terme, il contribuera à instaurer des stratégies sylvicoles favorisant la résilience des écosystèmes forestiers tout en améliorant la qualité du bois récolté.
Mots-clés: Changements climatiques, Sylviculture d'adaptation, Plantations, Éclaircie commerciale, Stress hydrique, Réponse physiologique, Fonctions hydriques, Croissance
Amé Bergeron
Étudiant.e à la maîtrise
UQAT
Autres auteurs
- Fabio Gennaretti (UQAT)
- Dominique Arseneault (UQAR)
- Miguel Montoro Girona (UQAT)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
Le grand intérêt commercial pour le pin blanc lors de la colonisation a causé sa surexploitation dans plusieurs régions du Québec, dont le Témiscamingue. Aujourd’hui, ce grand arbre ne se retrouve plus qu’à l’état de relique dans le paysage forestier. Afin de rétablir le pin blanc dans sa variabilité naturelle, il est crucial de comprendre les changements causés par l’exploitation forestière d’autrefois. À cet effet, les vestiges de la drave, ayant sombré au fond des cours d’eau, représentent une source d’information inestimable. Toutefois, le lieu d’extraction d’une bille de bois ne correspond pas forcément au lieu où l’arbre a été coupé. La dendroprovenance, soit l’étude de l’origine géographique du bois, pourrait être un outil efficace afin de retracer le voyage fait par ces billes.Ce projet de recherche a donc pour objectif d’examiner la possibilité de retracer l’origine des billes de pin blanc issues de la drave par la dendroprovenance dans le secteur Kipawa au Témiscamingue. La petite taille de la région d’étude représente un défi d’envergure. En effet, la faible hétérogénéité spatiale limite la résolution de la dendroprovenance. Afin de surmonter cette difficulté, une approche combinant deux indicateurs, soit la largeur des cernes et l’intensité de bleu, est testée. Ces deux indicateurs ont été mesurés sur des échantillons de pin blanc issue de cinq vieux peuplements répartis dans le bassin versant du lac Kipawa. Un modèle d’apprentissage automatique (machine learning) employant le bayésien sera ensuite entraîné, puis testé dans sa capacité d’assignation d’un échantillon au bon site. Cette étude, unique en son genre, repousse les limites de l’analyse du bois. Le développement d’une nouvelle approche innovatrice aura de grandes implications pour les études portant sur la dendroprovenance à fine résolution dans des régions à faible variabilité environnementale.
Mots-clés: Bayésien, Dendrochronologie, Dendroprovenance, Échantillons subfossiles, Intensité de bleu, Machine learning, Pin blanc, Pinus strobus
Maimoona Birjees
Étudiant.e au doctorat
Université Laval
Autres auteurs
- Evelyne Thiffault (Université Laval)
- Nelson Thiffault (RNCan-Centre canadien sur la fibre de bois)
PDF non disponible
Bloc 4 -
Session Session affiches
Session affiches - 13h00
White spruce (Picea glauca) is a key reforestation species in the eastern white birch–balsam fir forests, particularly within Réserve faunique des Laurentides. However, concerns have emerged regarding the health of white spruce populations, especially in reforested stands where some trees exhibit symptoms of chlorosis i.e., yellowing of needles often associated with stress and poor health. This study aims to assess the occurrence, intensity, and potential causes of white spruce decline by integrating landscape and site-level analyses. At the landscape scale, we examine the spatial distribution of chlorosis (presence and absence) and severity in reforested stands and its relationship with edaphic characteristics and silvicultural practices. The site-level investigation focuses on selected representative sites, evaluating the effects of climatic variability and nutritional imbalances on white spruce health and growth. Meteorological trends, soil and foliage nutrient composition will be analyzed to determine their influence on chlorosis occurrence and severity. Data collection includes Eco-forestry and geological maps, LiDAR data, field inventories, and direct sampling of soil and foliage. We hypothesize that white spruce decline manifested by needle chlorosis is primarily driven by site-specific conditions, including edaphic factor and past management practices, and is further intensified by extreme weather events and nutrition deficiency. The expected outcomes of this research include a comprehensive assessment of factors influencing white spruce decline, providing insights into the interactions between soil characteristics, silvicultural practices, climate variability and nutrition deficiency. The study aims to contribute to improved reforestation strategies, support sustainable timber production, and enhance the resilience of boreal forests in a changing climate. Findings from this study will inform adaptive management approaches and policy recommendations to ensure the long-term viability and productivity of white spruce in reforestation efforts.
Mots-clés: White spruce decline, chlorosis, reforestation, soil nutrition, climate stress, silviculture,