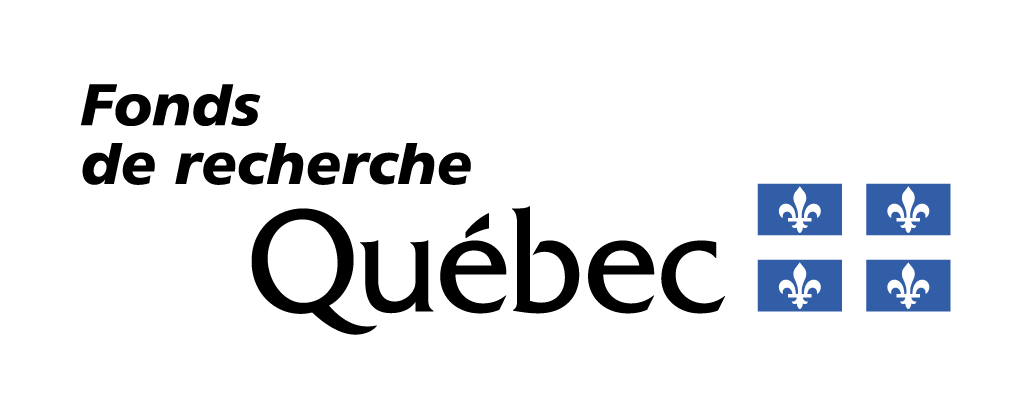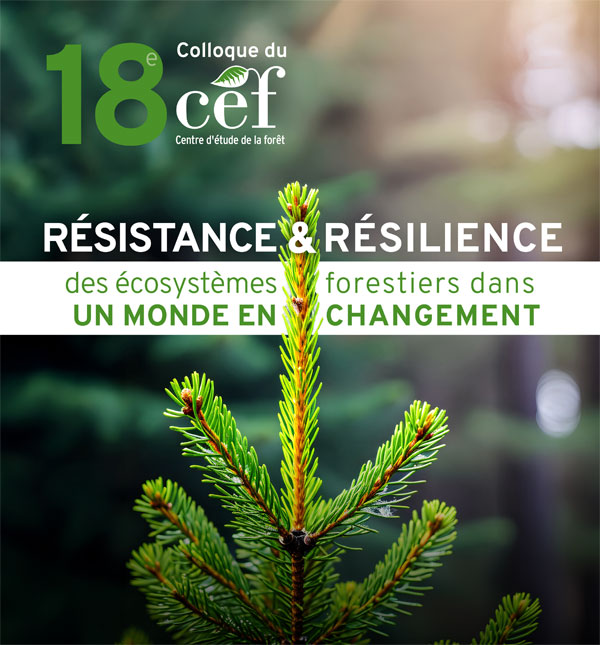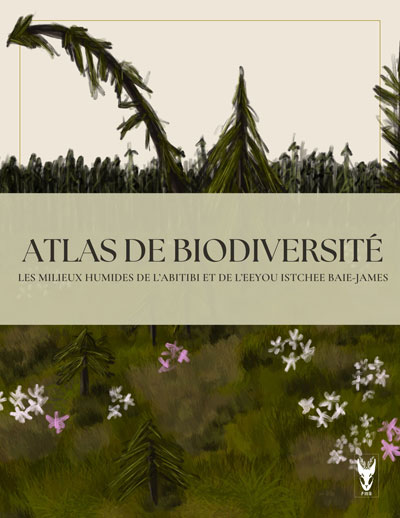Léa Hellegouarch
Doctorat
Suivi à grande échelle spatiale des secteurs restaurés suite à des perturbations naturelles successives dans la forêt boréale de l'est du Canada
Université du Québec à Chicoutimi
Directeur: Yan Boucher
Codirecteur: Alexandre Morin-Bernard, Patrick Faubert
Formations :
- Bachelor en Écologie, Biodiversité et Gestion des espaces naturels, à l'Institut Supérieurs de l'Environnement, Versailles, France (2019-2022)
- Master en Télédétection-Environnement à l'Université Rennes 2, Rennes, France (2022-2024)
- Doctorat en Biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Canada (2025- en cours)
Expériences de stage :
- Chargée de mission biodiversité et cartographie à l'association du Triangle Vert à Marcoussis, France (4 mois, 2022)
- Classification du Marais du Gannedel avec l'algorithme CNN au laboratoire LETG (Littoral – Environnement – Télédétection – Géomatique) du Centre national de la recherche scientifique, Rennes, France (3 mois, 2023)
- Caractérisation de la croissance des forêts restaurées issus d'accident de régénération en forêt boréale nordique à partir de la télédétection au laboratoire EcoTer à l'Université du Québec à Chicoutimi, Canada (6 mois, 2024)
Projet de thèse :
Depuis les années 1960, on recense plus de 2,5 millions d’ha de plantation qui ont été mises en terre au Québec. Les raisons pour ces plantations sont diverses : pour pallier à une mauvaise régénération de la forêt après coupe forestière ou à la suite de perturbations successives ou pour la sylviculture intensive. Malgré les grandes superficies occupées par les plantations au Québec, il subsiste un manque de suivi et de connaissance sur la croissance et le rendement de ces plantations. Le premier objectif principal de cette thèse sera donc de suivre la croissance et le rendement des plantations dans la région boréale nordique après une mauvaise régénération causée par des feux successifs (landes forestières). Toutefois, le suivi de ces plantations en milieu nordique présente plusieurs contraintes logistiques et économiques, rendant les inventaires terrestres difficiles à réaliser. Pour pallier ces limitations, nous utiliserons des approches de télédétection, notamment les drones et le LiDAR aéroporté, afin d’obtenir des données précises sur la structure des peuplements. L’analyse de ces données, combinée à des modèles de croissance, permettra d’estimer la production de biomasse aérienne en lien avec différents facteurs abiotiques (climat, perturbations naturelles, traitements sylvicoles, conditions topo-édaphiques). Cette recherche aidera à mieux comprendre comment les plantations croissent et quels sont les facteurs qui influencent leur développement. Notre deuxième objectif principal est de créer un profil de plus de 2,5 millions d'hectares de plantations plantées depuis les années 1960. Nous voulons comprendre comment elles ont évolué jusqu'à aujourd'hui et comment. Les résultats attendus sont l'apparition de feuillus au sein des plantations, une baisse de la croissance notamment à la suite de perturbations naturelles (feux, épidémies, …) ou bien différentes coupes (éclaircissement, totale, partielle, …). L'étude aidera à comprendre les facteurs importants pour planifier les plantations. Elle permettra aussi d'évaluer la croissance et prévoir comment le changement climatique et les perturbations vont affecter l'avenir de ces plantations.